La belle exposition “C’était dans le journal” avait été présentée par les Amis du musée Lapios à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2020 à Belin-Béliet.
Dans l’éditorial de présentation de cette exposition, Gilles Rosières, dit avoir découvert « grâce au site de la Bibliothèque du Congrès de Washington que les cow-boys de 1872 ont pu être au courant du crime de Tastous, au Barp, dans les journaux de Virginie ou de l’Alabama », incroyable, Non !
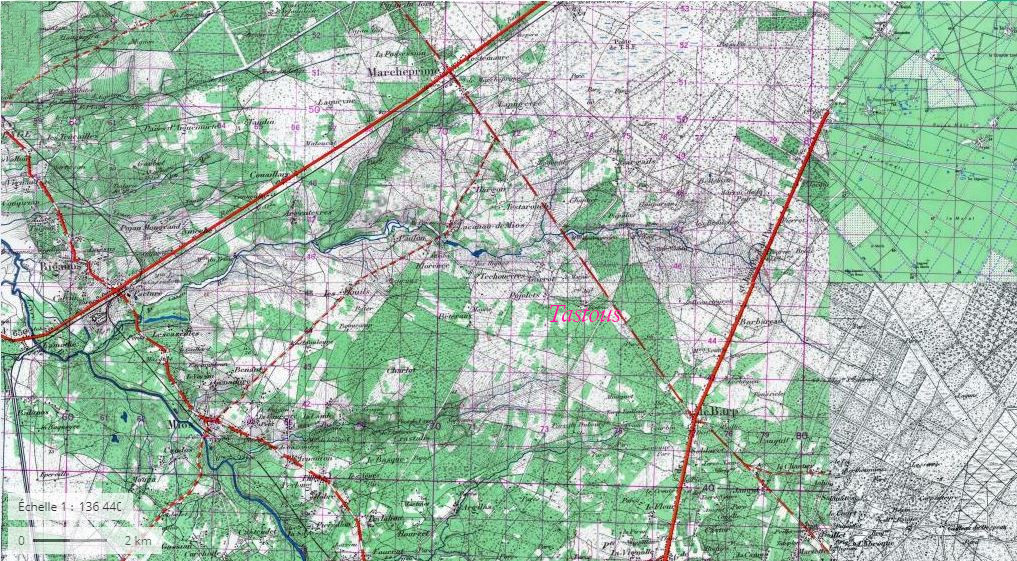 La métairie de Tastous, appartenant à M. Marthiens, émerge de la pinède, à quelques centaines de mètres de la route ; elle est située dans la commune du Barp, en pleine lande à cinq kilomètres du chef-lieu et à quatre cents mètres de la route agricole, qui relie cette localité à la station de Marcheprime (sur la voie ferrée de Bordeaux à Arcachon.)
La métairie de Tastous, appartenant à M. Marthiens, émerge de la pinède, à quelques centaines de mètres de la route ; elle est située dans la commune du Barp, en pleine lande à cinq kilomètres du chef-lieu et à quatre cents mètres de la route agricole, qui relie cette localité à la station de Marcheprime (sur la voie ferrée de Bordeaux à Arcachon.)
La maison affectée au logement des colons est de pauvre apparence et très isolée ; c’est un simple rez-de-chaussée, composé de quatre petites pièces, ayant sa façade sur une sorte de clairière plantée de quelques grands arbres. De chaque côté de l’habitation et un peu en avant, à une distance de dix à douze mètres, se trouvent deux bâtiments, l’un au midi, divisé en plusieurs compartiments, sert de grange, d’écurie et de remise, l’autre, vers le nord, est un fournil, près duquel on aperçoit une étable à porcs.
Au mois de novembre 1869, les époux Arnaud Mano viennent s’établir sur cette propriété ; leur fils les y accompagne. Mais ce jeune homme meurt l’année suivante, et ils recueillent auprès d’eux leur fille Jeanne, dite Manorine, et son mari, Jean Mano, dit Johannès.
Ce dernier a été au service de M. Duluc, au Barp, six mois environ et n’a pas été chez lui un mauvais serviteur. En octobre, un incendie brûle tout chez eux : ils perdent tout, pour quinze cents francs environ ; une quête faite dans la commune leur rapporte soixante-quinze francs soit un bien maigre butin. Le jeune ménage, s’installe à Tastous en octobre 1870, amenant avec lui trois jeunes enfants, dont l’aîné a alors six ans à peine, auxquels doit bientôt se joindre un nouveau-né.
Toute cette famille est estimée ; ce sont des gens laborieux, qui d’une lande en friche réussissent, à force de travail, à en faire une terre fertile.
Johannès travaille la terre, puis, vers octobre 1871, devient facteur avec quarante-cinq francs d’émolument. Son beau-père, moyennant trente francs par mois, le loge, le nourrit, lui et toute sa famille.
Le temps passe…
Jean Fouquet, 36 ans, métayer au Barp reçoit de la vieille Mano la confidence qu’on a tué la dinde le Samedi-saint 30 mars 1872. Le 9 avril 1872, Johannès fait sa tournée, à 6 heures du matin, et termine son service à 3 heures de l’après-midi après avoir fait vingt-cinq kilomètres. Comme d’habitude, il se rend à l’auberge de Duprat ; il y boit, il y joue. Le soir, vers sept heures et demie, alors qu’il s’apprête à aller coucher dans l’écurie de M. Perrin, le maire du Barp arrive, et ils jouent aux cartes jusqu’à dix heures passées avec Chéri Courbon, 21 ans, boulanger à Salles, et Jean Calens, 32 ans, marchand drapier au Barp. Johannès est vêtu de sabots, chaussettes de couleur noirâtre, un pantalon bleu, un gilet de même teinte, un paletot d’alpaga, une blouse bleue à collet rouge et un béret, plus un tricot en dessous de la chemise. Johannès reste au Barp, parce que le lendemain, de bonne heure, il doit fendre du bois pour Ferréol ; le matin du 10 avril, Arnaud Larrue, qui ne parle pas français, le trouve couché dans l’écurie, sur des bottes de foin ; la porte de l’écurie est grande ouverte alors que Larrue l’avait bien fermée la veille. Mano lui dit qu’il va travailler chez Ferréol, et Larrue s’en va soigner ses bestiaux. Raymond Duprat, 51 ans, cantonnier au Barp, s’est levé à cinq heures ; Mano va à lui et lui demande des outils pour fendre du bois chez Morillon Cazeaux-Ferréol ; Duprat remarque que Mano a les yeux, gros comme une personne qui n’a pas bien dormi.
Cette nuit-là – du 9 au 10 avril –, Jean Templon-Lévesque, 40 ans, meunier au Barp, conduit deux charrettes jusqu’à Marcheprime ; il fait très sombre ; aux environs de Pioussec, il croise son cousin.
S’agit-il de Guillaume Templier, 40 ans, propriétaire, qui s’exprime très difficilement en français mais plutôt en gascon. Guillaume Templier passe avec Mano la journée et la soirée du 9 avril ; il trinque avec lui. Sur le tard, vers 10 heures et quart, comme ils sont encore dans l’auberge, il demande à Mano s’il veut s’en venir avec lui (Templier demeure au-delà de la métairie de Tastous, dans la lande, près de la route agricole). Sur le refus de Mano, qui cependant l’avait « amusé » jusque-là, en lui laissant croire qu’ils s’en iraient ensemble, Templier part tout seul ; arrivé à Pioussec, à peu de distance de la métairie, sa jument a peur; il la fouette, et la bête prend aussitôt le galop. Il rencontre sur la route l’attelage d’un nommé Baillet qui s’en vient au Barp. Templier ne peut s’expliquer le motif de l’effroi manifesté par sa jument.
Quelques centaines de mètres avant d’arriver à Pioussec, une des juments de l’attelage a peur ; il n’y a à cet endroit-là rien sur la route. À onze heures et demie, il arrive en face la métairie de Tastous. Un peu plus loin, une des deux charrettes étant trop en arrière, il attend ; il est près du pont de Templier ; c’est alors qu’il entend un cri suprême de désespoir. Sur le moment, aucun soupçon ne lui traverse l’esprit.
Le 10 avril 1872, deux enfants de Johannès Mano se lèvent à la première heure du jour ; l’ainé, qui a huit ans, appelle « pépé » (son grand-père) et, n’en recevant aucune réponse, saute à terre, habille son petit frère (trois ans), et tous deux, leur petit sac de livres sur le dos, se disposent à partir pour l’école sans emporter le morceau de pain habituel, personne n’étant là pour leur donner.
Il faut passer par la chambre où doivent être les grands-parents, elle est vide ! Les deux petits pénètrent alors dans la chambre de leurs sœurs et les voient baignées dans leur sang, le crâne ouvert, l’une d’elles ayant la figure toute fendue. Ils sortent, et à la droite de la maison, en sortant sur la clairière devant la grange, s’arrêtent un instant en face de leur mère – une lanterne s’est échappée de ses mains.
Un peu plus loin, barrant un sentier de chèvres qui mène à la métairie, la grand-mère, cinquante-deux ans, qui a reçu plusieurs blessures, respire encore, mais, ne peut parler ; son pronostic vital est engagé comme on dit aujourd’hui. Dix mètres plus loin, au-delà d’un four à pain, nouveau mort, le grand-père, qui tient à la main une pelle comme un soldat porte les armes, et cette position ne se constate guère sur les cadavres ! Les enfants évitent la dépouille, traversent les pins ; les deux petits, sur lesquels la peur redouble, font un détour, se jettent sur la route et courent dans la direction du Barp. Vers 6 heures 1/2 du matin, le sieur Guillaume Goujon, 52 ans, charron au Barp, et Pierre Chardon, 53 ans, carrossier au Barp, rencontrent les deux petits garçons sur la route agricole ; aux questions qu’ils leur adressent sur l’endroit où ils vont, questions très naturelles entre gens qui se connaissent, ils répondent invariablement et d’un air qui n’accuse pas une conscience exacte de leur malheur : « Grand-père, grand-mère, maman et nos deux sœurs, tout le monde est mort chez nous ; il y a du sang dans le lit. Nous allons au bourg chercher notre père ». Pierre Chardon, sur le refus de son camarade de se rendre avec lui à la métairie, se rend tout seul à la maison de Mano, et constate que tout le monde, en effet, a été assassiné. Son camarade, s’étant ravisé, accourt. Chardon va aussitôt avertir des voisins, et, à son retour, il a la douleur de remarquer deux nouveaux cadavres, ceux des petites filles. En même temps, du monde arrive, et l’on s’empresse autour de la vieille Mano, qui agonise. Chardon constate la rigidité cadavérique de Manorine, ce à quoi Goujon ajoute que le sang trouvé sur le cadavre de Manorine est caillé, et que ses cheveux sont couverts de rosée, d’où il conclut que la mort remonte à plusieurs heures. Chardon se souvient que les enfants leur ont dit qu’ils vont chercher leur père, qui a couché au Barp.
Jérôme Mano, 27 ans, cantonnier à Mios, arrive aussi un des premiers sur les lieux du crime ; il voit les cadavres ; plus tard, il sera témoin de l’évanouissement de Mano.
Guillaume Hazera, 53 ans, charpentier au Barp, rencontre aussi les enfants Mano et en reçoit la triste nouvelle que l’on connait.
Un quart d’heure après, le sieur Félix Roumegoux arrive précipitamment au Barp et fait connaitre que les époux Arnaud Mano, leur fille et leurs petites-filles ont été assassinés. Henri Martin, âgé de trente ans, aubergiste au Barp, apprenant que la famille Mano a été assassinée tout entière, dépêche aussitôt son jeune enfant à Johannès Mano pour lui annoncer ce malheur ; c’est ainsi que, vers sept heures, le jeune Henri Martin, vient annoncer la sinistre nouvelle à Johannès Mano, parti fendre du bois chez Cazeaux Ferréol, quarante-cinq ans, charretier au Barp, alors qu’il déjeune en compagnie de la famille[3] ; il ne dit rien en entendant cela, et ne répond rien à l’enfant ; les convives en sont atterrés ! Seulement, quelques instants après, il s’écrie : « Ah ! mon Dieu !» et il part pour Tastous. Quelques habitants du Barp, l’accompagnant sur la route, le voient d’abord marcher d’un pas ferme et rejoindre ses deux petits garçons, puis tout à coup, au moment où il s’engage dans l’allée conduisant à la métairie, apprenant que la grand-mère respire encore, il s’affaisse sur lui-même ; Henri Martin, lui-même, se rend à Tastous, où il voit Mano évanoui, mais la figure de l’accusé n’étant pas défaite, il ne croit pas à un évanouissement réel.
En arrivant à Tastous, Jean Calens descend de la carriole de M. Perrin où il était monté, et pendant l’« évanouissement », avec un compagnon de route, conduit Johannès chez Maurice Mano à 300 mètres environ de la métairie Marthiens ; Jean Rablade, 47 ans, berger au Barp (il parle en gascon), va, de la part de son maître, porter à Tastous une bouteille d’eau-de-vie, afin de secourir Johannès, qui se trouve mal ; eau-de-vie que Johannès boit parfaitement : il arrête, au passage, les gouttes qui lui coulent des lèvres ; un instant après, il boit à même le goulot ! Jean Calens lui couvre la tête d’un linge afin de lui épargner la vue des cadavres ; c’est encore lui qui le fait boire. Là, déposé sur un lit, il reprend ses esprits… pas tout de suite, dira Johannès, je ne suis revenu à moi que lorsque le capitaine de gendarmerie est venu m’appeler.
En effet, la grand-mère respire encore. La femme de Johannès a complètement cessé de vivre. Le grand-père a deux fractures à la partie postérieure du crâne ; le chien de la métairie se tient près du corps. Demandant à un voisin si la bête est méchante, il est répondu qu’elle aboyait toujours, mais que cette nuit-là elle n’a pas été entendue. Enfin, à l’intérieur de l’habitation, dans la chambre située à droite de la porte d’entrée, les deux petites filles, Marie, âgée de cinq ans, et, Maria, enfant de onze mois, sont étendues chacune sur un lit, mortes, et la tête affreusement mutilée. Les cinq victimes ont du reste été frappées avec le même instrument par une main vigoureuse et sûre, et personne ne doute qu’elles soient tombées sous les coups du même meurtrier.
Quel est l’auteur de ce quintuple assassinat ? Maurice Mano, 35 ans, cultivateur au Barp, averti à six heures du matin, croit d’abord que le criminel est un étranger. Jean Templon-Lévesque pense alors que le vieux Mano, entendant passer ses charrettes sur la route, avait voulu crier au secours, et que c’est à ce moment-là qu’il a dû être frappé. Quelques-uns disent bien avoir vu dans le pays des individus appartenant à une bande de gitanos ! Il y a bien un voisin, nommé Rablade, qui un jour, avait eu une dispute dans le bois, avec les Mano. Le différend survenu avec Rablade était insignifiant ; il y avait eu de légers démêlés – quelques coups de pierre – à propos de pacage ; mais ce voisin est un parfait honnête homme, et on ne saurait le soupçonner d’un si horrible forfait.
Le 13 avril 1872, nous lisons dans La Gironde : « Hier, dans l’après-midi, le bruit d’un crime épouvantable, commis près de la ligne d’Arcachon, à Marcheprime, se répandait dans notre ville. On parlait de l’assassinat d’une famille entière. Il n’est malheureusement plus permis ce matin de douter de la vérité, et les détails qu’on se racontait hier n’avaient rien d’exagérés. »
Voici ceux que nous avons recueillis à la hâte, en attendant le retour d’un de nos collaborateurs, qui s’est rendu sur le théâtre du crime. L’assassinat a été commis, dans la nuit de mardi à mercredi, chez un sieur Manaut, ou Mano, dit le Maçon. Il n’a été connu que dans la matinée. À 10 heures et demie, en effet, les autorités recevaient de Marcheprime la dépêche suivante : « Adjoint spécial à gares et gendarmerie. Une famille entière a été assassinée cette nuit à Tastous, commune du Barp / Cinq cadavres sont étendus. Faites surveiller voyageurs de mauvaise mine. Enfants disent avoir vu une bande de gitanos dans les bois.»
Les victimes habitent une maison isolée dans les pins, à 300 mètres de la route agricole de Marcheprime au Barp ; là, point de secours possible, les habitations les plus voisines se trouvant dans un rayon d’un millier de mètres, et encore ces demeures ne sont-elles que de misérables chaumières où les bergers parquent leur bétail.
Dans une grange, devant laquelle veille le garde de la commune, on a déposé provisoirement, côte à côte, le père Mano et sa fille Marie ; Arnaud Mano, soixante ans, a le crâne emporté et les épaules contusionnées, la poitrine et le ventre bleuis par les coups. La fille, Marie, trente-et-un an, couchée la face contre terre, laisse voir de hideuses blessures à la tête et au cou ; les cheveux et la robe sont souillés de sang et de terre. Une forte odeur cadavérique se fait sentir chaque fois qu’on ouvre la porte.
À 8 ou 4 mètres de la grange, dans la direction du nord, s’élève la maison d’habitation, qui est ouverte à tout venant. Dans une des chambres, deux cadavres d’enfants, recouverts d’un drap tout maculé de sang ; en face, un lit tout défait encore, le lit des enfants, avec l’empreinte de leurs petits corps, et des traces de sang. Dans une chambre attenante, la malheureuse grand-mère, qui râle depuis trente heures. Celle-là a été frappée à côté de sa fille, un trou énorme s’ouvre derrière l’oreille gauche ; la tempe et l’œil droits atteints d’un autre coup. Lequel a mis à nu cette partie du crâne. La pauvre femme a néanmoins survécu si l’on peut appeler cela survivre … que trente heures après le crime !
Quelques charitables personnes de la commune, auxquelles se sont jointes deux religieuses, servent de garde-malades, s’efforçant de prolonger une existence condamnée sans doute, mais qui pourrait être pour la justice d’un secours inappréciable. Malheureusement cette dernière victime mourra sans avoir rouvert les yeux, sans avoir prononcé une parole.
Les crimes ont dû être accomplis après minuit, ainsi qu’il résulte de l’état des organes, que le médecin au rapport a trouvés complètement libres. N’oublions pas quelques détails qui ont leur importance. Toutes les victimes ont été frappées à la tête, à l’aide du même instrument, une hache, suppose-t-on. Nous disons : à la tête, car les contusions constatées sur les autres parties du corps n’auraient pas été mortelles. Le crime, d’après les paysans de la localité, doit avoir été commis par un homme connaissant très exactement les lieux. Afin d’attirer l’une après l’autre ses victimes hors de la maison, l’assassin serait allé à la porte de la grange, où il aurait fait du bruit ; ce bruit, ayant fait glousser la volaille, aurait éveillé la jeune femme, la malheureuse Marie, qui, étant sortie pour en reconnaître la cause, vêtue d’une simple robe d’indienne passée sur sa chemise, aurait été frappée la première ; sa mère, inquiète de ne pas la voir revenir, serait sortie à son tour, et, frappée elle aussi, serait tombée à ses côtés, dans une position parallèle, sa tête de niveau avec les pieds de sa fille. L’assassin aurait couru alors dix mètres plus loin, se serait embusqué derrière le four, et c’est là qu’Arnaud, qui est accouru armé d’une pelle, aurait trouvé la mort. L’assassinat des deux petites-filles a été le seul que le scélérat ait commis dans la maison.
L’enterrement des quatre premiers morts a lieu le 11 avril, vers cinq heures du soir. Les Mano possèdent un chien qui mord et qui ne peut surtout voir un nommé Larrue, domestique chez M. Perrin ; ce chien suit le cercueil d’Arnaud Mano ; il ne l’a pas quitté. Johannès et Larrue marchent ensemble à la suite ; à un moment donné, ils se séparent, et le chien suit Larrue qu’il a toujours vu d’un mauvais œil.
L’autopsie du cinquième cadavre est faite dans l’après-midi.
Les deux aînés – les garçonnets –, qui ont sept et trois ans, étaient couchés et dormaient dans une autre chambre. N’ayant rien entendu, ils n’ont pas bougé, et les assassins ne les ont pas découverts.
Les habitants de Marcheprime et du Barp, soulevés d’indignation à la nouvelle de ces actes horribles, se sont mis en campagne et battent les bois, où l’on croit que les coupables ont cherché un asile.
Le 14 avril 1872, nous recevons la nouvelle suivante que l’auteur de cette communication rattache au crime du Barp : dans la nuit de lundi à mardi, vers minuit, un individu inconnu frappait à la porte de M. Guiraud, médecin à Pessac. Ce praticien, habitué à être souvent appelé la nuit, ouvrit un judas et aperçut, dans l’ombre, cachées tout contre la porte, trois autres personnes. Il interpella celui qui avait frappé, et qui répondit : Je suis étranger, je me suis égaré, indiquez-moi mon chemin pour aller à Bordeaux. Quoique l’on répondît qu’il n’y avait qu’à suivre la route qui conduisait directement à la ville, l’intrus insista pour qu’on lui ouvrît afin de lui montrer le chemin ; le médecin crut à quelque mauvaise plaisanterie d’ivrogne et regagna son lit ; mais, avant, il eut le temps d’entendre l’individu parler à ses camarades qui s’éloignèrent. Lorsque dans l’après-midi de mercredi l’assassinat commis à Marcheprime fut connu à Pessac, les personnes auxquelles M. Guiraud avait raconté son aventure pensèrent de suite que les assassins ne pouvaient être autres que les quatre individus qui avaient rendu une visite la nuit précédente à ce médecin.
Le parquet de Bordeaux a envoyé hier au Barp deux de ses membres, M. le procureur de la République de Larouverade, et M. le juge d’instruction Pichard de la Tour, qui sont partis hier par le train de deux heures et ne doivent revenir que ce soir (…)
Anne Jean Charles Armand de Pichard de la Tour, né le 23 octobre 1830 à Bordeaux. Marié le 30 mai 1853 à Bordeaux avec Ernestine Ravez 1831-1856, fille d’Antoine Ravez et Marie Louise Amélie dite Zélie Ducru, propriétaire de Château Ducru-Beaucaillou à Saint-Julien. Conseiller à la cour de Bordeaux, à la mort de son épouse, il décide de quitter le monde et de devenir religieux. Le 8 mai 1881, il entre au noviciat des passionnés de Deusto (Vizcaya) où il fait sa profession le 14 mai 1882. Ordonné prêtre à Vitoria (Álava), il est élu conseiller provincial de la première curie espagnole lors de son érection, la Province du Cœur de Jésus en janvier 1887. Réélu en 1890, il participe au Chapitre général qui l’élit Consulteur général en 1893. Réélu en 1899. Le Père Jean Charles Pichard de Latour, venus en Terre Sainte, en 1903, après le décret de suppression des ordres religieux émis par le gouvernement français, il fonde la communauté de Béthanie (Israël), avec 12 religieux guidés par leur Supérieur Jean Charles de Sainte Anne (Jean Charles Pichard de Latour). Il décède en 1913 à Béthanie.
Le propriétaire de la métairie, M. Marthiens, nous racontait hier matin que la famille Mano lui avait affermé cette propriété, il y a quelques années, à un moment où la terre, laissée en friche depuis longtemps, avait fini par devenir très rebelle à la culture ; les Mano s’étaient mis au travail avec une volonté, un courage peu communs ; la métairie avait bientôt prospéré. Les termes du fermage ont toujours été payés régulièrement. En un mot, les métayers du Tastous étaient les plus vaillants de tout le pays. Maintenant ils reposent, côte à côte, dans une allée du cimetière du Barp, sous trois tertres de sable noir ; la jeune mère est entre les deux vieillards, couchée dans une bière, où dorment avec elle ses deux pauvres petites filles.
Les victimes, on les connait ; nous n’avons à ajouter bien peu de choses à ce que nous en disions hier. Chacun est d’accord à leur sujet. C’étaient de braves gens, des travailleurs honnêtes, jouissant de l’estime universelle à plusieurs lieues à la ronde ; sortant à peine, à force de labeurs, d’une gêne extrême, où les avait mis un surcroit de famille il y a quelques années, alors que leur gendre, Johannès Mano, ruiné par un incendie, avait été recueilli chez eux avec sa femme et ses enfants. Johannès est un homme qui peut avoir trente-deux ans ; il est petit, nerveux, voûté, d’aspect robuste. Le visage est maigre et pâle, l’œil très mobile, les sourcils très fournis et se joignant à la naissance du nez. On a remarqué l’impassibilité de son maintien : ni la confrontation avec les cadavres, ni la présentation de l’instrument du crime, … rien n’a pu l’émouvoir. Dans la journée qui a suivi l’assassinat, il a conservé assez de sang-froid pour vendre les volailles de la métairie.
L’enterrement de la belle-mère, qui a survécu trente heures, se fait le vendredi 12 avril dans les mêmes conditions que, la veille, les funérailles des quatre autres victimes. Un cortège nombreux et recueilli l’accompagne ; au moment où le cadavre vient de quitter la métairie, Johannès se tourne vers Pierre (Chardon ?), et lui dit : « Si tu veux les lapins, tu les payeras 1 f. 50. » Pierre fait observer à Mano, qu’on ne parle pas ainsi en pareil moment.
Le canton de Belin est dans la consternation. Le crime du Tastous, qui est le sujet de toutes les conversations, remet en mémoire, dans le pays, un autre crime analogue, commis en 1814 et dont le souvenir mérite d’être évoqué : une famille entière, — quatre ou cinq personnes, — est assassinée au Barp ; seul un enfant échappe, on ne sait comment, au massacre. Les auteurs et complices du meurtre, bientôt arrêtés, seront traduits devant le jury de la Gironde et condamnés. Cet enfant, aujourd’hui vieillard de soixante-cinq ans environ, n’a jamais pu renseigner la justice sur les circonstances du crime, pas plus que les deux orphelins du Tastous. Ce vieillard, qui a nom Deycart, habite la commune de Béliet, du même canton et il jouit de l’estime générale.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6332637g/f10.image.r=barp%20pichard?rk=128756;0https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k458244q/f2.image.r=barp%20pichard?rk=214593;2https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4778703j/f3.image.r=barp%20pichard?rk=257512;0https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k676347h/f3.image.r=barp%20pichard?rk=193134;0https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1144899n/f3.image.r=barp%20pichard?rk=150215;2https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k699037j/f4.image.r=barp%20pichard?rk=300430;4https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7558462z/f3.image.r=barp%20pichard?rk=278971;2
Jean dit “Johannes” Mano présumé innocent !
Jean Dit “Johannes” Mano, Facteur rural, charpentier, fils de Bernard Mano et Marie Haussibey, naît le 27 juillet 1843 à Saugnacq, Landes ; il se marie le 24 janvier 1865, Le Barp, avec Jeanne Mano 1841-1872 dont sont issus
- Bernard dit Bernardin Mano ca 1865
- Marie Mano 1867-1872 ;
- N Mano ca 1869
- Maria Mano 1871-1872 ;
Quel est l’auteur de ce quintuple assassinat ? nous demandions-nous hier.
Quelques-uns disent avoir vu des individus appartenant à une bande de gitanos. Mais ce sont là des histoires imaginaires dont on est bien vite revenu ; les bohémiens, en effet, n’auraient-ils volé ? Dans ce crime il n’y a que de la vengeance. L’opinion publique hésite d’abord, mais cette hésitation ne dure qu’un instant, et ceux qui se rappellent les sinistres pressentiments de la femme Arnaud Mano ressentent cette conviction intime que l’assassin est Johannès.
Alors il n’y eut plus qu’un cri : « C’est le gendre des Mano. »
Johannès Mano, le gendre, est facteur rural attaché au bureau de Barp ; il fréquente les cabarets, y boit plus que de raison, y joue et dissipe l’argent dont sa famille a tant besoin. Irrité des reproches qu’il reçoit dans sa famille, il y répond par des brutalités et des menaces de mort qui, hélas ! viennent de leur exécution.
C’est un peu après les funérailles des victimes. M. le juge instructeur entend des témoins dans le fournil. M. le procureur de la République, M. le maire du Barp et M. le capitaine de gendarmerie causent à voix basse, debout au milieu de l’airial de la ferme ; M. le docteur Lafargue nous montre le théâtre du crime. Assis et groupés aux portes des masures, des amis de la famille, des voisins, consternés, atterrés, se consolent entre eux, pour ainsi dire. Seul, accroupi contre un mur extérieur de la maison d’habitation, se tient Mano, la tête dans ses mains, voilant avec ses doigts, voilant mal, un œil inquiet qui errant des visiteurs aux magistrats, semble vouloir surprendre le secret des conversations. Et à côté de Mano, pas un voisin, pas un ami qui consolât, ce mari, ce père, ce gendre qui vient de perdre tous les siens d’une façon si brusque et si tragique !
Nous avons déjà, dit que l’opinion publique lui est peu favorable ; et que quand dans la contrée se répand avec la rapidité de l’éclair la sinistre nouvelle, il y a quasi-unanimité pour accuser Mano : « C’est lui qui a fait le coup ! » s’écrie-t-on énergiquement de toutes parts.
Mais l’intérêt ? Quel exécrable et puissant mobile a pu pousser un mari, un père, un gendre, à immoler sa femme, ses enfants, ses vieux parents.
De toutes les versions qui ont cours, et qui toutes trouvent leurs partisans, nous ne citerons que ce qui nous a été raconté à nous-même sur le lieu du crime. « Mano est un joueur, et un joueur d’argent » me disait mon conducteur à travers les landes. « Il passe souvent ses nuits au cabaret ; il y perd ou il y dépense tout son argent : de là, des querelles fréquentes avec sa pauvre femme, avec les vieux… »
Johannès, qui est le facteur rural de la commune du Barp — composée en partie de hameaux disséminés sur une grande étendue de pays, — accomplit chaque jour des tournées longues et pénibles ; il les termine aisément dans sa demi-journée, et rentre invariablement au bureau entre midi et quatorze heures. Le facteur boîtier du Barp, qui s’y connait, nous assure que c’est là un vrai tour de force ; et Johannès l’exécute chaque matin.
Cet homme si robuste est, en même temps, très inventif et très adroit ; exact, soumis, peu causeur, irréprochable dans son service, bien noté, paraît-il, à l’administration. À la métairie du Tastous, au contraire, Johannès est en disputes continuelles avec son beau-père, avec sa femme ; il vit peu chez lui et fréquente le cabaret.
Johannès subit la confrontation d’une visite de corps des cinq victimes ; mais rien n’est découvert qui puisse autoriser les soupçons : pas de sang sur les effets, pas de sang sur les mains. Néanmoins, la justice croit devoir s’assurer de l’homme, et le confie pour la nuit à la surveillance du garde champêtre de la commune et d’un gendarme. Le matin venu, on le conduit au Barp. On nous assure, au dernier moment, que Jean Mano est relâché jusqu’à nouvel ordre. Nous ne donnons cette affirmation que sous toutes réserves.
La journée d’hier a été laborieuse pour les magistrats chargés de rechercher la vérité sur ce crime terrible. En revanche, l’instruction entre dans une nouvelle phase, et l’homme sur qui pèsent, dès les premiers moments, les soupçons unanimes de toute la contrée, est mis en état d’arrestation, à la suite d’un examen plus minutieux que le premier. Cependant, nous faisons nos réserves sur les appréciations qui suivent et que l’instruction ultérieure peut renverser.
Hier, à six heures du matin, nous prenions une deuxième fois le train d’Arcachon.
La gare de Testemaure ou Marcheprime, qui était autrefois à une journée de Bordeaux, mais où l’on arrive aujourd’hui dans l’espace d’une heure, se trouve à distance égale (26 kilomètres) entre cette ville et La Teste; aussi le convoi s’y arrête pendant quelques minutes pour renouveler sa provision d’eau et de combustible. Là encore, à part quelques essais très récents de culture, on ne voit que de sombres forêts de pins dans le lointain; rien ne vient égayer la tristesse de cette immense solitude. De loin en loin seulement on aperçoit quelque berger solitaire, immobile sur ses longues échasses ou marchant à pas gigantesques, comme un fantôme des marais, jusqu’à ce qu’il disparaisse confondu avec les brouillards de l’horizon. Le voyageur qui parcourt ce pays éprouve un sentiment pénible en contemplant cette triste page de la nature. Le sol n’est pas cependant aussi stérile qu’il le paraît et des expériences récentes ont parfaitement démontré que plusieurs arbres, tels que le pin, l’acacia, le chêne, le châtaignier, le peuplier et même le mûrier, peuvent réussir très bien dans cette région longtemps négligée.
À Marcheprime, nous nous rencontrons avec les magistrats instructeurs et deux gendarmes de Bordeaux sous la conduite de M. Gros, capitaine commandant l’arrondissement. Au même moment, M. le procureur de la République reçoit d’un exprès, dépêché par le maire du Barp, une lettre dont voici le sens exact, sinon le texte même : « J’ai trouvé hier l’instrument du crime ; c’est un pic où adhèrent de la terre mêlée de sang et des cheveux de diverses nuances. J’ai fait transporter au Barp cet instrument ; je n’ose y toucher davantage jusqu’à votre arrivée. » C’est là une trouvaille inespérée, d’autant moins attendue, que l’avant-veille, dans son interrogatoire, Jean Mano omet de faire figurer le dit pic dans le dénombrement des outils, instruments et objets qui servaient aux victimes dans la rude besogne des métayers et des résiniers.
Deux voitures sont mises à la disposition des voyageurs, et, une heure après, nous sommes au Barp. Jean Mano, que nous appellerons désormais Johannès, ainsi qu’on le fait dans le pays, est déjà arrivé sur la place de la Mairie, flanqué de deux gendarmes de la brigade de Belin, auxquels l’ont confié ses gardiens. Johannès, en effet, relâché provisoirement par l’Instruction n’a joui que d’une liberté très relative, gardé à vue qu’il est depuis le mercredi matin ; sa dernière nuit, il l’a passée au Barbareau, sous la surveillance du brave garde-champêtre Pierre Beyris, à qui des paysans ont été adjoints en cas de besoin. Les investigations de la journée commencent par une visite très minutieuse de la grange, où Johannès prétend avoir passé la nuit. Cette grange, qui appartient à MM. Marthiens frères, propriétaires de la métairie du Tastous, est située en avant du bourg, trois chemins y donnent accès : la route nationale, un sentier qui court à travers les pins, et le champ qui vient s’arrêter au mur d’un jardin attenant au bâtiment. L’emploi de la nuit parait avoir été mal expliqué par Johannès ; il persiste dans ses premières déclarations et affirme qu’il a couché dans la grange, ou pour mieux dire, dans une petite étable qui s’ouvre sur le jardin. Dans ce jardin on remarque de fraîches empreintes de sabots, ce qui ferait supposer que quelqu’un a pu enjamber la muraille ; mais, d’un autre côté, une porte à claire-voie, qui défend aux étrangers l’accès de la maison et de la grange, était ouverte le matin, avant le lever de Johannès, et cette circonstance n’a pas manqué d’éveiller l’attention. Si Johannès est sorti la nuit, par où est-il sorti ? Par la route, où par le jardin ? On est revenu à la mairie, et M. le docteur Lafargue, renouvelant une expérience que les circonstances où il était l’avant-veille l’avaient forcé de précipiter, ordonne à Johannès de relever sa manche. Et voilà qu’au-dessus du poignet gauche (Johannès est gaucher), l’honorable médecin croit remarquer une très petite goutte de sang. Une loupe aidant, la tache grossit ; d’autres points noirâtres paraissent ; plus de doute, c’est du sang caillé ; c’est une gouttelette qui dans la pensée du docteur a dû arriver de jet et lancer de petites éclaboussures. Cette révélation, jointe à la découverte de l’instrument probable du crime, donne à la situation de Johannès une extrême gravité. La goutte de sang, échappée aux regards des premiers observateurs, est cependant visible à l’œil nu. Les assistants s’empressent ; la loupe passe de main en main, et la petite tache grossit jusqu’à devenir un des principaux éléments matériels d’une prévention qui, nous le répétons encore, a toujours été dans l’esprit de chacun.
Les questions deviennent plus pressantes, les réponses moins certaines, et M. Pichard, le juge d’instruction, n’hésite point à ordonner un changement complet du costume de Johannès. À l’heure où nous racontons ces détails, les vieilles hardes de l’assassin (présumé innocent, doit-on préciser) sont au greffe pour y être soumises à un examen minutieux.
L’arrestation de Johannès est dès lors décidée, et les gendarmes que nous laissons avec les magistrats au Barp, ont dû l’emmener dans la soirée. Et maintenant que nous avons tenu nos lecteurs au courant des principaux détails de cette lamentable tragédie et de ce commencement d’instruction, laissons la justice poursuivre son œuvre.
Le pic dont l’assassin s’est fait une arme est une sorte d’outil qui n’est ni une hache, ni un marteau, ni une pioche, mais qui tient de ces trois instruments, long de 90 cm, large de 20 cm à l’endroit de la douille, d’un poids de 3 kg, c’est un rude outil dont le maniement exige des poignets vigoureux et habiles. L’assassin a frappé, avec une opiniâtre sauvagerie du côté de la douille ; et cela est si vrai, qu’au bout du manche, à l’endroit où le fer s’emboîte, de la terre est adhérente pétrie de sang et mêlée de cheveux de diverses nuances, châtains, gris, noirs. »
On nous raconte au Tastous que mardi soir, le gendre du malheureux Arnaud qui vivait, nous a-t-on assuré, en mésintelligence avec sa famille, avait annoncé qu’il coucherait au Barp, ce dont personne n’est surpris, étant données les habitudes assez irrégulières de l’homme, et des nécessités de son métier de facteur rural ; il fréquente les cabarets, y boit, y joue et dissipe l’argent dont sa famille a tant besoin.
Pierre Darrouy, 30 ans, facteur à Bordeaux, ex-facteur au Barp, a gardé cinq ou six mois, sous ses ordres, Johannès Mano, dont il n’a eu qu’à se louer, en ce qui touche le service de l’administration de la poste au Barp ; il a fait route, quelque temps avant le crime, avec Mano, qui lui a confié ses projets de séparation prochaine d’avec sa famille.
Le 14 avril, Johannès Mano, l’assassin présumé, est amené à Bordeaux, par le train de neuf heures du soir ; suivi d’un certain nombre de curieux, il traverse une partie de la ville, c’est par le cours des Fossés
qu’il rejoint la caserne de gendarmerie d’abord, puis, quelques instants après, le fort du Hâ.
Le Fort du Hâ fut bâti à partir de 1456, soit peu de temps après la reprise de Bordeaux aux Anglais. Le roi Charles VII en ordonna la construction parallèlement à celle du château Trompette pour “tenir aux Bordelais le fer au dos” et se défendre face aux Anglais. À partir de 1731, le fort devint prison civile, puis, pendant la Terreur, prison d’État.
La démolition du fort débuta en 1835 pour construire le nouveau palais de Justice et la nouvelle prison; en 1846, l’architecte Thiac finit de modifier les bâtiments pour parfaire la transformation du château en véritable prison. Des travaux de démolition sont entrepris et seules les deux tours encore présentes aujourd’hui sont conservées (la tour des Minimes, dite tour de la poudre, et la tour des Anglais, dite tour du Peugue ou des sorcières ; elles sont aujourd’hui inscrites au titre des Monuments historiques.) L’emplacement de cette ancienne forteresse accueille aujourd’hui l’Ecole nationale de la Magistrature et le palais de Justice.
Le bruit, de l’arrivée de l’assassin présumé s’étant répandu, la foule grossie ; quand, conduit à la prison, l’inculpé sort de la caserne, des menaces, des imprécations se font entendre. Bien après que Mano eût été enfermé, des groupes nombreux stationnent encore aux abords de la maison de justice. L’impassibilité témoignée par le facteur en présence des magistrats ne l’a pas abandonné dans la prison ; c’est l’homme le plus indifférent à tout ce qui se passe, à tout ce qui s’agite autour de lui et à cause de lui.
Il arrive tard. On doit lui faire passer la nuit dans une cellule. Mais le matin, M. le directeur le fait placer dans un dortoir commun. Mano a sur lui quelque argent, peu de chose, mais des timbres-poste surtout. « Gardez cela, lui dit avec bienveillance M. le directeur, vous pourrez vous en servir ici.
— Vous avez raison, répondit le facteur, le plus simplement du monde : ça sera peut- être long, car il y a beaucoup de dégâts. » C’est la seule allusion que Mano fait à sa situation. Il parle peu, et seulement de choses indifférentes. M. le directeur ne lui a pas dit un mot du drame de Tastous, et tous ceux qui entourent l’inculpé ou qui se trouvent en rapport avec lui observent la même réserve.
Par un louable sentiment de réserve, nous nous étions abstenus de dire l’impression que cet homme nous avait produite, et surtout de rapporter une circonstance frappante que nous ne voulions point signaler alors dans la crainte d’entraver ou de paraître devancer l’œuvre de la justice. Mano est un homme de trente ans environ, de petite taille, au teint coloré. Ses manières sont celles d’un habitant de la campagne, il est coiffé du traditionnel béret landais, et couvert de vêtements assez propres, qui ne sont point ceux sous lesquels nous l’avons vu à Tastous pendant les premières investigations de la justice. La blouse est neuve. Peut-être lui a-t-on fait quitter les habits de travail qu’il portait alors.
Le 17 avril 1872, la justice, après avoir fait arrêter Jean Mano, le relâche faute de preuves suffisantes ; mais, aujourd’hui, elle revient sur sa première impression, et le facteur est de nouveau arrêté. On prétend que des présomptions graves pèsent maintenant sur lui, et notamment un caillot de sang trouvé sur son bras. On ne saurait trop louer la justice de la circonspection avec laquelle elle agit dans cette enquête ; elle marche pede claudo (le pied boiteux), mais elle arrive.
Le journal La Gironde dit que l’instruction du crime du Tastous se poursuit très activement. Manu qui est soumis, au fort du Hâ, à la vie commune des inculpés, a été extrait hier de la prison et conduit au cabinet du juge d’instruction. Son attitude a été celle des jours passés : il n’a rien avoué, a fort peu parlé, et on l’a reconduit à la maison de justice sans avoir rien pu obtenir de lui.
Mardi dernier, a eu lieu une nouvelle descente des magistrats instructeurs sur les lieux du crime.
Les passants étaient fort intrigués mardi, vers neuf heure : un homme, porteur d’une caisse de forme très irrégulière et de dimensions assez grandes, entrait dans la cour du Palais de Justice escorté de gendarmes. Un des concierges du palais recevait les arrivants et leur indiquait le greffe du tribunal, où le colis est déposé maintenant. Cette caisse est celle qui contient le pic dont l’assassin s’est servi la nuit du crime, elle a été confectionnée au Barp samedi matin, sur les réquisitions du procureur de ta république.
Source: Journal de Valognes du 25 avril 1872
En attendant que l’on découvre le meurtrier, on a déjà entre les mains l’instrument du meurtre. C’est une espèce de pieu ou de pioche, instrument de travail, auquel adhérent des lambeaux de cervelle, des cheveux et du sang.
On lit dans le Journal de Bordeaux : « L’obscurité qui régnait encore sur l’horrible assassinat de la famille Mano vient de faire place à la lumière. « On nous assure qu’hier, une femme R…, du Barp, chez qui Johannès Mano allait souvent, ne pouvant plus garder pour elle un secret aussi terrible, est allée porter aux magistrats une chemise ensanglantée que Johannès avait laissée chez elle, et en échange de laquelle il aurait pris une chemise appartenant au mari, François… Johannès aurait menacé de mort la femme R…, si celle-ci divulguait le secret. Si ce fait est exact, comme nous avons lieu de le croire, la culpabilité de Mano serait d’une évidence irréfutable. »
Journal de Lyon du 26 avril 1872 http://collections.bm-lyon.fr/PER00317253/ISSUE_PDF
3 mai 1872, l‘instruction sur l’affaire du Tastous se poursuit avec une grande activité. Outre les enquêtes auxquelles se livrent chaque jour, et M. Cazeaux, juge de paix à Belin, et M. Tastes, maire du Barp, le parquet de Bordeaux agit sans relâche et mande très fréquemment des groupes de paysans, qui sont confrontés avec Johannès et interrogés sur ses antécédents.
Un fait qui aurait son importance, et qui a été affirmé à la Gironde par plusieurs témoins, c’est que Johannès, au su de tout le monde, a menacé à plusieurs reprises ses parents « d’en finir avec les tracasseries dont il était l’objet. » On sait que ces querelles d’intérieur étaient provoquées sans cesse par ses habitudes d’intempérance, de jeu et d’éloignement de la famille.
Il nous est revenu un détail qui constitue à lui seul une des présomptions les plus graves que la justice ait encore recueillies contre le facteur Mano : une paire de chaussettes de laine, telles qu’en portent les paysans dont la chaussure habituelle est le sabot, a été retrouvée dans la grange où Mano avait couché la nuit du crime ; ces chaussettes étaient enterrées sous une barrique ; elles étaient encore souillées de boue et tout humides.
On en a inféré que l’assassin avait dû enlever sa chaussure pour marcher sans bruit, et que la route à travers champs étant très humide la nuit, l’assassin, en prenant le grand chemin, avait dû emporter sous la plante des pied, et adhérant à ces mêmes chaussettes, de la poussière qui s’y est transformée en une couche de boue.
Les chaussettes, d’après la déclaration d’un berger, nous assure-t-on, appartenaient au facteur Mano ; le témoin est, paraît-il, d’autant plus affirmatif que c’est lui-même qui les aurait tricotées et cédées à Johannès.
Un nouveau deuil affligeait, hier, les rares parents qui restent aux enfants de Johannès Mano. Une sœur de Marie Mano, l’épouse du facteur, celle qui était mariée au Barbareau, dans la commune même du Barp, est morte la nuit dernière à la suite de couches malheureuses. La pauvre femme aurait vu sa santé s’altérer par la nouvelle de l’affreux malheur qui frappait sa famille dans la funeste nuit du 9 au 10 avril, au moment le plus critique de sa grossesse ; elle laisse, outre l’enfant nouveau-né, un petit garçon de deux ans. Cette malheureuse femme était à peine âgée de vingt et un ans.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75584819/f4.item.r=%22johann%C3%A8s%20mano%22anonyme.zoom
Le 19 juillet 1872, à huit heures et demie du matin, MM. de la Bouverade, procureur de la République, Peyrecave, substitut, et de Miolis, juge d’instruction, arrivent au Barp pour procéder à un supplément d’instruction dans l’affaire du facteur Mano ; les magistrats interrogent les enfants de l’école, après quoi le fils du maire, Tastes, va au Barbaro chercher le fils aîné de Mano, qui est chez son oncle. En arrivant au Barp, l’enfant demande tout d’abord s’il y a des gendarmes. Il lui est été répondu négativement (les gendarmes, en effet, se tiennent cachés pour ne pas effrayer les enfants !).
Le jeune Mano, conduit ensuite à la mairie, répète les déclarations qu’il avait déjà faites devant le juge de paix de Belin, à savoir que, dans la nuit du crime, son père serait venu le remuer dans son lit, probablement pour s’assurer qu’il dormait. Un moment après, il aurait entendu la voix de sa pauvre mère criant : « On me tue ! »
Ensuite, le parquet se transporte au Tastous. Arrivé sur les lieux, le jeune enfant montre le coffre où, la nuit même du crime, son père avait serré un pantalon. Ou reconnait parfaitement, au fond du coffre, trois taches de sang que personne n’avait remarquées jusqu’alors. Les magistrats ordonnent de couper le bois du coffre, pour qu’il soit soumis à l’examen des hommes de l’art.
Toujours, d’après les renseignements qui nous sont fournis, et que nous avons tout lieu de croire, quoique nous les donnions sous les plus expresses réserves, Mano, la nuit du crime, aurait appelé son plus jeune fils couché avec l’aîné, et se serait approché du lit pour s’assurer si les deux enfants dormaient. L’ainé, qui ne dormait pas, aurait cependant simulé le sommeil, effrayé qu’il était par les cris de sa mère.
L’enfant déclare que la crainte de son père et des gendarmes l’avait seule empêché de faire plus tôt ces révélations.
Petite Gironde. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k12539269/f2.item.r=mano.zoom#
Le Procès de « l’homme de lettres » du Barp
Un ne nos rédacteurs est parti pour Bordeaux, et dès demain nous serons en mesure de donner des détails sur l’affaire de Mano, le Troppmann bordelais, qui va comparaitre devant la Cour d’assises de la Gironde.
Nota: Jean-Baptiste Troppmann, né à Brunstatt le 5 octobre 1849 et guillotiné à Paris, le 19 janvier 1870, est un ouvrier mécanicien, jugé coupable du meurtre des huit membres d’une même famille, crime également connu sous le nom de « massacre de Pantin ».
Correspondance spéciale du Petit Journal, Bordeaux, 7 mars 1873.
Le procès qui, lundi prochain, commencera à se dérouler en présence du jury, est de ceux que les annales judiciaires retiennent parmi les causes célèbres, et, à ce titre, nous devions à nos lecteurs les préliminaires pleins d’un poignant intérêt que nous allons placer sous leurs yeux.
Toutes les circonstances, d’ailleurs, qui entourent cette affaire, l’audace inouïe du crime, le mystère apporté dans son exécution, le passé de son accusé, son attitude énigmatique, les constatations de la science, les contradictions des témoignages, les difficultés de l’enquête, la longueur de l’instruction, tout en un mot concourt à passionner encore l’opinion, profondément impressionnée et douloureusement émue.
Si compacte est le vide qui enveloppe les faits dans leur origine, que l’on en est encore à ne pouvoir assigner avec exactitude une date qu’il importerait au plus haut point de connaître. Était-ce dans la nuit du 9 au 10 avril ou bien durant la matinée du 10 qu’a été accompli le forfait ? C’est le 10, en tout cas, que, répondant à l’appel de deux jeunes garçons tout en larmes, quelques habitants du Barp, village situé à quarante kilomètres environ de Bordeaux, à peu près entre cette ville et Arcachon, se dirigèrent vers une ferme isolée au milieu de la lande dont les abords leur réservaient le plus hideux des spectacles.
Tout le monde, dans le pays, connaissait et estimait les gens qui habitaient cette ferme, C’était une famille du nom de Mano, composée de huit personnes, à savoir Arnaud Mano, métayer et sa femme, leur fille Jeanne Mano dite Manonine et le mari de celle-ci, Jean Mano, dit Johannès, facteur rural, enfin quatre enfants issus de ce dernier couple, deux petits garçons dont l’aîné, âgé de sept ans, le plus jeune de trois ans et deux petites filles dont l’une, qui atteignait à peine onze mois, était encore allaitée par sa mère. « Venez vite s’étaient écriés les deux pauvres désespérés, venez vite, tous nos parents sont morts. »
Et les paysans qui cheminaient par la lande avaient hâté le pas, jusqu’au moment où, parvenus à un sentier qui donne accès à la métairie, ils avaient aperçu gisant sur la bordure de cet étroit chemin, la face tournée contre terre, le cadavre d’un vieillard, le chef de la famille, le malheureux Arnaud Mano. Une plaie béante à la nuque indiquait que le vieillard avait été frappé par derrière ; sa main gauche enfoncée dans la poche du pantalon indiquait qu’il n’avait opposé aucune résistance, et une petite pelle encore sous son bras pouvait faire supposer que la victime se rendait à ses travaux au moment où avait été perpétré le meurtre. On allait s’arrêter près de ce corps ensanglanté ; mais à peu de distance, un autre tableau plus affreux, sollicitait l’attention.
Dans une cour intérieure, devant la porte d’une grange, deux femmes étaient étendues sur le sol, inanimées une lanterne était posée entre elles, sur une pierre. L’une portait, dans la région frontale, deux blessures profondes : c’était Manonine ; elle était morte. L’autre avait la face couverte des traces nombreuses de coups fortement assénés avec un instrument contondant : c’était Mme Mano mère, elle respirait encore, mais était incapable de parler ni de faire le moindre mouvement.
Les spectateurs, glacés d’effroi, n’osaient s’aventurer plus loin, lorsque leurs jeunes guides, se remettant en marche, leur désignèrent un corps de logis dans lequel ils pénétrèrent avec eux. Là s’offrait aux regards une nouvelle scène de carnage. Dans une chambre du rez-de-chaussée, deux lits d’enfants étaient placés côte à côte ; sur chacun d’eux reposait, déjà raidi par le froid de la mort, le cadavre mutilé d’un petit être frappé pendant son sommeil.
Ainsi, de cette famille de huit personnes, trois seulement avaient survécu les deux garçons, que l’assassin, soit qu’il ignorât leur présence, soit qu’il voulût les épargner, n’avait pas menacés, et Mano, le facteur, que son emploi retenait fréquemment hors du logis.
Une dépêche, expédiée aussitôt, avertit la justice. Un juge d’instruction, un substitut, un médecin, le commandant de la gendarmerie et une escouade de gendarmes se transportèrent sur le lieu du crime.
Les cinq assassinats constatés, il restait à en découvrir l’auteur ; et d’abord, quel mobile avait pu guider la main du meurtrier ?
De la victime qui respirait encore, il n’y avait à attendre aucun éclaircissement ; elle devait expirer, après une agonie de trente heures, sans avoir recouvré connaissance. L’inspection de l’habitation et de ses alentours ne révélait la trace d’aucun indice. Tout soupçon d’une vengeance était d’avance écarté : on ne connaissait aux Mano aucun ennemi.
Toute pensée d’un vol se trouvait démentie par l’état des meubles, dont pas un seul n’avait été ouvert ; des provisions nombreuses étaient intactes ; une montre, appendue au mur était encore accrochée à son clou.
En passant en revue toutes les hypothèses, on en vint à supposer qu’une bande de bohémiens, aperçue les jours précédents aux abords du hameau de Tastous, peu distant de la ferme, pouvait n’être pas étrangère à ce lugubre drame. On s’arrêta aussi, un instant, à cette idée que des rodeurs nocturnes, surpris par les habitants de la métairie au moment où ils se livraient à quelque entreprise coupable, avaient voulu se débarrasser de témoins dont ils redoutaient la dénonciation. Un médecin de Pessac, village avoisinant, se rappela que, dans la nuit du 8 au 9, un inconnu était venu frapper à sa porte et avait insisté pour pénétrer dans sa demeure. Sur toutes ces données fort vagues, une battue générale fut entreprise dans un rayon assez vaste autour de la ferme, à travers les bois et les sentiers qui s’étendent sur plusieurs lieues du territoire. Toutes les recherches demeurèrent sans résultat.
Quelques circonstances, à première vue tout à fait accessoires, firent mettre alors en suspicion Jean Mano lui-même, et l’on se souvint de certains détails qui, sans portée pris isolément, paraissaient, réunis, fournir des charges, ou tout au moins des probabilités.
Mais comment accuser Mano, le facteur ?
Par des témoignages irréfutables, cet homme démontrait que, parti de Tastous le 9 avril, de grand matin, pour commence sa tournée, il était arrivé à Barp, centre postal, au cours de l’après-midi. C’est à Barp qu’il avait dîné et passé la soirée dans un cabaret avec plusieurs personnes de la localité. Vers onze heures, il avait été se coucher dans une écurie proche de l’auberge, ainsi que lui arrivait assez souvent. Un gars qui avait pénétré dans l’écurie le 10 a quatre heures du matin, l’avait vu. Or, c’est à quatre heures du matin que les premières investigations paraissaient désigner comme l’instant précis du crime. Le Barp est distant de la ferme de Tastous de quatre kilomètres et demi environ. L’alibi de Jean Mano semblait donc clairement démontré.
Le 14 avril, néanmoins, « l’homme de lettres », comme on l’appelle dans pays, était mis en état d’arrestation et dirigé sur la prison du fort de Hâ, à Bordeaux.
Le 12 avait eu lieu, au milieu d’une foule recueillie, 1’inhumation des cinq victimes. On avait vu Mano se jeter éperdu sur le cadavre sanglant de sa femme.
Le 14, une investigation médicale exercée sur sa personne faisait découvrir des taches de sang. Ce sang avait jailli au moment du meurtre, disaient les experts. Ce sang s’était coagulé sur sa chair et sur ses vêtements au moment de la suprême étreinte du 12, affirmait Mano. L’accusé se remémora ensuite que, dans la dernière partie de la journée du 9 avril, il avait passé un instant chez un boucher de Barp, dans une cour où l’on avait égorgé un veau en sa présence.
Enfin, une analyse chimique opérée contradictoirement par les docteurs de Bordeaux et de Paris a amené cette conclusion que, tandis que des deux parts on a reconnu du sang de mammifère, constatation qui résulta principalement de la forme des globules sanguins mais tandis que les uns se croient certains d’être en présence de sang humain, les autres sont persuadés n’avoir affaire qu’au sang d’un quelconque quadrupède.
Pendant près d’une année, l’instruction, confiée à un magistrat éminent, M. Pichard de la Tour, s’est poursuivie ardente, tenace, infatigable.
Durant ce laps de temps, l’attitude de Mano, soit dans sa prison, soit en présence du juge, n’a pas varié un seul jour, imperturbable, indifférent à toutes les tentatives et comme insensible à ce rude labeur de la loi, dont sa tête est l’enjeu, le prévenu se renferme dans les dénégations les plus absolues.
Dépêche télégraphique « Station de Marcheprime» 8 mars, 9 h soir
L’examen de la ferme de Tastous, des forets de sapins que traverse la route agricole, du chemin qui relie Tastous à Barp (4.300 mètres), des étapes qu’a dû parcourir l’assassin, présente les caractères les plus contradictoires.
Demain, plan détaillé des diverses parties de la métairie.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k591762f/f3n1.texteBrut
Cour d’Assises de la Gironde – audience du lundi 10 mars 1873
Aujourd’hui s’ouvriront, devant la cour d’assises de la Gironde, les débats relatifs au « massacre de Tastous », ainsi que les habitants du Barp appellent le drame horrible de la nuit du 9 avril 1872. Ce sera, à coup sûr, un des procès criminels les plus tristement célèbres que les annales judiciaires aient eu à enregistrer.
Depuis onze mois, le « massacre de Tastous », soumis aux lenteurs nécessaires d’une laborieuse instruction, préoccupe l’opinion publique, et la mise en jugement de Johannès Mano, l’assassin présumé, était attendue avec une anxiété fiévreuse.
Trois sessions criminelles se sont succédé depuis la date sinistre du 9 avril ; mais l’instruction n’était jamais assez complète. L’heure est enfin venue où le drame de Tastous va se dénouer.
Tastous est un lieu qui relève de la commune du Barp ; il est situé sur la route agricole de Marcheprime au Barp, à sept kilomètres de la première de ces deux localités, à quatre kilomètres et demi de la seconde.
La métairie où vivait la famille infortunée des Mano est sise à quelques centaines de mètres de la route, masquée par un massif de jeunes pins. Le pays est d’ailleurs fort désert ; on se trouve en pleine lande. La route se développe en droite ligne, à perte de vue, à travers une pinède immense. De métairies, presque point ; de villages, encore moins. Par intervalles, un pauvre toit de chaume émerge solitairement d’un semis de pins ; quelques bestiaux, le mufle à terre, tondent une herbe rare ; un berger taciturne, monté sur de longues échasses, tricote des objets de laine et garde le troupeau. Voilà tout le côté vivant du paysage.
Cet endroit semble prédestiné au crime : il y a soixante ans, non loin de là, une famille tout entière périssait une nuit, frappée par de mystérieux assassins, à la poursuite desquels se sont vainement fatigués pendant longtemps les gens de justice.
(Service télégraphique du Petit Journal.) Bordeaux, 10 mars 1872, 3 h. 1/2 du soir.
Depuis huit jours, le président des assises, M. le conseiller Habasque, est assailli de demandes de places.
François-Germain-Marie Habasque, né à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord) le 27 août 1817. Magistrat. Issu d’une ancienne famille originaire de la paroisse de Plougasnou, évêché de Tréguier, qui figure dans les Réformations de 1427 et de 1543 et dont les armes sont d’or à deux lions de gueules l’un sur l’autre. Il était fils de M. Habasque, président du Tribunal civil de Saint-Brieuc, littérateur distingué, chevalier de la Légion d’honneur et de Mme Eulalie Boullé, fille du baron Boullé, préfet des Côtes-du-Nord, sous le premier Empire. Lui-même avait épousé, en 1840, Mlle Amélie Ducrest de Lorgerie. M. Habasque exerça d’abord avec distinction la profession d’avocat au barreau de Saint-Brieuc et y devint, membre du Conseil de l’Ordre. En 1846, il publia les Usages et Règlements locaux des Côtes-du-Nord, en collaboration avec un de ses confrères, M. Antoine Aulanier. Cet ouvrage destiné à un durable succès, fut, après concours, honoré d’une médaille d’or, par le Conseil général des Côtes-du-Nord. Cependant, désireux de suivre une carrière où plusieurs des siens s’étaient déjà distingués, M. Habasque voulut entrer dans la magistrature et il y débuta, en 1848, comme juge-suppléant au Tribunal de Nantes, où il devint bientôt substitut. Très apprécié dans cette ville pour son mérite professionnel et ses qualités sociales, il y fut membre de la Société académique, délégué cantonal et l’un des directeurs de la Caisse d’épargne. Nommé, en 1856, procureur impérial à Angoulême, il quitta, en 1861, ce poste pour celui de substitut du procureur général près la Cour d’appel de Bordeaux. Conseiller à cette même Cour, en 1863, il ne tardait pas, grâce à la clarté et à la courtoisie de sa parole, à sa fermeté et à son impartialité dans la direction des débats, à se créer une véritable réputation comme président des assises. Il présidait sa quarante-quatrième session à Périgueux, lorsque, atteint par la loi sur la retraite, il quitta son siège, salué par une touchante et unanime manifestation du barreau. M. Habasque était, depuis 1880, doyen de la Cour de Bordeaux. Officier de l’Instruction publique en 1864, il avait été nommé chevalier de la Légion d’honneur en 1868. Conseiller honoraire, M. Habasque ne perdit rien de son habituelle activité d’esprit et s’attacha à suivre de près les questions d’économie politique et le mouvement historique. Il voulut réviser aussi, à la fin de sa carrière, le livre qui en avait honoré le début et, avec la collaboration de M. Buffé, conseiller à la Cour d’appel de Rennes, il remit au courant des lois nouvelles les Usages et règlements locaux des Côtes-du-Nord, dont la sixième édition, avec, une préface qu’il venait d’écrire, parut à Saint-Brieuc quelques jours avant son décès survenu à Bordeaux le 7 mars 1905, laissant deux fils.
Dictionnaire biographique & album de la Gironde
Dès le matin, de bonne heure une foule énorme envahit les abords du Palais de Justice. On discute dans les groupes sur les chances que court l’accusé. L’accès du Palais est difficile ; la circulation à l’intérieur ne l’est pas moins : le piquet de service a été renforcé ; des agents de police gardent celles des issues intérieures qui restent libres en temps ordinaire ; tout ce personnel de surveillance suffit à peine. Bien peu de curieux, cependant auront le privilège d’assister aux débats, car presque toutes les places ont été prises d’avance. L’enceinte réservée, les tribunes, le banc des avocats, ceux des jurés et des témoins, rien n’est resté inoccupé. L’hémicycle, où l’on a dû ménager un assez grand espace pour l’étalage des pièces à conviction, est nombre de chaises destinées aux personnes qui ont pu obtenir des places de faveur. Le fond de la salle reste seul à la disposition du public habituel, et l’entrée de cette catégorie de curieux s’accomplit tumultueusement.
À dix heures et quart, au moment où l’huissier annonce la cour, la salle est littéralement comble : beaucoup de dames dans les tribunes et dans l’hémicycle. La presse est largement représentée.
Quand le président prend place au fauteuil, un silence profond s’établit ; l’audience est ouverte.
L’avocat général Fauconneau-Dufresne occupe le siège du ministère public.
Monsieur Fauconneau-Dufresne, conseiller honoraire, admis depuis plusieurs années à la retraite, est décédé, le 24 mars 1913, à l’âge de 77 ans. Monsieur Fauconneau-Dufresne a appartenu, au titre de conseiller, pendant 13 mois, à la Cour de cassation, où il avait en quelque sorte recueilli un héritage paternel. Son père, magistrat des plus distingués, y avait, en effet, rempli les mêmes fonctions de 1861 à 1868. Marie-Émile Fauconneau-Dufresne, votre collègue, né le 26 août 1835, à Nantes, prête serment comme avocat stagiaire, le 3 décembre 1855, devant la Cour impériale de Besançon, dont son père était alors Premier président. Le jeune avocat se distingue immédiatement par son assurance, par sa parole, dont les présidents d’Assises signalent, à l’envi, la précision et la solidité. Aussi, dès qu’il en exprime le désir, les rangs de la magistrature lui sont ouverts.
Le 17 mars 1858, à 22 ans, M. Fauconneau-Dufresne débute comme substitut à Colmar. S’il faut en croire la légende, la manifestation de son talent dans une affaire importante fut l’origine d’une idylle qui, par le mariage, devait en faire l’allié d’une des plus puissantes familles industrielles de l’Alsace, la famille Herzog, fondatrice d’un empire industriel textile au Logelbach, quartier ouest de Colmar..
Substitut du procureur impérial à Strasbourg, puis substitut du procureur général près la Cour de Colmar, il est nommé, en 1864, à l’âge de 29 ans, avocat général près la même Cour. II lui faut alors, pendant quelques années, attendre la consécration de l’âge ; mais les rapports de son procureur général montrent combien ces années furent laborieuses. C’est à Colmar que le surprirent la Guerre de 1870 et la chute du régime impérial. Il connut, avec une intensité particulière, l’angoisse de l’invasion, l’amertume des défaites et les préoccupations de l’avenir. Dans ces jours cruels, le courage du magistrat et du patriote ne faiblit point. Le 18 janvier 1871, son attitude fière et digne provoque son expulsion d’Alsace, avec celle de sa femme et de ses enfants.
Le 14 juin 1872, M. Fauconneau-Dufresne reprend à la Cour de Bordeaux, les fonctions d’avocat général.
Appelé, en 1873, à la direction du Parquet de Marseille, et nommé, en 1874, procureur général près la Cour de Nancy, il ne demeure que trois ans dans ces dernières fonctions. Des considérations de famille l’attirent à la Cour de Paris. Conseiller, au mois de juin 1877, puis président de chambre à cette Cour, il prend rang parmi vous, le 12 janvier 1895. Monsieur Fauconneau-Dufresne a fait partie de votre chambre civile jusqu’au 13 janvier 1908, date à laquelle, sur sa demande, il était admis à la retraite et nommé conseiller honoraire. Il obtenait, en même temps, comme l’avait déjà obtenu son père, son élévation à la dignité de commandeur de la Légion d’honneur. Par son exactitude, par l’attention et l’application soutenues qu’il apportait à l’accomplissement de ses devoirs, par sa bonhomie, M. Fauconneau-Dufresne avait su inspirer à ses collègues une grande estime et une affectueuse confiance. »
Extrait du discours de monsieur Armand, Michel Rambaud, avocat général à la Cour de cassation (audience solennelle de rentrée du 16 octobre 1913)
Me de Brezetz siège seul au banc de la défense ; devant lui, à côté d’un recueil de lois, est un énorme dossier, celui du procès, qui ne contient pas moins de 1 081 pages d’expédition.
Ce pourrait être Jean Antoine “Théophile” de Brezetz, né le 30 août 1819 – Bordeaux, décédé le 4 juillet 1882 – Château Boismartin à Virsac, 33240, Avocat à Bordeaux, conseiller municipal de Virsac (1875), ou Eugène Marie Martin, Baron de Brezetz, né le 24 août 1829 à Bordeaux.
Sur le réquisitoire de M. l’avocat général, la cour ordonne l’adjonction d’un assesseur et de deux jurés supplémentaires. M. Albert Maison, interprète, est introduit dans la cause à reflet de traduire fidèlement les dépositions faites pendant les débats dans les divers idiomes de la contrée.
Grâce à la prévoyance de M. le président, les représentants de la presse occupent une table spéciale placée au milieu du prétoire.
On introduit l’accusé, Johannès Mano ; Johannès Mano est de taille moyenne, brun, vigoureux, bien pris et d’apparence placide. Il est vêtu comme le sont les campagnards du pays. Il boite légèrement. Sa figure exprime l’entêtement et l’audace. La tête est légèrement enfoncée dans les épaules et habituellement penchée de telle sorte que le menton touche la poitrine. L’œil est gris, enfoncé, un peu en dessous. Ce qu’il y a de particulièrement remarquable dans l’accusé ce sont ses mains effrayantes de longueur. Ses doigts rugueux, noués, spatulés, s’allongent indéfiniment. Des mains terribles, terrifiantes. Cet homme a pris de l’embonpoint dans la prison. Les joues, creuses il y a un an, se sont remplies ; le visage a perdu cette teinte halée commune aux travailleurs des campagnes. Mano, pâle et froid, est, à part cela, resté le même, en apparence indifférent de tout ce qui se passe autour de lui.
Le tirage au sort des jurés a lieu à dix heures et demie. La défense épuise, au cours de l’appel nominal, son droit de récusation, c’est-à-dire qu’elle récuse neuf jurés sur trente ; le ministère public en récuse cinq seulement.
Précédemment, le président avait assermenté un habitant du pays de Lugos, M. Albert Maisan, directeur de forges, comme interprète : on sait, en effet, que plusieurs des témoins qui vont déposer dans cette affaire, ne parlent que le patois de la lande.
Le maître de forges
Au bord des ruisseaux.
Il y avait des forges.
À Puntet. Monsieur Maisan
Qui fut maire de Beliet
Pendant vingt ans,
et fit bâtir notre église,
En l’année 1857, en mars,
Sa construction dura deux ans.
Monsieur Maisan était aussi
Maitre de forge.
Il y avait là aussi une fonderie.
Il y avait au Pontricot,
La grande forge qui a gardé le nom.
Les fonderies étaient à Belin-Beliet.
Fonderie Maisan,
Monsieur Cazenave,
Fonderie Destang, au Moura,
Et fonderie Julien Destang.
Peu à peu, au cours des années,
Trois ont fermé.
Seule, pour le moment.
La famille Labarbe
Avec la fonderie Julien Destang
Les Cahiers d’Éliette : histoires d’ici et d’antan, Éliette Dupouy, 1997
Tous ces préliminaires d’audience accomplis, M. le président ordonne la lecture de l’arrêt de renvoi et de l’acte d’accusation :
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que, dans la nuit du 9 au 10 avril 1812, à la métairie de Tastous, commune du Barp, un homicide volontaire a été commis sur les personnes de : […]
Attendu que les victimes n’avaient pas dû être frappées par un étranger, car un chien très vigilant n’avait pas aboyé ;
[…] Attendu que la rumeur publique a immédiatement désigné aux soupçons de la justice Jean Mano, dit Johannès, gendre, mari et père des victimes, lequel, depuis longtemps, donnait à sa famille les plus graves sujets de mécontentement ; qu’il était adonné au jeu et à l’ivrognerie, vivant dans les cabarets, ne rentrant qu’à des heures fort avancées de la nuit, et que l’on n’ignorait point qu’aux reproches mérités qui lui étaient souvent adressés, il répondait toujours par des menaces qui avaient éveillé, surtout dans l’esprit de sa belle-mère, les plus vives alarmes ;
[…] Attendu que Mano prétend n’être point rentré à Tastous depuis le 9 avril au matin, et avoir passé toute la nuit du 9 au 10 dans l’écurie de M. Marthiens, où, vers 5 heures du matin, il fut trouvé étendu sur des bottes de foin ; que cette affirmation est démentie par la constatation de ce fait nettement établi : dans la journée du 9 avril, Johannès Mano était vêtu d’un pantalon bleu pointillé de blanc, et le 10 au matin, il était trouvé, au Barp, porteur d’un pantalon de couleur noirâtre, tandis que le pantalon bleu était saisi dans l’une des chambres de la métairie de Tastous ; qu’il a été constaté que ce pantalon bleu, formellement reconnu pour être celui dont Johannès Mano était vêtu dans la journée du 9, avait dû être lavé, et que, malgré le lavage, ce pantalon portait encore des traces laissées par les taches brunes très apparentes et qui n’existaient pas dans la journée du 9 avril ; que Mano portait également, le 9 avril, une blouse bleue à collet rouge, sur laquelle on a trouvé des taches de sang produites par un jaillissement ; que les réponses faites par Johannès Mano pour expliquer ces taches, dont il ne conteste pas l’existence, sont inadmissibles et contredises par les témoignages ;
Attendu qu’après l’arrestation de Johannès Mano, le jeune Bernard Mano a déclaré, spontanément et à diverses personnes : que son père était venu à Tastous dans la nuit du crime ; qu’il l’avait parfaitement reconnu ; qu’il l’avait vu entrer dans la chambre où il reposait avec son petit frère et placer sur un coffre un pantalon ensanglanté ;
Qu’à la vérité, confronté avec son père, Bernard Mano a modifié ses déclarations, et prétendu que l’homme qu’il avait vu n’était pas son père ; seulement, que cet homme ressemblait à son père ; mais que cette rétractation a été faite avec une hésitation et dans une forme telle, qu’elle doit être attribuée à la frayeur qu’a dû éprouver l’enfant, mis, pour la première fois depuis le crime en présence de son père ;
[…]
Que cette appréciation est justifiée tant par la déclaration que par l’attitude du jeune Bernard Mano, lors d’une seconde confrontation ;
Qu’en effet, mis de nouveau en présence de son père, il a formellement déclaré : que celui-ci était bien réellement venu à Tastous dans la nuit, du 9 au 10 avril ; qu’il avait eu une querelle avec sa mère ; qu’après cette querelle, il avait vu frapper à mort ses parents ; qu’il était ensuite entré dans la chambre où son frère et lui étaient couchés, et qu’il avait déposé un pantalon bleu sur le coffre après avoir essayé de le faire passer entre la muraille et un moulin à bras ;
Attendu qu’il existe, dès lors, contre le prévenu charges suffisantes des faits qui lui sont imputés et qui constituent le crime prévu par les articles…, etc.;
« La cour déclare qu’il y a lieu à accusation contre Jean Mano, dit Johannès, âgé de vingt-neuf ans, cultivateur et ancien facteur rural des postes, né à Saugnac-de-Mont-de-Marsan (Landes), le 27 juillet 1843, et le renvoie devant la cour d’assises de la Gironde pour y être jugé selon la loi.
Fait et prononcé à Bordeaux, en chambre des mises en accusation, le 30 novembre 1812. » (Suivent les signatures.)
Le greffier donne ensuite lecture de l’acte d’accusation. Cette pièce est ainsi conçue : Le procureur général près la cour d’appel de Bordeaux, Vu l’arrêt rendu le 30 novembre 1812 par la cour d’appel, chambre des mises en accusations, qui renvoie le nommé Jean Mano, dit Johannès, devant la cour d’assises de la Gironde, comme accusé d’assassinat.
Acte d’accusation
Les jurés prêtent une oreille attentive à la lecture de l’acte d’accusation.
La métairie de Tastous, appartenant à M. Marthiens, est située dans la commune du Barp, en pleine lande à cinq kilomètres du chef-lieu et à quatre cents mètres de la route agricole, qui relie cette localité à la station de Marcheprime (sur la voie ferrée de Bordeaux à Arcachon.)
La maison affectée au logement des colons est de pauvre apparence et très isolée. C’est un simple rez-de-chaussée, composé de quatre petites pièces, ayant sa façade sur une sorte de clairière plantée de ̃quelques grands arbres.
De chaque côté de l’habitation et un peu en avant, a une distance de dix à douze mètres, se trouvent deux bâtiments l’un au midi, divisé en plusieurs compartiments, sert de grange, d’écurie et de remise l’autre, vers la nord, est un fournil, près duquel on aperçoit une étable à porcs.
Au mois de novembre 1869, les époux Arnaud Mano étaient venus s’établir sur la propriété de M. Marthiens. Leur fils les y avait accompagnés. Mais ce jeune homme étant mort l’année suivante, ils recueillirent auprès d’eux leur fille Jeanne, dite Manorine, et son mari, Jean Mano, dit Johannès. C’est en octobre 1870 que ces derniers vinrent s’installer à Tastous avec leurs trois enfants, dont l’aîné avait alors six ans à peine.
C’est en octobre 1870 que ces derniers (Jeanne, dite Manorine, et son mari, Jean Mano, dit Johannès) vinrent s’installer à Tastous avec leurs trois enfants, dont l’aîné avait alors à peine six ans.
Johannès Mano avait contracté, depuis quelque temps, des habitudes de jeu et d’ivrognerie qui le tenaient fréquemment éloigné du domicile conjugal. Nommé depuis peu facteur auxiliaire des postes, il dépensait dans les cabarets les émoluments de son emploi, et répondait aux sages observations de sa famille par des invectives grossières, quelquefois par des actes de violence envers sa femme.
Vers la fin de 1871, cette situation était devenue intolérable.
Les époux Arnaud Mano sont laborieux et, habitués aux plus durs sacrifices, supportaient avec peine l’oisiveté et les dissipations de leur gendre. Quant à la femme Johannès, devenue mère d’un quatrième enfant et se voyant à la charge de ses parents, elle souffrait de l’inconduite de son mari et faisait de vains efforts pour le ramener à une vie plus régulière. Depuis le mois de février cet état de choses, s’était encore aggravé : irrité des reproches incessants de sa femme, de son beau-père et de sa belle-mère, Johannès Mano ne gardait plus aucune mesure et faisait entendre des menaces qui épouvantaient la famille.
Des informations sûres ont été recueillies à ce sujet. La procédure, établit, en effet que la femme Arnaud Mario, profondément affectée des menaces de mort que prononçait son gendre dans l’intérieur de son domicile, en a fait à plusieurs reprises la confidence, ajoutant: « Qu’elle redoutait l’avenir qu’elle appréhendait quelque malheur et qu’elle, croyait l’accusé capable de faire un mauvais coup ! » Les menaces de Johannès Mano viennent démontrer, avec les autres éléments de l’information, que le dessein de donner la mort fut, à l’avance, arrêté dans son esprit.
Le 10 avril, vers six heures et demie du matin, le sieur Goujon rencontrait sur la route agricole les deux petits garçons de Johannès Mano. Dès que ces enfants aperçurent le témoin, l’aîné, âgé de sept ans, lui dit « Venez à la maison ma mère, ma grand-mère et mon grand-père sont morts. » Un quart d’heure après, le sieur Félix Romegous arrivait précipitamment au Barp, et faisait connaître que les époux Arnaud Mano, leur fille et petites-filles avaient été assassinés.
Johannès Mano est attablé dans l’Auberge du sieur Morillon, déjeunant en compagnie de plusieurs personnes. Tout à coup, un enfant, le jeune Henri Martin, vient lui annoncer la sinistre nouvelle. Les convives furent atterrés Mano, seul, ne manifesta aucune émotion, et se levant sans rien dire, sans demander aucune explication, il prit le chemin de Tastous.
Quelques habitants du Barp, un peu plus tard, l’accompagnèrent sur la route, on vit d’abord l’accusé marcher d’un pas ferme et rejoindre ses deux petits garçons puis tout à coup, au moment où il s’engageait dans une allée conduisant à la métairie, les témoins l’aperçurent qui chancelait et tombait sur le sol.
On s’empressa autour de lui, et des soins lui furent immédiatement prodigués mais où ne tarda pas à reconnaître que cet évanouissement était simulé. On transporta Johannès dans l’habitation du sieur Maurice Mano, à 300 mètres environ de la métairie Marthiens.
Pendant ce temps, la foule affluait à Tastous. Les premiers arrivés étaient témoins d’un spectacle horrible.
[Ici la description de la position des cadavres]
Quel était l’auteur de ce quintuple assassinat ?
L’opinion publique hésita d’abord. Mais cette hésitation ne dura qu’un instant, et ceux qui se rappelaient les sinistres pressentiments de la femme Arnaud Mano, ressentirent cette conviction intime que l’assassin était Johannès.
Personne ne songea à un étranger. La famille Mano n’avait point d’ennemis parmi ses voisins, ce qui exclut toute idée de vengeance.
La maison n’avait été ni fouillée ni spoliée ; tous les objets de quelque valeur, linge, montre d’argent, provisions de bouche, étaient encore à leur place habituelle donc le mobile du crime n’avait pas été le vol.
D’autre part, un étranger n’aurait pu pénétrer dans la métairie et ses dépendances sans éveiller immédiatement les alarmes des habitants, et sans provoquer les aboiements du chien de garde, qui cependant n’a pas aboyé dans la nuit du 9 au 10 avril.
Johannès Mano ne devait pas tarder, par son attitude, à fortifier les soupçons dont il était l’objet. Vers quatre heures du soir, les magistrats le trouvent couché dans la maison de Maurice Mano. Il feint d’être malade et prétend ne pouvoir se tenir debout mais, sur un ordre sévère du capitaine de gendarmerie, il se décide à se lever et à suivre à la métairie de Tastous les représentants de la justice. Arrivé sur le lieu du crime, Johannès ne manifeste aucune émotion il se borne à s’enquérir des nouvelles de sa belle-mère qui, transportée sur un lit, agonisait ; et, sous le coup d’interpellations pressantes, il garde constamment la même attitude, attentif à se défendre jamais ému, et niant avec résolution les faits les mieux établis
Une fois cependant, il parut troublé : c’est le 12 avril, lorsque, après une nouvelle inspection des outils de la métairie, M. le maire du Barp découvrit dans la grange un pic dont le manche paraissait taché de sang et sur la douille duquel on apercevait quelques cheveux. À la vue de cet instrument, Mano pâlit, et son trouble fut remarqué par tous les assistants. La préoccupation constante de Johannès Mano, au cours de la procédure, a été d’établir que, durant la nuit du 9 au 10 avril, il n’est pas rentré à la métairie de Tastous. Voici ses explications à ce : « Le 9, il a quitté Tastous vers neuf heures du matin, et il a fait sa tournée de facteur. Rentré immédiatement au Barp, vers deux ou trois heures de l’après-midi il a soupé et passé la soirée dans l’auberge du sieur Duprat, en compagnie de plusieurs personnes. Puis vers dix heures un quart, renonçant à rentrer chez lui, il est resté au Barp et a passé la nuit dans une dépendance de l’écurie de sieur Marthiens.
Il est très vrai que Johannès Mano a passé la soirée du 9 dans l’auberge du sieur Duprat, et qu’il s’est retiré vers dix heures un quart.
Il est encore vrai que le lendemain, à quatre heures et demie ou à cinq heures du matin, il a été, par le sieur Larue, vu couché dans l’écurie de M. Marthiens ; mais rien, absolument rien n’établit qu’il ait passé dans cette écurie tout le temps écoulé entre dix heures un quart du soir et quatre heures et demie du matin. Loin de là, des preuves irrécusables viennent démontrer que, pendant la nuit du 9 au 10, il a été à Tastous.
Un examen approfondi des faits a établi que le crime devait avoir été commis entre onze heures du soir et quatre heures du matin.
La famille Mano, les femmes surtout avait, en effet, l’habitude de veiller jusqu’à une heure fort avancée. Or, dans la matinée du 10, en voyant le rouet laissé à l’abandon près du foyer et les pelotons do fil jetés sur une table, on devinait aisément que l’épouse Arnaud Mano ne s’était pas couchée.
D’autre part, il ne faut pas oublier que la malheureuse femme était complétement vêtue et que sa fille commençait à peine à se déshabiller lorsque la mort est venue les surprendre. Or, l’information démontre que Johannès Mano a été à Tastous pendant la nuit du 9 au 10 avril. En effet, le 10 avril, à sept heures du matin, lorsque la nouvelle du crime s’est répandue au Barp, 1’accusé était vêtu d’un pantalon de couleur noirâtre. Mais, la veille, pendant toute la journée du 9, il portait un pantalon bleu, pointillé de blanc. Ce fait, d’une importance considérable, est surabondamment établi par de nombreux témoins : or, le pantalon bleu, porté par l’accusé pendant la journée du 9, a été découvert le 10 dans la maison de Tastous, encore humide et présentant, en même temps que des taches suspectes, les traces d’un lavage récent. Comment ce pantalon se serait-il trouvé là, si Mano n’y était pas venu ?
L’accusé a compris l’importance, capitale de ce fait. Aussi s’est-il efforcé de dévoyer, sur ce point, les investigations de la justice. Dans un de ses interrogatoires, il prétend d’abord que, le samedi saint 30 mars, après diner, ayant sali son pantalon bleu en plumant une dinde, il l’a fait laver par sa femme et ne l’a plus porté depuis cette époque. Mais il est démontré que le 30 mars une dinde n’a pu être plumée par lui, puisqu’il était absent de son domicile, et alors il allègue, mensongèrement, que ce fait a eu lieu le vendredi-saint 29 mars, et que c’est de ce dernier jour qu’il a voulu parler.
Johannès Mano, le 10 avril, portait aussi une blouse bleue à collet rouge. Ce vêtement saisi sur sa personne, est maculé de sang. Interrogé sur l’origine des taches constatées, l’accusé n’a pu que donner des explications contradictoires, lesquelles ont été, dans la suite, démenties par l’information.
À ces charges accablantes, un dernier incident est venu ajouter une charge de plus. On le sait, les deux petits garçons ont seuls échappé à la catastrophe que les habitants du pays appellent le « Massacre de Tastous ». Le plus jeune de ces garçon n’a que trois ans, et la justice n’attendait de lui aucune révélation. Mais l’aîné, âgé de sept ans, n’avait-il, comme il l’a prétendu d’abord, rien vu, ni rien entendu ? Couché avec son petit frère dans un chambre dont la porte était ouverte et communiquait avec le reste de la maison, avait-il pu rester paisiblement endormi au milieu des scènes sanglantes de la nuit du 9 au 10 avril ?
Ici, l’acte d’accusation reproduit les récits variés de Bernardin Mano. Il conclut, enfin, à la comparution de Jean Mano, sous l’inculpation d’avoir, du 9 au 10 avril 1872, à Tastous :
1° Volontairement donné la mort au sieur Armand Mano ;
2° Volontairement donné la mort à Marie-Lévesque, épouse Arnaud Mano ;
3° Volontairement donné la mort à Jeanne Mano, dite Manorine, épouse Jean Mano ;
4° Volontairement donné la mort à Marie Mano ;
5° Volontairement donné la mort à Maria Mano.
Pour chacun de ces crimes, avec cette circonstance aggravante, que le meurtre a précédé ou suivi l’un des meurtres ci-dessus spécifiés ;
Avec cette autre circonstance aggravante, que le meurtre a été commis avec préméditation.
L’accusé écoute avec calme cette lecture, dirigeant de temps à autre ses regards vers les pièces à conviction placées devant la table du tribunal ; à mesure que se déroule le récit des faits énumérés dans ce document et qu’apparaît le rôle que joueront aux débats les pièces à conviction, les regards de l’auditoire se portent aussi, avec avidité, sur les objets nombreux, et pour la plupart encombrants, rangés au bas du prétoire.
Voici l’énumération de ces pièces :
Une caisse en bois blanc, contenant : le pic qui a servi à l’accomplissement des crimes, une blouse bleue, mi-usée, à collet rouge, une blouse coutil bleu rayé, un pantalon bleu à points blancs, une cravate en soie violette, un fragment de couvercle, une autre blouse ;
Une petite caisse renfermant: un marteau, un couteau, une paire de chaussettes, des cendres ; une lanterne ; une pelle; trois chaises ;
Un blutoir ; un coffre ; des fragments de la porte de la grange de la métairie de Tastous, et deux clés ; un sac contenant des vêtements et menus objets ayant appartenu aux victimes.
Ces pièces à conviction sont disposées de manière à faire comprendre aux jurés la scène de carnage.
D’ailleurs des plans détaillés des lieux leur ont été distribués.
Le blutoir et le coffre-fort étaient dressés contre le mur et occupent la place qu’ils avaient dans l’habitation par rapport aux cadavres des petites Mano, trouvés, on le sait à 1’intérieur du logis.
Des factionnaires sont placés auprès des pièces à conviction, afin que personne ne puisse les déranger ni les distraire.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5917646/f3.image.r=mano
Le théâtre du crime
Correspondance spéciale du Petit Journal, Le Barp, 8 mars 1873
Nous voici sur le théâtre du crime. Cinq kilomètres environ séparent Le Barp, village de 450 habitants, de Tastous, humble hameau de trois ou quatre feux. La station la plus rapprochée est Marcheprime, sur la ligne ferrée de Bordeaux à Arcachon mais la difficulté des communications oblige fréquemment à pousser jusqu’à la gare de Facture, où l’on trouve, selon les jours, soit un cheval, soit un véhicule.
Le trajet jusqu’à Barp s’effectue sur une route défoncée que bordent à droite et gauche, tantôt des plantations de sapins, tantôt la lande inculte, grise et déserte. Le paysage est sinistre. De loin en loin, un toit de chaume surgit, et le regard s’arrête navré, sur les murs légendés de quelque habitation d’aspect mélancolique.
C’est au Barp, ne l’oublions pas, que Johannès Mano a couché, la nuit du 9 au 10 avril ; c’est conséquemment, à une heure de chemin de la localité où reposait l’assassin présumé qu’a été commis le quintuple assassinat. À quel moment précis s’est accompli le meurtre ? À cette heure indécise, affirment les médecins experts, où il ne fait plus nuit et où il ne fait pas encore jour.
Précisons : d’après le calendrier – des P.T.T. –, le 10 avril le soleil se lève à 5 heures 16 minutes. Le crépuscule se place donc durant l’heure qui précède. Ainsi, ce serai entre quatre et cinq heures que les victimes auraient été frappées.
Sur quelle donnée s’appuie cette conclusion ? Sur l’autopsie des cadavres.
L’inspection intérieure des organes digestifs chez la femme Mano mère et la femme de Jean Mano, a démontré qu’aucun aliment n’avait été ingéré par ces deux personnes dans les six ou sept heures qui ont précédé leur mort. Le même résultat semble acquis en ce qui concerne les enfants. Dans l’estomac de Mano père on a trouvé un fragment de viande de porc, sans trace d’aucune autre sorte, preuve que le vieillard avait seulement la digestion plus difficile.
Or, la famille avait coutume de prendre le repas du soir vers neuf heures ; en ajoutant à ce chiffre les sept heures d’intervalle, on arrive exactement à quatre heures du matin. Mais si l’horrible attentat a été perpétré à quatre heures du matin, comment Jean Mano en serait-il l’auteur, puisque, à ce moment précis, il a été vu par un témoin, ainsi que nous l’indiquions, endormi dans la grange de la poste, au Barp ?
Cette grange fait partie d’une série de constructions qui, du temps des diligences, formait hôtel, remises, écuries, et où s’effectuait le service des relais. L’hôtel seul a survécu.
On aperçoit, en recul de la route, sa façade blanche sur laquelle se détachent les mots : « HÔTEL DE LA POSTE ». Un jardinet le sépare de la grange, qui s’élève à droite de ce corps de logis principal et d’où l’on peut, en traversant un enclos en arrière des constructions, gagner, sans passer par la grand-route, la route agricole qui mène à Tastous en allant rejoindre un chemin vicinal au bord duquel, à quelques centaines de mètres en avant du hameau, se trouve la métairie.
Il est essentiel pour le lecteur de saisir complètement la disposition des lieux, disposition dont les débats de cette mystérieuse affaire révéleront toute l’importance.
Des broussailles épaisses, des ajoncs rabougris, des brandes, dont les habitants du pays font du charbon de bois, des genêts de petite taille, et quelques arbres chétifs s’alignent à droite et à gauche de la route, sur le parcours du Barp à Tastous. La terre de ces landes est noire, argileuse la route qui serpente au travers forme seule un ruban de nuance gris-clair ; cette nuance est due au cailloutis qu’on affecte à l’entretien des voies carrossables.
Retenons avec soin cette différence de teintes, elle aura au procès une grave portée.
La métairie ou ferme da Tastous est la propriété de deux frères, MM. Marthiens dont l’aîné, médecin, est décédé il y a deux ans. Le docteur Marthiens était un bienfaiteur pour Mano, à qui il s’était toujours intéressé. Ce fut Mano, qui à sa mort, le mit dans le cercueil, et certaine circonstance, qui accompagna ce devoir funèbre, a donné lieu à deux versions qui démontrent à quelles divergences d’appréciation prête le caractère de l’homme qui va comparaître devant la justice,
La bière, trop étroite, avait peine à recevoir le cadavre. Mano 1’aurait alors, selon les uns, poussé du genou pour le forcer à entrer, et on l’aurait entendu proférer ces paroles : « Va! maintenant, je te tiens, et, ma foi! Tu ne tueras plus personnes ! » Suivant les autres, au contraire, il se serait précipité sur le corps, sanglotant et fou de douleur, en gémissant, à travers ses larmes : « Ah!-pourquoi n’est-ce pas moi qui suis là dis, au lieu de ta personne ! »
La ferme était habitée, depuis la fin de 1869, par Mano, le père, et sa femme. C’est un an après que leur fille Jeanne et leur gendre vinrent les y rejoindre.
Jeanne Mano ou Manorine n’avait pas épousé un de ses parents, comme on le pourrait supposer, grâce à la similitude de nom mais un homonyme. Le nom de Mano, équivalent limousin de Manet, diminutif du nom de personne d’origine germanique Man (Mano = homme) – pour une fois, Aimé ne me contredira pas –, est extrêmement répandu dans la région.
En s’établissant à Tastous, les deux jeunes époux arrivaient d’une commune voisine, où ils avaient vécu assez heureux jusqu’au jour fatal où un incendie avait dévoré tout leur petit avoir. On assure que, de ce jour, Jean Mano avait contracté des habitudes d’intempérance et était devenu un effréné joueur ; on prétend l’avoir vu risquer, sur une seule partie de cartes, jusqu’à 50 francs, somme fort élevée, si on la compare à ses ressources ; on ajoute, enfin, qu’il se livrait assez fréquemment à des actes de violence à 1’égard de sa femme et a des manifestations brutales envers ses vieux parents. Un fait complètement acquis, et que les débats mettront en évidence, c’est que la veille du crime, jusqu’à 10 heures du soir, l’accusé est resté à jouer dans un cabaret du Barp, tenu par le sieur Duprat, mais a manié les cartes sans risquer rien que de très faibles enjeux.
« Faisons-nous une manille, monsieur le maire ? » avait dit le facteur à M. Tastes. Tu sais, Johannès, avait répliqué Tastes, que je ne jouerai avec toi qu’une partie, où l’argent ne soit pas en cause.
La manille est une sorte d’écarté à quatre, qui passionne beaucoup les joueurs du pays et entraîne parfois des pertes considérables.
Et voilà comment le jeu était resté innocent.
L’établissement où se passe la scène porte pour enseigne : « DUPRAT, BOUCHER, AUBERGISTE, LOGE A PIED ET A CHEVAL »
Ensuite Hôtel Dulucq,
devenu “Le Résinier”, Christophe Bourrissoux est propriétaire des lieux depuis 2001
Le patron est aubergiste dans la pièce d’entrée, disposée en salle de cabaret ; il est boucher dans une autre pièce, faisant suite à la première, et au plafond de laquelle sont accrochés les animaux fraîchement tués. À la suite de cette deuxième pièce vient un auvent donnant sur une cour de derrière; sous cet auvent a lieu l’abattage, C’est là que Mano aurait, dans l’après-midi du 9, regardé saigner un veau et reçu, par mégarde, quelques gouttes de sang. Ainsi, pour cette journée, on sait pour ainsi dire heure par heure l’emploi du temps : le matin, il part de la métairie de Tastous vers six heures, pour entreprendre sa longue tournée de facteur rural ; entre deux et trois heures sa tournée est finie, et on le voit au Barp ; il y passe la soirée à l’auberge Duprat ; puis, entre dix et onze heures, il va s’étendre, dans un chenil attenant à l’hôtel de la Poste : il y est aperçu à quatre heures du matin. Pour que Mano soit le coupable, i1 faut qu’entre onze heures du soir et quatre heures du matin, il ait furtivement quitté son gîte, ait franchi les cinq kilomètres qui séparent Le Barp de Tastous, ait accompli les cinq meurtres et soit venu reprendre sa place, après un nouveau trajet de cinq kilomètres, rentrant dans l’enclos de la poste comme il en était sorti, c’est-à-dire sans être vu ni entendu.
Comment se dénouera cette inextricable situation ? Quelle main habile écartera le voile qui cache la vérité ? Les dispositions intérieures de la métairie n’ont amené que de minces découvertes ; l’examen des victimes a dérouté la perspicacité des magistrats ; chacun des cinq cadavres a gardé son secret.
Afin de nous rendre compte de la position des cadavres, examinons en détail la situation des diverses parties de la métairie : l’habitation n’a qu’un rez-de-chaussée ; ç’est une construction carrée dont les murs extérieurs sont peints en jaune et la toiture couverte en tuiles. Elle comprend quatre pièces d’égales dimensions ; à gauche, en entrant, la cuisine, et en arrière de celle-ci la chambre des vieux Mano ; à droite, la chambre des petites filles et des époux Johannès Mano, et en arrière de celle-ci la chambre des petits garçons, servant aussi de chambre de débarras.
Une maigre bordure d’arbres longe l’ensemble de la ferme, que n’abrite aucune clôture extérieure. Ces arbres sont des pins grêles et espacés, dont quelques-uns portant la marque de l’incision pratiquée sur l’écorce pour l’écoulement de la résine, que recueille un petit pot de terre suspendu au tronc, ont vraiment l’air de pleurer toutes les larmes de leur corps.
Si le site n’était par soi-même lugubre, cette végétation de cimetière suffirait à créer l’illusion. Il est impossible de contempler ce triste décor sans convenir qu’il était prédestiné à quelque acte terrible.
Le cadavre du père Mano était sur le bord, à droite du sentier qui conduit à la métairie.
Les cadavres des femmes Mano et de Jean Mano étaient en avant de la grange-étable. Ceux de la _plus jeune des filles et de la fille aînée se trouvaient dans l’habitation.
Après nous être étonnés de la lenteur d’une instruction qui n’aura pas duré moins de onze mois, jour pour jour, du dix avril au dix mars, nous devons reconnaître que l’œuvre de la justice était hérissée de difficultés.
Mano, deux fois relaxé après interrogatoire, eût été même, sans doute, définitivement rendu la liberté sans la découverte fortuite, on peut le dire, des indices auxquels nous faisions allusion plus haut. Quelque minimes qu’ils puissent sembler au premier aspect, ces indices ont une valeur qu’il est impossible de nier. Sur l’un d’eux peut-être, un pantalon de toile bleue, repose entièrement le dénouement du procès. Il nous reste à faire connaître dans quelles circonstances étranges ils sont tombés aux mains du magistrat chargé de l’instruction et à indiquer le rôle que joueront aux débats, par suite de révélations toutes inattendues, les deux jeunes garçons du facteur Mano.
C’est aujourd’hui lundi 10 mars que commencent les débats de cette grave affaire. Notre service particulier nous permettra de publier demain matin l’acte d’accusation et le compte rendu de la première audience.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k591763t/f4.item.r=mano.zoom
L’interrogatoire de Johannès Mano
L’accusé répond d’une voix ferme aux premières questions que lui adresse le président.
Vos nom, prénoms, âge, lieu de, naissance, demeure et profession ?
Mano (Jean), trente ans, né à Muret, arrondissement de Mont-de-Marsan. le 26 juillet de Bernard Mano et de Marie Harribey ; facteur rural, demeurant commune du Barp. Veuf, deux enfants, sait lire et écrire, jamais condamné.
L’interrogatoire de Johannès Mano porte ensuite sur les faits antérieurs à la cause. M. le Président rappelle à l’accusé le temps où, célibataire, il habitait avec son père et sa mère, auxquels parfois il manquait de respect, s’il en faut croire la prévention.
Mano proteste ; jamais, affirme-t-il il n’a eu avec ses parents la moindre discussion. L’incident relatif au bienfaiteur de l’inculpé, le docteur Marthiens, que Mano mit au cercueil à sa mort, il y a deux ans, appelle de la part de Johannès une explication en contradiction avec l’avis du ministère public : j’ai été charpentier, dit-il, j’ai autrefois enfermé plus d’un mort dans la bière, personne ne voulait se charger de ce soin à l’égard de M. Marthiens. Je me suis offert à l’accomplir, et comme le corps résistait, j’ai dû le pousser à l’aide du genou et j’ai simplement dit en soupirant « En voilà encore un ! »
Le Président : À quel âge vous êtes-vous marié?
Mano : À vingt et un ans.
On avait cru que le mariage vous mûrirait ; au contraire, vous avez pris plus de goût pour le cabaret et plus d’éloignement pour le travail. Vous avez été obligé enfin de quitter votre père, cette vie commune vous étant devenue impossible.
Non, je l’ai quitté sans aucune discussion.
Où allâtes-vous de là ?
Au bourg du Barp.
Chez M. Duluc?
Oui.
Combien étiez-vous dans la famille ?
Trois enfants, ma femme qui était enceinte, et moi.
À quelle époque aviez-vous été nommé facteur ?
Il y a six mois.
Dans quels termes viviez-vous avec votre famille à Tastous ?
Je vivais en bonne intelligence.
Vous meniez cependant une vie de désordres ?
J’avais l’habitude du jeu et du vin, mais je ne faisais jamais de mal. Chaque fois que je rentrais un peu gris, on me grondait. J’avais dit que je voulais quitter mon pauvre beau-père et ma pauvre belle-mère.
Que gagniez-vous à la poste?
Je gagnais quarante-cinq francs.
Questionné sur l’usage qu’il faisait de ses émoluments, Mano répond : « Mon beau-père m’avait offert, moyennant trente francs par mois, de me loger et de me nourrir, moi et toute la famille. »
Le Président : Avez-vous toujours fourni cette somme ?
R – Oui ; le dernier mois seulement, je n’ai donné que vingt-cinq francs.
Le Président : Vous avez dit que vous étiez bien connu dans le pays. Eh bien ! l’impression de tout le monde vous y est très défavorable. On dit que vous étiez violent, que vous désertiez le domicile conjugal, que vous vous adonniez à l’ivresse et au jeu.
R – Violent, Monsieur le Président, c’est inexact ; si je découchais, c’était parfois pour mon service ; le vin et le jeu, je les aime, je l’avoue ; je buvais volontiers, le dimanche surtout, mais sans excès.
D – Cependant, vous faisiez chez vous des scènes. N’avez-vous pas frappé votre femme, brutalisé votre beau-père et votre belle-mère ?
L’accusé : Jamais. J’ai eu des raisons comme on en a souvent dans les familles. Mais frapper, mais brutaliser, non ! Une seule fois, dans une discussion, j’ai poussé ma pauvre femme ou dit des gros mots à ma pauvre belle-mère.
J’ai « touché » une fois ma pauvre femme ; j’ai eu souvent des raisons, mais voilà tout. Ma belle-mère n’avait pas peur de moi, car tous les dimanches elle m’attendait pour diner avec moi ; si je l’avais menacée, elle n’eût pas été si complaisante.
Le Président : Elle a confié cependant à plusieurs personnes que vous les aviez tous menacés à la maison ; et sa terreur était si grande, qu’elle alla jusqu’à dire un jour : « Johannès fera un mauvais coup. »
L’accusé : quand j’étais pris de vin, chacun se jouait de moi ; aucun témoin ne m’a jamais répété les paroles de ma pauvre belle-mère.
Que répondez-vous, cependant, aux amis qui ont reçu ces tristes confidences ?
Je ne peux répondre que non.
Mais vous avouez que vous buviez ; or on sait à quoi peut entraîner l’ivresse.
Jamais je ne m’abrutissais. Chez moi, le vin était gai et non triste; tout le monde vous le dira, on rigolait avec moi, et lorsque j’avais bu, j’aimais surtout à rire.
Cependant, vous vous plaigniez de votre cohabitation à Tastous. Un jour, au Barp, un an environ avant la date du crime, un jour qu’un témoin et vous avaient longuement mangé et bu ensemble, vous lui avez dit, confidentiellement : « Vois-tu, je mène une vie d’enfer à la métairie ; ils sont tous acharnés contre moi. Tiens si je ne craignais la justice, je tuerais tout. »
Je nie avoir tenu ce propos.
N’avez-vous pas, quelque temps avant le crime, parlé à un autre témoin de votre intention de quitter la métairie de Tastous avec vos deux garçons et d’aller vous établir à Bordeaux, laissant les deux filles à votre femme ?
J’avais en effet l’intention de chercher une place à Bordeaux. Je ne gagnais que 45 Fr par mois comme facteur rural. Mais si j’avais pu rester à Bordeaux, j’aurais fait un peu plus tard venir le reste de la famille.
Vous comprenez combien le propos que vous auriez ainsi tenu serait grave, rapproché des meurtres où les filles ont succombé, tandis que les garçons étaient épargnés ?
Je crois que le meurtrier aurait fait périr les garçons tout aussi bien que les filles, s’il les avait trouvés, s’il avait connu leur présence.
N’anticipons pas. Voyons d’abord ce que vous avez fait dans la journée du 9 avril 1872 ?
Je suis parti de la métairie le matin à six heures ; j’ai fait ma tournée de facteur ; j’avais fait vingt-cinq kilomètres. À trois heures j’étais au Barp, et à cinq heures j’entrais au cabaret de Duprat avec un de mes amis, Tempié, dont je venais de faire la rencontre. Nous avons passé la soirée au cabaret jusque vers dix heures et demie.
Vous avez alors été vous coucher. Où avez-vous passé la nuit ?
Dans une grange, chez M. Périer, à la poste.
Et vous y êtes resté ?
Jusqu’au 10 avril au matin.
C’est donc pendant que vous dormiez paisiblement au Barp qu’était commise, chez vous, cette série de meurtres que l’on appelle dans le pays « Massacre de Tastous », massacre horrible en effet ? Qui, d’après vous, aurait accompli le crime ?
Si je le savais, je n’aurais pas fait onze mois de prévention.
Le Président saisit l’occasion pour expliquer combien une instruction, quelle que soit la nature ou la gravité de la cause, doit être consciencieuse ; il ajoute que, tout en déplorant les lenteurs inévitables des instructions judiciaires, on ne saurait les condamner, car elles sauvegardent les intérêts et de la société et de l’accusé lui-même.
Vous ne soupçonnez personne ?
Non. Je crois que les auteurs de l’assassinat étaient étrangers au pays.
On n’a vu personne, cependant.
Oui ! dans nos landes, il est si facile de se cacher. Derrière les pins ou dans les hautes bruyères, un homme peut se dissimuler pendant une semaine au besoin.
Mais un étranger, ce semble, serait arrivé armé ; il n’eût pas eu besoin d’emprunter pour le crime un outil à la ferme.
Eh ! qui vous dit qu’il n’y avait qu’un étranger ? Je crois, moi, qu’ils étaient plusieurs, car un seul individu n’eût pu tuer tout le monde sans qu’aucun parvint à s’enfuir.
Quel eût été, en ce cas, le mobile du crime ?
Le vol, peut-être, car je sais qu’il y avait une somme d’argent qu’on n’a pas retrouvée.
Il n’y a pas eu de meubles fracturés ; tout le linge a été retrouvé intact ; une montre d’argent restait à la place où elle était accrochée. On n’a pas retrouvé d’argent, il est vrai ; mais comment savez-vous qu’il y en avait ?
Eh bé ! moi-même j’avais donné 25 fr le jour d’avant, pour payer ma nourriture à mon pauvre beau-père ; il devait bien en outre y avoir une vingtaine de francs à la ferme, car on n’était pas sans le sou. Cela ferait donc 45 fr
Vous aviez un chien à Tastous, et ce chien, jeune et vigoureux, était fort méchant pour tous ceux qui n’appartenaient pas à la ferme. Or, ce chien n’a pas aboyé la nuit du crime ; il aurait aboyé si un étranger avait approché.
On aurait pu le tenir.
Ce chien vous était attaché ; il avait une haine tout particulièrement pour le nommé Larue auquel sans cesse il montrait les dents. Eh bien ! voici une circonstance que l’on a beaucoup remarquée dans le village. Le jour de l’enterrement des victimes, le chien a suivi jusqu’au cimetière, en gémissant, Larue et vous étiez du cortège. Au retour vous avez pris, Larue à gauche, et vous à droite. Eh bien ! le chien a pris à gauche avec Larue, qu’il détestait, au lieu de se diriger avec vous à droite.
Eh bé ! je ne suis pas dans les secrets des chiens, moi !
Où était la clef de la grange d’habitude ?
Derrière la porte, avec la clef de la maison.
Ordinairement, votre belle-mère, qui était une femme d’ordre, fermait la grange à clef, et accrochait cette clef à l’endroit que vous venez de désigner.
Oui, c’est vrai.
Le Président : Or, le lendemain du crime, la grange a été trouvée ouverte ; donc, il fallait savoir où se tenait la clef, pour l’avoir prise derrière la porte. Si des étrangers ont commis le crime, comment se sont-ils procuré la clef de la grange, qui était, la nuit, accrochée à l’intérieur du logis ?
L’accusé : Le coup a pu être fait le soir sur le tard avant le coucher, ou le matin au moment du lever. La grange a dû être ouverte par les femmes, car le crime a probablement été consommé le matin, et à cette heure, on allait voir si les poules et les poussins avaient besoin de quelque chose.
Le Président : mais il sera établi que le crime a été commis le soir.
Le Président : le cadavre de votre beau-père a été découvert à quarante mètres de la maison, sur la lisière du bois : on a pensé qu’il devait fuir. Mais, puisqu’il abandonnait les lieux, un voleur n’en aurait pas dû être gêné, et alors le vieux Mano n’aurait pas été frappé.
L’accusé : je crois qu’il a été tué le matin, au moment où il allait travailler.
Le Président : l’accusation dit que l’assassin veut faire croire que le drame s’est accompli, le matin, et que dans cette intention il a pu placer une pelle sous son bras. Mais le cadavre tenait cette pelle comme un soldat porte les armes, et cette position ne se constate guère sur les cadavres. D’ailleurs, l’instruction prouve qu’à cette époque votre beau-père n’avait aucun ouvrage à faire de ce côté-là.
Vous avez été trouvé le matin par Larrue, couché dans l’écurie, sur des bottes de foin ?
L’accusé : oui ; je dormais. Larrue m’a appelé. Un petit garçon, le fils d’Henri Martin, est venu le dire, et puis il s’en est allé de suite.
Quand vous avez appris la nouvelle, vous avez témoigné une insensibilité bien étrange.
On l’a prétendu ; la vérité c’est que le petit Henri Martin qui est venu me dire la chose avait déjà disparu lorsque je me suis dressé pour le questionner. Deux ou trois femmes ont répété la nouvelle ; j’ai couru, j’ai pris la route, et je suis parti.
Que vous soyez ou non l’assassin, Mano, il est singulier qu’un fils, un mari, un père, ait pu supporter avec sang-froid une pareille nouvelle.
Oui, je sais que des témoins ont osé m’incriminer parce que je n’avais pas parlé. Eh bé ! c’est plus fort que moi, Monsieur le président ; ce n’est pas que j’aie le cœur dur, mais jamais je n’ai pu verser une larme.
Le Président : votre petit garçon Bernard vous a rencontré.
L’accusé: oui, il m’a dit: « Pépé, mémé et maman sont morts ! » et nous avons marché ensemble.
On a assuré aussi que, chemin faisant, au moment où on vous apprenait que votre belle-mère respirait encore, vous avez feint de vous évanouir, On en a conclu que vous redoutiez une confrontation avec votre belle-mère ?
Je me suis évanoui réellement, sans ça j’y aurais été de bon cœur. Ah plût à Dieu qu’on eût pu me mettre en face de la pauvre malheureuse femme et la faire parler ! Je ne serais pas sur le banc de la cour d’assises !
On a supposé que votre évanouissement était feint, parce que, sur le chemin où vous étiez tombé, quelqu’un qui vous a donné à boire a remarqué que vous ingurgitiez facilement et non comme un homme dont on est forcé d’entrouvrir la bouche ?
Je ne sais rien de ce détail.
Quoi qu’il en soit, on vous a mis sur une charrette, et au lieu de vous mener à la métairie, on vous a conduit au hameau de Tastous et couché chez un habitant. Un peu plus tard, le capitaine de gendarmerie vous a fait lever et vous avez obéi à son injonction quand il vous a engagé à aller à la métairie aussitôt.
J’y ai été, mais en arrivant j’ai dû prendre une chaise, car je ne tenais plus debout.
On a remarqué à ce moment une particularité odieuse. Vous ne songiez qu’à votre sécurité personnelle et ne vous occupiez de rien autre.
Ah! quand on se voit l’objet de soupçons, il est difficile de se défendre d’appréhensions terribles. Les commissaires, les gendarmes, les juges sont toujours à craindre, qu’on soit coupable ou innocent.
On vous entendait dire à haute voix : « Ma pauvre femme! mes pauvres enfants ! mes pauvres parents ! » mais sur un ton froid, dolent sans conviction.
C’est ma nature d’être froid et d’avoir les yeux secs.
Les cadavres étaient à peine refroidis que vous vous livriez à un repas copieux ; vous avez coupé du lard pour étendre sur votre pain.
Du lard, oh non ! Le repas que j’ai fait n’a pas pu être lourd, car j’avais la gorge serrée.
Et cependant, avant même l’enterrement vous disiez à un de vos camarades: « Lundi, je reprendrai mon service. C’était une préoccupation qui manquait d’à-propos.
Dieu m’avait laissé deux enfants, je n’avais pas d’avances, ne fallait-il pas songer à leur donner du pain ?
La nuit qui a suivi les funérailles, le 12 avril, vous avez joué aux cartes au cabaret, et cet acte horrible a frappé tous ceux qui en ont été témoins.
Il faut se rappeler comment ça s’est passé. J’étais anéanti alors des camarades ont dit: « Faisons-le jouer, ça le divertira un peu. » J’ai tenu les cartes un tour, mais je n’ai pu continuer.
Passons à un autre ordre d’idées. Quand M. le maire du Barp a découvert le pic dans la grange, on vous a vu pâlir affreusement.
Comment aurais-je pâli ? Je n’étais pas là au moment de la découverte et quand je suis venu, pourquoi aurais-je pali ? Je n’ai à pâlir ni devant vous ni devant ces Messieurs (il désigne les jurés) et je crois que quand on est innocent, on est fort de soi-même.
Toute cette partie de l’interrogatoire produit une sensation profonde et prolongée. Jean Mano s’exprime avec une fermeté qui ne se dément pas un seul instant. Jamais il ne cherche ses termes, jamais il n’hésite dans ses réponses. Sang-froid, présence d’esprit, conviction de l’accent, cet homme a toutes les qualités qui dénotent une nature fortement organisée. Par instants, il étend les bras avec, des gestes pleins d’aisance ; on croirait qu’il plaide. D’autres fois, il ramène ses mains sur la poitrine et s’en frappe avec vivacité.
Nous arrivons au cœur même de l’accusation, et l’attention de l’auditoire redouble au moment où M. le Président aborde la question du pantalon :
Comment étiez-vous vêtu le 10 avril ?
J’avais un pantalon noir, une veste d’alpaga et un béret.
Depuis quand portiez-vous ce pantalon noir ?
Depuis plusieurs jours.
Vous assurez donc que vous l’aviez la veille ?
Oui, je l’avais sur moi le 9 avril.
L’accusation prétend le contraire ; elle a non pas un, non pas deux, non pas trois, mais dix témoins qui affirment et viendront dire ici que, le 9 avril, vous étiez vêtu d’un pantalon bleu.
Ces témoins se trompent ; la preuve qu’ils se trompent c’est qu’ils n’ont fait cette révélation que quinze jours après le crime ; comment, dès lors, pouvaient-ils se rappeler quel pantalon je portais ?
Je vois que vous comprenez l’importance de cette charge. Si vous aviez le pantalon bleu le 9, pour vous trouver le 10 avec le pantalon noir, il faut que vous soyez allé chez vous dans l’intervalle. Votre présence au Tastous la nuit du crime serait voire condamnation.
Je n’ai rien à craindre ; je n’avais pas le pantalon bleu le 9 ; voilà pourquoi on l’a trouvé le 10 à la ferme.
Ce pantalon était humide.
Il devait être à peu près sec ; il y avait huit jours qu’il avait été lavé.
Je crois, en effet, qu’il n’était que très légèrement humecté ; mais il offrait des taches de sang.
Cela ne m’étonne pas.
Quel était ce sang ?
Du sang de dinde.
Faites bien attention à vos réponses.
Monsieur le président, devant Dieu qui me voit et devant toute la compagnie, j’affirme, je jure que c’est du sang de dinde qu’on a trouvé sur mon pantalon bleu. On a trouvé du sang sur ma blouse également ; celui-ci était du sang de veau ou de mouton.
Mais à quelle occasion vous seriez-vous taché de sang de dinde.
En plumant une dinde, le jeudi ou le vendredi saint.
Dans l’instruction, vous avez dit le samedi ou le vendredi ; maintenant vous ajoutez le jeudi.
C’est que je n’ose affirmer un jour plutôt que l’autre.
D’ailleurs, il n’y a pas eu trace de sang de dinde à l’analyse chimique. La science a reconnu du sang de mammifère, c’est-à-dire d’animal portant mamelle ; le dindon est un volatile, c’est-à-dire un ovipare. Quant au sang de veau ou de mouton, comment aurait-il jailli sur vous ?
Pendant que j’étais dans l’abattoir de Duprat.
Mano allègue qu’il a aidé le boucher à tuer des animaux, et que le sang découvert sur ses manches y était arrivé par jaillissement. Il entre dans des détails qui concernent le métier de boucher, et s’efforce de prouver que quand on souffle un animal saigné de frais, il y a forcément des éclaboussures. Il demande qu’une expérience soit faite chez le boucher du Barp.
Nous verrons les rapports des médecins ils affirment que le sang ne jaillit pas ainsi à l’abattage.
Faites des expériences ; j’ai déjà engagé M. le juge d’instruction à en faire à ce sujet.
Le Président : On a trouvé en outre, au-dessus de votre poignet gauche — vous êtes gaucher — une tache de sang qui avait produit des éclaboussures.
L’accusé : Je ne suis pas gaucher, ce sang m’est venu quand j’ai embrassé ma pauvre femme.
Mais si cela était ainsi, vous eussiez eu une tache écrasée, trainée, produite par le frottement, et non par le jaillissement. Et puis, écoutez bien, Mano, voici un fait grave depuis le crime du 9 avril, votre enfant était triste et taciturne. Du jour qu’il était aux champs avec quelques personnes, on le vit aiguiser un couteau ; il ne disait rien. On lui demanda : « Pourquoi aiguises-tu ainsi ce couteau ? » Et votre enfant répondit : « Pour tuer papa ! Et pourquoi veux-tu tuer ton papa ? répliqua-t-on. « Parce qu’il a tué maman ! »
Passons à ce qui concerne vos enfants, vos petits garçons, dont le plus jeune, âgé de 3 ans, n’a pu éclairer la justice, mais dont l’ainé, aujourd’hui âgé de 8 ans, a fourni à l’instruction des données bien explicites.
Ah le pauvre petit, il s’est laissé endoctriner par des gens intéressés à me perdre.
Qui donc lui aurait fait la leçon ?
La femme Catherine Beiris, qui avait de la haine contre moi. Comment, sans cette circonstance, le petit serait-il resté quatre mois sans parler, pour venir tout à coup raconter à la justice tout ce qu’on lui a fait dire ?
Voici un fait : un jour, dans un champ, on a vu votre fils Bernardin occupé à aiguiser un couteau : « Pourquoi ce couteau ?» lui a-t-on demandé. «C’est, a-t-il répondu, pour tuer papa qui a tué maman. »
Ça venait de Catherine Beiris.
Autre chose : l’enfant a été recueilli chez son oncle, lorsque la ferme a dû être évacuée ; un matin, il tenait un bâton et son oncle lui dit « Pourquoi ce bâton ?» Il répliqua « C’est pour battre papa qui a tué maman. »
Long mouvement d’horreur et exclamations au fond de l’auditoire et dans les deux tribunes supérieures occupées par les dames. Le silence rétabli, M. le Président, avec une grande précision dans les détails, une modération pleine d’impartialité, et dans un langage ferme et serré, retrace une à une les diverses dépositions de Bernardin Mano, les contradictions qu’elles offrent et les conséquences qu’il est nécessaire de tirer de chacune d’entre elles.
Habasque rend un hommage public à la conscience avec laquelle l’instruction a été poursuivie par M. de Pichard. L’impression générale, néanmoins, est que les particularités qui se rapportent à cet épisode d’un si haut intérêt dans la cause, ne seront pleinement dévoilées que lorsque le fils de l’accusé comparaîtra à la barre des témoins.
Nul ne peut prévoir quels résultats amènera alors une confrontation publique entre le père et l’enfant.
Quand Mano se rassied, toujours pâle, impassible, ne portant, d’autre trace des fatigues de ce long interrogatoire que quelques gouttes de sueur qu’on voit perler à son front.
Il est courageux, murmurent ceux qui le croient innocent.
Il est bien fort ! se disent à l’oreille ceux qui le croient coupable.
Il est environ deux heures et demie. L’interrogatoire a duré près de trois heures.
Audience du lundi 10 mars 1873 – Audition des témoins
Après une suspension de vingt minutes, l’audience est reprise, et, à trois heures, commence l’audition des témoins.
L’huissier introduit M. le juge de paix de Belin. C’est le premier des cent cinq témoins dont le ministère public a cru devoir fortifier l’accusation. Disons au début que, durant la longue succession des témoignages qui vont se produire, le public de l’audience devra subir la répétition de la plupart des griefs déjà connus.
M. Cazeaux dépose en substance que, prévenu par deux dépêches expédiées à Belin coup sur coup par le maire du Barp le 10 avril 1872 au matin, il s’est rendu sur les lieux, et qu’il a pu voir dans toute son horreur le spectacle qui s’offrait aux habitants épouvantés de la commune du Barp ; ce magistrat est le premier représentant de la justice qui se soit rendu sur le lieu du crime.
« Il y avait déjà à Tastous quatre ou cinq cents personnes, dit Cazeaux. J’ai commencé 1’inspection des lieux, et j’ai pu me convaincre que le crime avait dû être commis entre onze heures et minuit. En effet, le lit de Manorine dans la chambre des jeunes époux, n’était pas défait ; la place de la pauvre femme était encore arrondie, elle n’avait subie aucune dépression : d’où je conclus que Manorine ne s’était pas couchée.
Dans le lit des vieux Mano, une seule place était marquée ; donc, un des vieux époux ne s’y était pas encore introduit.
Dans la cuisine, le dévidoir n’avait pas été rangé, et les pelotons de fil gisaient à terre, éparpillés ; des tisons éteints s’étaient abattus, dans le foyer, en dehors des chenets ; d’autres objets avaient été laissés à terre.
Toutes ces choses irrégulières me donnèrent l’idée que les gens de la maison avaient dû être troublés dans leurs occupations par un dérangement subit, imprévu. Pendant que le cadavre d’Arnaud était étendu sur le sentier, le chien de la métairie se tenait près du corps. Je demandai à un voisin si la bête était méchante ; il me fut répondu qu’elle aboyait toujours, mais que cette nuit-là elle n’avait pas été entendue. »
M. Cazeaux entre dans le développement des présomptions qui assaillirent l’esprit des assistants, et il montre que Johannès Mano fut aussitôt soupçonné par tout le monde.
Répondant à une question du défenseur, qui lui demande si on a fait des fouilles pour retrouver l’argent, Cazeaux répond : « Une montre, qui était en évidence dans la chambre des vieux Mano, a été respectée. Je n’ai point fait de perquisitions. Quant au fait du linge éparpillé, c’est tout simplement un simulacre de vol, fait par le meurtrier pour dérouter la justice. Et la preuve, c’est que les paysans cachent d’ordinaire leur argent — quand ils le mettent dans les armoires —, derrière les dernières piles de linge, et non sous les premières. Or, il n’y a que les premières piles qui aient été éparpillées. Un voleur eût assurément poussé plus loin ses recherches. »
Il dit les suppositions que provoqua chez lui la présence du chien qui, n’ayant pas aboyé, avait dû conséquemment être connu du meurtrier. M. le juge de paix poursuit : Je partageai aussitôt la manière de voir du maire de Barp, qui me dit : « Ce ne peut être que quelqu’un de la famille. » Nous causâmes alors de Jean Mano, que, quant à moi, je ne connaissais nullement. Apprenant que Mano était à Tastous, où on l’avait conduit le matin en charrette après son évanouissement, je me rendis de la métairie au village et trouvai Johannès couché chez un fermier du villageois Roumégoux.
Ce ne fut pas sans étonnement que je vis en pareil lieu cet homme dont presque toute la famille venait d’être massacrée. Je remarquai que sa chemise était pleine de sueur ; il me dit qu’il la portait depuis le dimanche et qu’il avait marché beaucoup.
C’est moi qui ai pris l’initiative de m’assurer d’abord de la personne de Mano. Il ne paraissait pas inquiété des victimes, mais de son propre sort. « Pauvre père, pauvres femmes, on va me mettre en prison! » Cette attitude me frappa. À mon avis, le crime a été commis avant le coucher ; les cadavres des femmes semblaient le démontrer ; Manorine était nu-jambe : j’ai retrouvé ses bas dans la chambre où elle devait être à se déshabiller avant le crime et à côté des bas était un jupon tombé sans doute de sa main pendant qu’elle fuyait.
M. le Président : Un rapport médical affirme que la digestion était consommée à l’heure des meurtres ; savez-vous à quel moment les paysans prennent leur repas du soir et si ce repas se compose d’aliments d’une digestion facile ?
M. Cazeaux : Le souper des paysans a lieu à la tombée de la nuit ; il se compose, généralement de lait, de cruchade, farine de maïs ou de seigle bouillie dans l’eau et salée, enfin d’un morceau de lard de très petite dimension, car il faut que dans une famille un cochon dure toute l’année ; pas de vin. J’estime qu’il faut trois heures pour digérer complétement ces aliments chez nos paysans dont l’estomac est excellent.
M. le Président : Mano, vous entendez ce que dit le témoin ; qu’avez-vous à en dire ?
L’accusé : Je ne demande qu’une chose. Comment fait le juge de paix pour avancer tout cela ?
M. le Président : Il fait comme tous les hommes intelligents qui jugent avec les éléments qu’on leur donne.
Me de Brezetz : Le témoin a-t-il constaté que le vol ait été le mobile, du crime ?
M. Cazeaux : il n’y avait pas d’autres traces, à cet égard, que des vestiges simulés que je considère comme l’œuvre d’un coupable qui a voulu faire croire à la justice qu’il y avait eu intention de vol.
Une discussion de détails locaux s’engage, mêlée d’interruptions et de demandes : il s’agit de savoir si une lumière, placée dans la chambre des vieux Mano, aurait assez de projection dans celle des enfants pour leur permettre de voir ce qui se passerait dans leur chambre.
M. Cazeaux : je n’ai pas fait d’essai à cet égard ; cependant il me semble que le sens dans lequel s’ouvre la porte de la chambre des enfants, la position qu’occupaient les meubles de cette chambre, et la place où était la lumière dans la pièce voisine, permettaient aux fils de Mano de voir autour d’eux.
Ce point offre une importance qui n’échappera sans doute pas à la sagacité du lecteur, mais la lumière s’est peu faite sur ce point !
Quand viendra la déposition du jeune Bernardin Mano, il ne serait pas impossible, même, qu’une descente judiciaire à la métairie de Tastous fut nécessitée pour l’éclaircissement d’une circonstance d’où peut dépendre le sort de Johannès Mano. En attendant, M. le Président, qui dirige les débats avec une incontestable autorité, quitte son siège pour s’approcher des bancs du jury ; à l’aide d’un plan de grande dimension, il explique, de façon à ce que chacun des quatorze jurés puisse le suivre sur les plans photographiés distribués au début de l’audience, les détails et l’ensemble de la construction du corps de logis.
Le juge de paix ajoute : Lorsque j’appris que Mano s’était évanoui, j’en fus étonné, parce que les paysans des Landes ne s’évanouissent pas facilement. J’aurais, en présence d’un aussi épouvantable massacre, pu cependant comprendre cet évanouissement, si l’évanouissement avait eu lieu en apprenant le quadruple malheur qui le frappait ; mais je ne me l’explique pas quand il n’a lieu que lorsque Mano apprend que sa belle-mère vit encore.
Mano redoutait la prison il ne pensait qu’à lui, mais il ne témoignait aucun regret de ce malheur.
Le pays tout entier croit que Mano est l’auteur du crime. M. Cazeaux a entendu dire que le chien a suivi les victimes au cimetière, mais qu’après il n’a pas voulu suivre Mano son maître, et a préféré aller avec un étranger contre lequel il avait de la haine.
Le Président s’adressant à Mano : Qu’avez-vous à dire ?
L’accusé: Je suis étonné de la déposition du témoin. À propos du chien, c’est faux. En ce qui touche l’opinion publique, je n’ai pas à m’en occuper.
Le juge de paix, sur l’interpellation d’un juré, termine sa déposition en déclarant qu’on se sert dans le pays de chandelles de résine pour la cuisine et de suif pour les chambres à travailler.
L’accusé confirme ce détail.
Cet incident vidé, on appelle le témoin Jean Tastes. (Mouvement.)
Au juge de paix M. Cazeaux succède le maire du Barp, Jean Tastes, un homme de quarante-sept ans, replet, vigoureux, rouge de visage, sa mine un peu égrillarde n’exclut pas un air de dignité en harmonise avec la circonstance ; géomètre de sa profession, magistrat instructeur à ses heures, et qui l’a bien prouvé au cours de l’information.
M. Tastes est resté deux heures au fauteuil ; la déposition qu’il prononce, explicite et pleine de menus faits, est écoutée avec l’intérêt qui doit s’attacher à un témoignage envisagé comme l’un des plus considérables de l’affaire.
La veille du crime de Tastous, j’ai joué avec Mano qui m’avait, proposé de faire une partie de manille. Je lui répondis que, s’il voulait, je lui apprendrais un jeu – le Polignac – où l’on ne jouait pas beaucoup d’argent ; il accepta.
Le Polignac apparaît en 1830 à la chute de la Restauration française. Il tient son nom de celui du dernier Premier ministre de Charles X, le comte Jules de Polignac, qui fait alors l’objet de la vindicte populaire, matérialisée notamment sous la forme d’expressions rabaissantes. C’est dans cet esprit que le valet de pique, choisi pour être la plus mauvaise carte du jeu, reçoit le nom de Polignac.
Comme dix heures venaient de sonner, je m’en allai et je laissai dans l’auberge Mano et Templier régler leur écot. Pendant le jeu, Mano a toujours été taciturne, et ayant la langue un peu épaisse par suite de ses libations de la journée, Mano, d’ailleurs, a une figure impassible et impénétrable, comme j’ai pu le constater dans bien des circonstances.
Le lendemain au matin, 10 avril, vers sept heures, j’étais dans une maison en face de la poste, lorsque je vis passer devant la poste un cavalier qui menait son cheval à bride abattue. J’entendis aussitôt qu’on criait dans le bourg : « On a assassiné toute la famille ». Je courus après le cavalier, et, arrivé chez moi, il me raconta l’horrible nouvelle. Néanmoins, comme il avait été saisi par l’épouvante, il ne me parla que de trois cadavres, ajoutant que le vieux Mano n’avait pas été retrouvé.
Aussitôt arriva chez moi M. Marthiens Cadiche[1], qui vint dans le bureau télégraphique où j’étais resté après avoir expédié une dépêche à M. le juge de paix.
– Du mariage des époux Jean Marthiens sont nés quatre enfants :
– Jean, dit Cadiche ;
– Jean, dit Joannès ;
– Guillaume
– et Martin.
En exécution de son contrat de mariage, ce dernier reçut de son père, de 1823 à 1828, une somme de 6 000 fr.
En 1829, décéda la dame Marthiens mère. En 1851, mourut le sieur Marthiens père.
Les quatre frères restèrent dans l’indivision, et l’administration des immeubles fut confiée à Cadiche et à Joannès.
Le 17 nov. 1851, mourut Martin Marthiens, à la survivance de sa veuve et de ses six enfants. En 1855, les héritiers de Martin formèrent contre leurs oncles une demande en partage des successions paternelle et maternelle, etc.
Il me pria de faire sonner le tocsin, croyant que le crime avait été commis par des étrangers. Je lui dis : « Non, laisse faire la justice, et vous verrez que les coupables ne sont pas malheureusement des étrangers ». Si j’ai tenu ce langage, j’y étais en quelque sorte autorisé par un fait que je vais vous raconter : dans le mois de décembre, avant la Noël, je crois, Manorine est venue me porter plainte contre son mari, ajoutant « qu’il passait les nuits à boire et jouer, et qu’elle était surprise que je ne le surveillasse pas ». Elle croyait, la pauvre femme, que je pouvais empêcher son mari de jouer. Je lui répondis que « je ferais surveiller les auberges, mais qu’il m’était impossible de le suivre dans les maisons particulières ».
Nous étions entrés en causant dans le magasin de M. Hostein et là, se penchant à mon oreille, la rougeur au front, elle ajouta « Ce n’est pas tout ; mon mari m’a fait des menaces. » Je la tranquillisai en lui promettant que je donnerais une bonne semonce à son mari ce que je n’ai pas manqué de faire. Le jour du lundi gras suivant, elle me, dit qu’il ne paraissait plus aussi méchant, mais qu’il continuait à jouer et à boire.
Je suis monté à cheval, et, arrivé à Tastous, j’ai eu sous les yeux le spectacle, le plus horrible qu’il soit passible de voir : devant la grange gisaient la mère et la fille Mano, la face tournée vers le ciel. La mère soufflait encore, mais la fille avait cessé de vivre depuis longtemps. Elle était méconnaissable. Sa figure était tuméfiée et livide, un œil était sorti de son orbite. On aurait dit que le meurtrier avait assouvi sur elle toute sa rage et toute sa fureur. Et pourtant il n’en était rien.
Le vieux Mano, lui aussi, était derrière la fournière, étendu sans vie, la face tournée vers le sol. Il avait la main gauche dans la poche de son pantalon et le bras gauche retourné sous la poitrine. Entre la poitrine et le bras se trouvait une pelle en fer. Je retirai la pelle, elle s’en vint sans résistance. Je compris alors que cette pelle n’avait été mise là que pour tromper la justice et faire croire ce qui n’était pas.
Je rentrai alors dans la maison et, dans la chambre au nord de la cuisine, je vis deux nouveaux cadavres, ceux de Maria et de Marie Mano. Sans la lividité cadavérique qui recouvrait les traits de la petite Maria, on aurait dit qu’elle dormait. Quant à l’autre, elle avait été frappée rudement. Le crâne était ouvert et la cervelle avait rejailli au-dessus de la tête, formant comme une espèce de couronne.
En retournant au Barp pour télégraphier à M. le procureur de la République ce que je venais de constater, j’ai rencontré M. le juge de paix et le Brigadier de la gendarmerie. Je suis revenu à Tastous en leur compagnie, et nous sommes allés chez M. Roumegoux, où M. le juge de paix a commencé l’enquête. Nous convînmes de faire garder Mano. J’appris avec peine le soir que la précaution avait été inutile, puisque Mano avait dormi toute la journée. La justice étant arrivée sur les lieux vers deux ou trois heures du soir, je me suis effacé et j’ai assisté en simple spectateur aux premières constatations légales et la continuation de l’enquête commencée par M. le juge de paix.
Le lendemain je suis revenu à la métairie, accompagné de M. l’agent-voyer. C’est alors que j’ai remarqué le pic avec des taches de sang et des cheveux des victimes. Je fais approcher Mano et je lui dis : « Est-ce que ce long cheveu noir n’est pas un cheveu de la pauvre Manorine, et celui-là, plus châtain, de votre-belle-mère ? » « Mon Dieu si, répondit-il, ah! que je suis content que vous ayez retrouvé cet outil! »
À ce moment se passa une scène qui me donna une vive émotion. La sœur de Marie, belle-mère de Johannès, avait entendu que je parlais des cheveux. Elle s’est approchée aussitôt, a jeté un coup d’œil sur le cheveu du haut de la douille puis, portant la main à son mouchoir de tête et le rejetant en arrière, s’est écriée avec des larmes dans les yeux et des sanglots dans la voix : « Tenez, voyez et comparez ma pauvre sœur et moi avions les cheveux pareils. » C’était vrai, messieurs, les cheveux étaient absolument pareils !
Les témoins de cette scène n’avaient pas perdu Johannès de vue. Lorsque j’eus posé le pic, ils vinrent me dire les uns après les autres « vous n’avez pas remarqué la pâleur des ̃ traits de Mano ? Sa figure s’est décomposée lorsque vous l’avez mis en présence du pic ». Ils avaient trouvé extraordinaire, tout comme moi, cette pâleur de Mano, alors que la veille il n’avait pas trahi une grande émotion en face des cadavres.
Ayant télégraphié à M. le procureur de la République que j’avais trouvé l’instrument du crime, ce magistrat ma répondit, par la même voie, de faire garder Mano a vue ; ce que je fis. Ce soir-là Mano joua aux cartes avec M. Goury (Sébastien), chez qui il passa la nuit. Il fut arrêté le lendemain et emmené à Bordeaux.
Je me suis livré à des investigations fort minutieuses qui ont duré très longtemps ; j’ai trouvé d’abord le pic en dénombrant les outils renfermés dans la grange. À propos de ce pic, je dois faire observer que des taches de suif remarquées sur le fer, me firent souvenir que d’autres taches de suif avaient été constatées sur le fer de la pelle trouvée dans les bras d’Arnaud Mano et j’en induisis que le pic et la pelle avaient dû être pris dans la grange par le même homme ; soit par la victime, soit par son meurtrier. Le pic, examiné, offrait à l’œil des assistants des taches de sang, des souillures de terre noirâtre, et un couronnement de cheveux de nuances diverses ; un de ces cheveux faisait le tour du bois et allait se coller sur la douille. Quelques témoins ont remarqué, à ce moment-là, que Mano a pâli affreusement, lui qui était resté impassible devant les cadavres.
Le Président fait extraire de la caisse où il se trouve, le pic qui a servi à commettre le quintuple assassinat.
Un mouvement d’horreur traverse l’auditoire, lorsqu’on voit ce terrible instrument qui a détruit cinq existences.
Mano reconnaît que c’était bien du sang qui était sur le pic, et il ajoute « Je n’ai pas pâli, pas plus alors qu’à présent, quand j’ai vu le pic. »
Le Président (avec sévérité) : Comment ! c’est là toute la réponse que vous avez faite Si vous m’aviez répondu : J’ai pâli, parce que je voyais l’horrible instrument qui avait enlevé la vie à cinq personnes qui m’étaient les plus chères au monde, j’aurais compris ce cri d’indignation et je n’aurais rien ajouté. Votre défense à cet égard est malheureuse.
L’accusé : C’est possible, mais je ne suis pas aussi bien élevé que vous, je ne sais pas aussi bien parler.
Le Président : Allons donc, l’ouvrier sous sa blouse, le riche sous son habit ont tous les deux le même cœur, et savent, d’une manière ou d’une autre, témoigner leur poignante affliction quand un malheur aussi épouvantable atteint leur famille.
Tastes : Plus tard, nous avons retrouvé le pantalon bleu sur lequel, dans le bas, les assistants ont remarqué des traces de sang ; ce pantalon, pelotonné, était tout humide.
Une semaine après, j’ai découvert dans les cendres du foyer des lambeaux calcinés de toile du pays, qui m’indiquaient que quelqu’un avait dû brûler là de l’étoffe. Enfin, un jour, sous une futaille placée dans le compartiment de l’écurie où Mano avait couché, prétend-il la nuit du crime — il couchait d’habitude dans un autre compartiment — nous avons trouvé une paire de chaussettes de couleur brune, dont la plante avait comme une semelle de boue ; ces chaussettes appartiennent à Mano.
Mano, en effet, a reconnu que ces chaussettes – maintenant archisèches – lui appartenaient, et, d’ailleurs, un berger s’est trouvé, qui a déclaré les avoir tricotées pour la famille des métayers de Tastous.
Quelques explications échangées de nouveau entre la défense, l’accusation, le témoin, la cour et le jury, ont porté sur l’éclaircissement de ce fait important, que le vieux Mano aurait pu avoir été armé après coup de sa pelle, l’assassin voulant faire croire que la malheureuse victime se rendait au travail. Point difficile à établir et sur lequel la vérité n’a pas encore apparu.
Jean Tastes, à qui on a présenté le pic et la pelle, appuie du geste ses démonstrations. Dans sa pensée, ainsi que dans la pensée du juge de paix de Belin, et pour les mêmes raisons, le crime a dû être consommé vers minuit.
Un Juré : M. Tastes, pourrait-il nous dire si la famille Mano veillait tard ?
M. Tastes : Oui, les femmes filaient, causaient, cuisaient le pain parfois jusqu’à une heure fort avancée.
Le président voudrait-il demander à l’accusé pourquoi, lorsqu’on a trouvé le pic, il a exprimé un sentiment de satisfaction ?
L’accusé : je n’ai rien exprimé de semblable.
Le Président : vous avez probablement des motifs pour ne vous en point souvenir. Monsieur te ma.re, comme géomètre, c’est vous qui avez dressé les plans placés sous les yeux du jury ; êtes-vous sûr de leur exactitude ?
[…]
Le Président s’adressant au maire du Barp : Quelle est votre opinion sur l’heure du crime ?
M. Tastes : Entre onze heures et minuit. Le lit de Manorine n’était pas défait, il y avait seulement un trou dans le lit où était l’enfant. Celui des vieux était défait, mais ce lit pouvait n’avoir pas été fait le matin, cela arrive très souvent chez les gens pauvres, et qui passent leur temps dans les champs, travaillant presque le jour et la nuit. La famille Mano était très honnête et très laborieuse ; Mano était joueur, buveur, il vivait en mésintelligence avec sa famille. Les Mano veillaient très tard pour faire les ouvrages de la maison. Le père Mano était un ancien militaire, rude, brutal même. A coup sûr il se serait défendu avec sa pelle si le meurtrier eût été devant lui.
Pour compléter ces deux dépositions, ajoutons qu’interpellés sur l’opinion que ce sont faite les gens du pays, les deux témoins déclarent que chacun, dans la contrée, est convaincu que le seul coupable est Johannès Mano.
L’audience va être levée, mais M. le Président croit devoir, au préalable, adresser à M. Tastes, au nom de la justice et de la société, ses plus sincères félicitations pour le zèle et l’intelligence qu’il a su montrer pendant une si longue instruction.
L’audience est levée à six heures, et le public, qui s’écoule lentement, commente de mille façons et l’attitude de l’accusé, et les contre-examens de la prévention et de la défense, et les paroles des témoins.
À demain la reprise des débats.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9773291w/f1.image.r=barp%20mano?rk=21459;2
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4668118d/f2.image.r=le%20barp?rk=300430;4
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k514258q/f3.image.r=barp%20pichard?rk=171674;4
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k46125886/f2.image.r=le%20barp?rk=128756;0
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k591766z/f3.item.r=Petit%20Journal,%20mano,%208%20mars#
Audience du 11 mars
Même affluence qu’hier, à l’intérieur et à l’extérieur de la salle des assises. Les abords du palais sont encore aujourd’hui d’un accès difficile. Le public, dont la curiosité devient de plus en plus vive à mesure que les débats s’avancent, chassée de la place d’Armes par la pluie, vient chercher un refuge dans la salle des Pas-Perdus qui présente une très grande animation : c’est à peine si l’on peut circuler. La consigne, très sévère, donnée aux soldats, permet, jusqu’à présent, que l’ordre ne soit point troublé.
Mano est-il innocent ? Mano est-il coupable ? Cette double question fait l’objet d’une controverse passionnée et, tout en s’élevant fortement contre l’accusé, tout en lui attribuant les meurtres de Tastous avec une vigueur dans l’affirmation qui ne peut laisser aucun doute sur le sentiment public, l’opinion n’en reconnaît pas moins qu’aucune preuve jusqu’ici ne démontre la culpabilité du prévenu.
De là, d’interminables discussions, bien avant l’ouverture de la salle d’audience, emplissent de leur bruit la salle des Pas Perdus.
La salle d’audience est occupée tout entière de très bonne heure. Les femmes sont en plus grand nombre qu’hier.
La salle des témoins offre un spectacle très curieux. Les 105 personnes, en quelque sorte prisonnières pendant cinq jours, puisque la loi les oblige à attendre leur tour et à ne point quitter le Palais-de-Justice, vont et viennent. Les femmes cousent, tricotent, et les hommes lisent, fument ; on voit des mères allaitant leurs enfants. Le curé de Barp lit son bréviaire et prie Dieu sans doute, pour l’accusé.
Mano est détenu à la prison du Hâ qui n’est séparée du palais de justice que par un passage étroit. Au moment où le détenu est extrait de sa cellule, des groupes compacts se précipitent sur le passage de l’escorte. Les six gendarmes qui l’accompagnent ont peine à contenir les curieux.
Mano est introduit à dix heures cinq minutes. Sa physionomie est toujours calme et impassible, ne trahissant aucune émotion ; la même impassibilité est stéréotypée sur ses traits. Il confère avec Me de Brezetz, son avocat : il se préoccupe très vivement, dit-on, de l’opinion de la presse. Ayant su qu’un journaliste avait écrit dans son compte-rendu qu’il avait pâli durant son interrogatoire, il aurait répondu : « Ah! qu’on me donne une bonne bouteille de vin, on verra bien si mon teint ne se ranimera pas. »
Il y a comme hier beaucoup de dames dans la tribune. Les places réservées aux avocats sont à peu près libres. M. Maisan, interprète, est à son poste pour traduire, s’il y a lieu, les dépositions des témoins.
À dix heures dix minutes, les jurés prennent place sur leurs bancs.
L’huissier annonce la Cour, et l’audition des témoins est reprise.
On introduit le témoin Guillaume Templier fils, 40 ans, propriétaire, qui s’exprime en un dialecte mi-partie de français et de patois : le plus souvent il a l’air de ne pas comprendre, et M. le Président a recours à l’interprète : M. Albert Maisan est appelé à traduire les paroles de Templier.
Guillaume Templier a passé avec Mano la journée et la soirée du 9 avril ; il a trinqué avec lui ; il était convenu que, le repas terminé, nous nous en irions ensemble ; il est mon voisin, puisque j’habite Tastous, et je devais en passant le laisser sa porte. Sur le tard, vers 10 heures et quart, comme ils étaient encore dans l’auberge de Duprat, Guillaume Templier a demandé à Mano s’il voulait s’en venir avec lui (Guillaume Templier demeure au-delà de la métairie de Tastous, dans la lande, près de la route agricole). Lorsque je me levai pour partir, je lui dis « Viens ». Il me répliqua « Un instant encore. » Deux ou trois fois je répétai « Viens-tu ? » Et il répondit toujours « à tout à l’heure. » Sur le refus de l’accusé, qui cependant l’avait « amusé » jusque-là, en lui laissant croire qu’ils s’en iraient ensemble, Templier est parti tout seul à dix heures et demie ; j’étais à cheval. Arrivé à Pioussec, à peu de distance de la métairie, sa jument a eu peur ; il a fouetté, et la bête a aussitôt pris le galop. Il a rencontré sur la route l’attelage d’un nommé Baillet qui s’en venait au Barp.
Guillaume Templier ne peut s’expliquer le motif de l’effroi manifesté par sa jument ; quant à ses impressions personnelles, elles sont défavorables à Mano.
Une longue série d’explications se produit au sujet de la fixation de l’endroit où la jument de Templier a eu peur. Le maire, consulté une deuxième fois, dit que deux témoins seront entendus à ce propos.
À onze heures et quart, j’étais couché.
Le lendemain, en apprenant le crime, je courus à la métairie. Au moment où Johannès fut en présence des cadavres, je me sentis, saisi d’étonnement à la froideur qu’il manifesta. Il était gardé à vue. Je m’approchai de lui et m’écriai « Malheureux comment ne t’es-tu pas précipité sur ces pauvres morts ? » Il prétendit qu’il ne pouvait se laisser aller à un pareil mouvement en présence de la justice.
Sur une demande du défenseur, Templier déclare qu’il n’a point dit au fils Bernard Mano, chez Roumégoux, que le pantalon bleu de son père avait été lavé par la veuve Lacombe.
M. le Président, à Templier : À quelle heure vous êtes-vous couché ?
À onze heures un quart environ.
J’ai suivi à cheval la route, je suis passé à 5 ou 600 mètres de la métairie. La charrette de Baillet allait du côté du Barp ; je n’ai rien entendu du côté du Tastous.
Un juré demande à Templier si, en passant le soir près de la métairie, il n’a rien remarqué de suspect.
Templier se rappelle seulement qu’à un endroit de la route son cheval fit un écart ; il attribue cet accident à un tas de planches qui aurait entravé la route.
M. le Président : Ce n’est pas extraordinaire, car dans l’hypothèse de l’accusation, Templier est parti à cheval, ayant bien de l’avance sur Mano.
M. le Président, à Templier : Votre cheval est-il peureux ? Pensez-vous que la présence d’un homme sur la route eût produit un résultat semblable ?
Templier : Un peu, pas beaucoup. Je ne crois pas que la présence d’un homme ait pu l’épouvanter. Il ne pleuvait pas.
M. le Président : Faisait-il clair de lune ?
Templier : Oui.
M. le Président interroge quatre témoins : Maurice Mano, Jean Rablade, Anne Biallos et Jérôme Mano, sur le prétendu évanouissement qu’a éprouvé l’accusé en apprenant le crime. Ces dépositions établissent qu’il est resté calme et que sa syncope avait l’air d’une comédie. Cela n’empêche pas Mano de se défendre avec tant d’habileté et d’énergie que le Président finit par lui dire : « Vous êtes très habile ; même en vous supposant innocent, il est difficile, interrogé comme vous l’êtes, que vous n’ayez ni crainte ni inquiétude. Vous avez réponse à tout. Vous ne vous laissez jamais déconcerter. Ah! si vous êtes coupable, vous êtes un grand coupable ! »
Maurice Mano : le chien de Mano était méchant, il avait un an ou un an et demi ; il aboyait presque toutes les nuits ; le chien de M. Roumégoux, qui est au Tastous lui répondait ; dans la nuit au 9 au 10, les chiens n’ont pas aboyé.
Pour expliquer le sang qu’il avait à son pantalon, Mano a déclaré avoir tué une dinde le jeudi, mais déjà il avait dit que c’était le samedi, puis le vendredi.
Je n’ai pas cru que Mano était sérieusement évanoui ; quand je l’ai vu, il avait toutes ses couleurs quand on l’a couché chez moi, il disait qu’il avait un mal de tête ; puis il a appelé son fils Bernard ; m’a demandé si sa femme était morte, lorsque je l’ai eu changé de linge. Il n’a pas pleuré ; j’ai été fort étonné de tant de calme. Quand la justice est arrivée, le médecin a dit qu’il n’était pas malade, mais seulement fatigué.
L’accusé répond que s’il paraissait fatigué, c’est parce qu’il avait fendu du bois le matin, depuis cinq heures jusqu’à sept heures.
Maurice Mano : Dès que j’ai vu qu’il était aussi calme et qu’il n’était pas malade, j’ai de suite pensé que c’était lui le coupable ; je le crois encore, et presque tout le monde au Barp est de cet avis.
L’accusé : Je suis chrétien, ma conscience est tranquille, je suis innocent ; si j’avais fait le coup, je l’aurais déjà déclaré à la justice.
Bruit dans l’auditoire.
Jean Rablade, quarante-sept ans : ce témoin a passé son mouchoir imbibé d’eau-de-vie sous le nez de Mano ; une femme prit la bouteille, le fit boire : Mano buvait bien.
La série des témoins relative à l’évanouissement étant épuisée, on procède à l’audition de ceux qui sont en mesure de fournir des renseignements sur les antécédents de Johannès Mano.
Tastes est rappelé pour répondre à une question de détail concernant l’endroit où le pic a été replacé après le premier dénombrement des outils de la grange. M. Tastes n’a pas de souvenirs bien précis ; il s’en réfère aux témoins assignés pour ce fait.
Un autre témoin, Catherine Duprat, 53 ans, femme de 1’aubergiste, qui cumule avec cette profession, celle de boucher, est une forte personne de quarante à quarante-cinq ans, dont la pâleur et l’émotion contrastent avec la vigueur apparente. Sa déposition, lente, embarrassée, s’applique uniquement à la présence de Mano dans le cabaret, le 9 au soir. Elle appelle le président « M. le juge », et parait heureuse de n’être retenue à la barre que pendant un court instant.
Catherine Duprat dit que Mano est allé chez elle dans la journée (en proie à une grande émotion, elle est obligée de s’asseoir). Mano allait souvent à son auberge… Le soir, Templier et Mano sont restés toute la soirée à table ; Mano est sorti un peu avant dix heures et demie. Templier et le maire sont également sortis. Catherine Duprat n’a pas remarqué de quel pantalon était vêtu l’accusé.
Le témoin suivant, dit: « Mon président » ; il qualifie de « mon juré » un membre du jury qui le questionne, et au défenseur de Mano, il répond « Mon avocat ». C’est tout ce que sa déposition renferme de saillant.
On comprend, d’ailleurs, que beaucoup de témoignages ne peuvent être que la reproduction de ceux déjà entendus dans une cause qui ne comporte pas moins de cent cinq témoins. Le Barp a 440 habitants : c’est donc le quart de la population de cette commune qui va se succéder à la barre du tribunal.
Chéri Courbin, 21 ans, boulanger à Salles a joué le 9 au soir chez Duprat, avec Mano. On est sorti vers dix heures et quart. Templier a dit à Mano de s’en aller ; Mano a répondu qu’ils avaient le temps. Chéri Courbin ne sait quel pantalon avait Mano ce soir-là.
Jean Calens, 32 ans, marchand drapier au Barp, a rencontré Mano chez Duprat, et a joué, le soir, aux cartes avec Mano ; on s’est séparé vers dix heures et quart.
Mano s’est évanoui le lendemain ; en arrivant à Tastous, Jean Calens est descendu de la carriole où il était monté, et l’a, avec un compagnon de route, conduit chez Maurice Mano. C’est lui, Jean Calens, qui lui a couvert la tête d’un linge afin de lui épargner la vue des cadavres ; c’est encore lui qui l’a fait boire. Jean Calens a cru un instant à l’évanouissement de Mano, mais quelques instants plus tard, il a pensé à un simulacre d’émotion, ce qu’il a déclaré dans l’instruction. À l’audience, il assure que, dans son opinion, cet évanouissement était réel.
Arnaud Larrue, 33 ans, blouse bleue, pantalon jaune, béret noir, gestes embarrassés, domestique chez M. Perrin : (ne parle pas français ; traduit par Albert Maisan) j’allais me mettre en route et suis entré dans l’écurie de la grange de la Poste. Le 10 avril, à quatre heures et quart du matin, je vis Johannès Mano étendu dans un coin, sur la paille et je l’éveillai. J’avais, en entrant dans la cour de la grange, trouvé ouverte la barrière donnant sur la route, mais ce n’était pas la première fois que je l’avais remarquée ainsi. Mano couchait assez fréquemment dans la grange, quand il ne voulait pas rentrer chez lui ; cependant, je ne l’avais pas encore vu couché dans l’écurie ; c’était plutôt, d’habitude, dans le compartiment voisin. C’est moi qui, la veille au soir, à neuf heures, avais fermé la porte de l’écurie. Je suis garçon d’écurie chez M. Perrin, et c’est à moi qu’incombe ce soin ordinairement.
Mano lui dit qu’il allait travailler chez Ferréol, et Arnaud Larrue s’en alla soigner ses bestiaux ; il n’a pas remarqué que Mano fût ému.
M. le Président : Vous étiez très lié avec Mano ?
Arnaud Larrue : Oui, moussu.
M. le Président : Trop lié peut-être ; Mano allait souvent jouer aux cartes chez vous, avec votre femme, et il circulait des bruits compromettants sur votre honneur conjugal.
Arnaud Larrue : C’est des cancans (on rit).
Sur les questions de Me de Brezetz, Larrue répond que Mano était, à sa connaissance, un bon garçon, un peu joueur, un peu buveur, mais ni méchant ni brutal ; quand il avait bu, il l’a toujours connu pur un « brave drôle ».
Il travaillait souvent chez M. Perrin, qui avait en lui la plus entière confiance au point de lui confier sa maison — de jour ou de nuit — quand il s’absentait du Barp.
L’audience continue.
Raymond Duprat, 51 ans, cantonnier au Barp, a rencontré Mano le 9 avril, tandis qu’il s’en allait en distribution ; il a cru voir que l’accusé avait un pantalon bleu mais il n’en pourrait faire serment ; devant les affirmations de l’accusé, qui prétend avoir porté un pantalon noir, il n’a pas insisté, dans la crainte de se tromper.
Le lendemain, 10 avril, Raymond Duprat était levé à cinq heures du matin ; Mano est allé à lui et lui a demandé des outils pour fendre du bois chez Morillon Cazeaux-Ferréol. Il a remarqué que Mano avait les yeux, gros comme une personne qui n’a pas bien dormi. Il dépose que, quand l’accusé a détaillé le nombre et l’espèce des outils, il a omis de faire mention du pic.
Avec un nommé Goujon, Pierre Chardon (ou Chandon), 53 ans, carrossier au Barp, a rencontré, vers six heures, les petits garçons de Mano, dont l’aîné lui annonça la mort de tous ses parents. Pierre Chardon, sur le refus de son camarade de se rendre avec lui à la métairie, se rendit tout seul à la maison de Mano, et constata que tout le monde, en effet, avait été assassiné. Son camarade, s’étant ravisé, accourait.
Pierre Chardon alla aussitôt avertir des voisins, et, à son retour, il eut la douleur de remarquer deux nouveaux cadavres, ceux des petites filles. En même temps, du monde arrivait, et l’on s’empressait autour de la vieille Mano, qui agonisait.
Pierre Chardon ajoute que les enfants lui ont dit, en outre, qu’ils allaient chercher leur père, qui avait couché au Barp.
Pierre Chardon a constaté que Manorine avait la rigidité cadavérique.
Guillaume Goujon, 52 ans, charron au Barp, a fait avec Pierre Chardon, la route du Barp à Tastous, dans la matinée du 10 avril ; il dépose sur des faits déjà connus ; il fait la description des cadavres et de la maison ; il ajoute néanmoins que le sang trouvé sur le cadavre de Manorine était caillé, et que ses cheveux étaient couverts de rosée, d’où Guillaume Goujon a conclu que la mort remontait à plusieurs heures.
Guillaume Hazera, 53 ans, charpentier au Barp, a aussi rencontré les enfants Mano et en a reçu la triste nouvelle que l’on sait ; tout d’abord, il n’y ajouta aucune foi ; à Tastous seulement, il a pu se convaincre que le fait était réel.
Le lendemain, Hazera demandait à l’enfant s’il n’avait rien entendu pendant la nuit, et l’enfant avait répondu : « Non ! »
Guillaume Hazera a été confronté avec le petit Bernardin, en juillet dernier, et c’est devant lui que l’enfant a raconté que « s’il n’avait pas parlé, c’est qu’il avait eu peur de son père. »
L’audience est suspendue pendant une demi-heure.
À deux heures moins dix, au moment de la reprise, on entend un nouveau témoin, Henri Martin, âgé de trente ans, aubergiste au Barp.
Henri Martin a appris le matin 10 avril, que la famille Mano avait été assassinée tout entière ; il a dépêché aussitôt son jeune enfant à Johannès Mano pour lui annoncer ce malheur. Lui-même s’est rendu à Tastous, où il a pu voir Mano évanoui ; mais la figure de l’accusé n’étant pas défaite, il n’a jamais cru à un évanouissement réel.
Henri Martin interrogé relativement à la dinde que Mano assure avoir tuée et plumée, ce volatile qui sert d’argument à l’accusé pour expliquer le sang trouvé sur ses vêtements, parait n’avoir existé que dans l’imagination de l’ex-facteur rural.
Une discussion à propos de la date à laquelle aurait été tuée cette dinde, s’élève entre l’accusé et le président, qui lui fait remarquer combien sont flagrantes ses contradictions au sujet, et de la date des taches de sang sur le pantalon, et de la qualité de ce sang.
Il est certain qu’aux jours gras, une dinde a été tuée, plumée, vidée et mangée par la famille ; mais il semble que Mano n’ait participé à rien, si ce n’est à la dernière partie de ce programme. En effet, c’étaient Manorine et la vieille Mano, deux vaillantes ménagères, qui s’occupaient des soins domestiques ; l’une ou l’autre de ces femmes a dû tuer 1’oiseau et le plumer.
On se rappelle que l’accusé a varié dans ses déclarations touchant la date de 1’opération. Il a désigné tour à tour le samedi saint, le vendredi, le jeudi, comme le jour où elle avait eu lieu. Qui nous éclairera ?
Henri Martin qui, dans les premiers jours, n’avait pas cru Mano coupable du forfait, s’est convaincu plus tard, lorsqu’on a retrouvé les chaussettes, que c’était bien lui qui avait assassiné sa famille. Les chaussettes avaient à leur plante de la terre et du gravier de la route agricole. Cette distinction au sujet du gravier et de la terre est assez facile à faire, car, dans le pays, les autres endroits sont couverts de terre noirâtre.
Henri Martin fils, douze ans, de mine fort intelligente, est allé chercher Johannès pour lui dénoncer le massacre de Tastous ; Johannès n’a rien répondu. Morillon (Ferréol) ému, a dit que ce n’était pas possible. Henri Martin fils est allé en courant. Johannès n’a pas couru après lui ; ils étaient sortis ensemble jusque devant la porte.
Mouvement dans les tribunes et sur les bancs du jury.
Ce mouvement se renouvelle lorsqu’un témoin qui, dans l’instruction, avait assuré ne pas croire à la culpabilité de Mano, vient déclarer qu’il y croit aujourd’hui.
Morillon Cazeaux Ferréol, quarante-cinq ans, charretier au Barp (c’est chez lui que Johannès fendait du bois), vers sept heures, quand on est venu lui annoncer la fatale nouvelle, Mano déjeunait en compagnie de la famille ; il n’a rien dit en entendant cela, et n’a rien répondu à l’enfant. Seulement, quelques instants après, il s’est écrié : « Ah ! mon Dieu !» et il est parti pour Tastous.
Maurice Mano (qui n’est pas parent), 35 ans, cultivateur au Barp,
Le Président : parlez-vous français ou patois ?
Maurice Mano (en excellent français) : je parlerai patois si vous voulez.
On rit !
Le Président : français, vaudra mieux. Que vous a dit l’accusé pendant les quelques heures qu’il a passé chez vous ?
Maurice Mano : il m’a demandé si on savait qui avait commis cet affreux crime. Je lui ai répondu que non, comme je pourrais le lui répondre encore car on n’en sait pas plus long qu’avant.
Maurice Mano, averti à six heures du matin, a d’abord cru que le criminel était un étranger ; mais quand il eut vu Mano rester tranquillement toute la journée au lit, il s’est dit que ce devait être lui. Dans sa pensée, Mano n’était pas malade ni évanoui ; il avait ses couleurs. Il a vu l’accusé boire parfaitement de l’eau-de-vie. Johannès, quand il a eu repris ses sens, s’est enquis de son garçon aîné et de sa femme ; pour ne pas l’attrister, Maurice Mano lui a dit qu’elle n’était pas encore morte.
L’accusé ne s’est levé que sur les injonctions du capitaine de gendarmerie : il a marché tout seul.
Le chien n’a pas aboyé pendant la nuit du 9 au 10 avril ; d’ordinaire il faisait du vacarme.
Johannès Mano a réponse à tout ; malgré les démentis perpétuels qui lui sont donnés par les témoins, malgré les contradictions où il se jette, il ne se départ pas de son sang-froid ; il invoque la Providence, qui l’a soutenu à travers les longues épreuves de sa prévention, et proteste devant Dieu de son innocence.
le Président : Dans le pays, que pense-t-on de Mano ? Les trois-quarts des habitants croient qu’il est le coupable.
L’accusé : je dis, monsieur, que je ne peux empêcher le monde de parler. Dieu m’a soutenu jusqu’ici ; mon innocence fait ma force. Ces gens qui m’accablent de leurs mauvaises suppositions, je suis chrétien aussi bien qu’eux. Je ne peux que répéter mon affirmation ; « Je suis innocent ».
Le Président lui réplique, et entre autres choses : « Mano, lui dit-il, si vous êtes innocent, vous êtes bien malheureux et bien à plaindre mais si vous êtes coupable, vous êtes un bien grand criminel. Vous êtes, en tout cas, un homme très habile. »
L’accusé : M. le Président, si j’avais fait le crime, je l’aurais dit tout de suite.
Cette dernière parole, la première expression malheureuse que laisse échapper l’accusé, est accueillie dans l’auditoire par un long murmure de réprobation. Divers témoignages portant exclusivement sur l’attitude, la situation d’esprit et l’état physique de Johannès le jour du meurtre, déposent dans des sens tout à fait contradictoires. Les uns assurent que Mano avait l’air fatigué et le moral impassible ; les autres affirment que nulle trace d’insomnie ne se remarquait sur son visage et qu’il avait l’esprit fort abattu.
À chaque instant, l’un ou l’autre des jurés pose une question, interrompt le témoin, adresse quelque observation judicieuse que M. le Président recueille minutieusement. On comprend toutes les perplexités de ces hommes, on devine à quel point leur imposante mission se heurte dans son accomplissement contre les difficultés d’une cause obscure entre toutes. Le projet d’une visite sur le théâtre des événements paraît prendre de plus en plus de consistance.
L’un des actes du drame qui échappe le plus aux investigations, le meurtre des deux filles, ne s’éclaire d’aucun jour nouveau, malgré les insinuations d’un témoin, qui prétend que Mano, soupçonnant sa femme d’inconduite, émettait, en certaine circonstance, l’opinion toute confidentielle qu’il n’était le père, lui, que des deux garçons.
D’autres dépositions, rendant justice à la mémoire de l’infortunée Manorine, établissent l’honorabilité notoire, inattaquable, de l’épouse de Johannès.
Enfin, il parait établi, vers la fin de l’audience, que la dinde a été tuée le samedi, veille de Pâques. Mais ce n’est-t-il, pour les débats, qu’une faible conquête.
L’impatience et l’anxiété générales sont toutes entières tournées vers les révélations attendues de Bernardin Mano, et la solution du problème du pantalon bleu.
On s’attend à un redoublement d’émotion quand viendra cette partie des débats.
Jean Rablade, 47 ans, berger au Barp, parle en patois et, rapporte l’interprète, est allé, de la part de son maître, le 10 avril au matin, porter à Tastous une bouteille d’eau-de-vie, afin de secourir Johannès, qui s’était trouvé mal. Johannès a bu, et il arrêtait, au passage, les gouttes d’eau-de-vie qui lui coulaient des lèvres ; un instant après, il a bu à même la bouteille. Jean Rablade, voyant Mano en cet état, ne pouvait supposer que Mano fût évanoui.
Jean Rablade avait eu quelques discussions avec les Mano, parce que de temps en temps il s’approchait trop de la métairie avec son troupeau ; mais au demeurant, il n’en voulait pas aux Mano, et il n’avait jamais cru à l’inimitié de ceux-ci (on sait que Mano avait reconnu, au cours de l’instruction, certains faits de coups de pierre et de violences plus directes, survenues entre Jean Rablade et le vieil Arnaud.) Jean Rablade, tout en reconnaissant les petites discussions à propos de pacage, nie qu’il y ait eu entre lui et les Mano des scènes plus violentes.
Anne Rambeaud, 26 ans, cultivatrice à Pioussec, vient faire longuement une déposition qui a trait aux antécédents de la famille Mano et aux événements de la matinée du 10 avril.
Anne Rambeaud, interrogée sur les sentiments de l’accusé au point de vue de la famille, répond qu’il n’avait pas l’air d’aimer beaucoup ses enfants.
À quatre heures cinq minutes, la cour, après une suspension de dix minutes, rentre en séance, et on continue l’audition des témoins appelés à déposer sur l’évanouissement de Mano.
Jérôme Mano, 27 ans, cantonnier à Mios, est arrivé un des premiers sur les lieux du crime ; c’est lui aussi qui a mis Mano sur la charrette. Il a vu les cadavres ; Jérôme Mano a été témoin de l’évanouissement de Mano, et son opinion est celle des autres témoins de cette scène.
Jean Fouquet, 36 ans, métayer au Barp : c’est moi qui ai voulu enlever la chemise à Mano, mais il ne voulut pas, c’est lui-même qui s’en est débarrassé.
Jean Fouquet a reçu de la belle-mère de Mano la confidence « qu’on avait tué la dinde le samedi-saint ».
Mano oppose à cette déclaration une dénégation absolue. M. le Président fait observer à Mano que, dans sa première version, il avait dit au juge d’instruction que la dinde avait été tuée, en effet, le samedi. Ce n’est que plus tard, quand on eut démontré à l’accusé que, ce jour-là, il avait été absent toute la journée, qu’il a fixé une autre date à l’égorgement de la dinde.
Jean Fouquet a appris de Manorine que le mardi matin, 9 avril, elle avait fait une scène de reproches à son mari, parce qu’il était rentré très tard le dimanche dans la nuit.
L’évanouissement de Mano n’a pas paru au témoin un malaise bien réel.
Pierre Darrouy, trente-deux ans, ex-facteur boîtier au Barp, fait connaître ses relations avec l’accusé. Pendant cinq mois, il a fait son service avec zèle et dévouement : aussi lui a-t-il donné de bonnes notes. Il gagnait 45 francs par mois et donnait de l’argent à sa famille.
Le Président : Avez-vous bu avec Mano ; le 9 ?
Pierre Darrouy : Oui, monsieur, je l’ai engagé à boire, mais il préféra manger et je le fis mettre à table.
M. le Président Vous étiez donc bons amis?
Pierre Darrouy : Non, monsieur, pas précisément.
M. le Président : Était-il paresseux en dehors du service? Aimait-il le jeu, le vin ?
Pierre Darrouy : En dehors du service, c’était un coureur de cabarets ; il était dépensier, tout son traitement passait au jeu ; il découchait très souvent. Il allait dans les auberges, et, quand elles étaient fermées, il fréquentait des maisons de jeu clandestines.
M. le Président : Darrouy, votre déposition devant le juge d’instruction n’est nullement conforme à celle que vous venez de faire. Vous avez dit qu’il était sournois, débauché, joueur, et qu’il dépensait la totalité de ses appointements dans les cabarets. Tout à l’heure, vous nous l’avez dépeint comme un saint. De ces déclarations contradictoires, quelle est la vraie ?
Pierre Darrouy : Depuis onze mois, il y a bien des choses que j’ai pu oublier.
M. le Président : Donnait-il son traitement, oui ou non ?
Pierre Darrouy : Sa famille m’a répondu que oui, et lui-même me le disait.
M. le Président : Il m’a toujours semblé que, si l’administration des Postes avait reçu de vous des rapports sur Mano, en dehors de son service, on l’eût tout de suite révoqué. Votre devoir était de faire connaître sa conduite, ses mauvaises habitudes. N’est-ce pas pour atténuer vos torts vis-à-vis de votre administration, que vous venez aujourd’hui tenir, cet étrange langage ?
Pierre Darrouy : Il y a douze ans que j’occupe un emploi et l’on a toujours été content de moi.
M. le Président : Oui ou non, la famille Mano s’est-elle plainte à vous de ce que Mano ne lui donnait pas de l’argent?
Mano : je donnais 30 francs par mois, excepté le dernier mois, où je n’ai remis que 25 fr
Darrouy dit que sa dernière déposition est la vraie.
M. le Président lui fait remarquer qu’il ne pouvait pas apporter de l’argent dans sa famille, puisqu’il le dépensait dans les cabarets où il a laissé 80 fr de dettes.
Guillaume Roumegoux, 45 ans, propriétaire au village de Tastous, allait rarement chez eux. Cependant, il a appris d’un de ses commis que le vieux Mano était honnête, mais brutal. Quant à l’accusé, il a entendu dire que c’était un coureur de cabarets, et que sa conduite devait amener, tôt ou tard, une séparation parce qu’ils ne vivaient pas en bonne intelligence.
Guillaume Roumegoux a entendu, le 10 avril, à quatre heures et demie du matin, l’enfant de Johannès qui criait. Deux heures après, la nouvelle lui est arrivée, et il s’est rendu à la ferme de Tastous, où il a vu les cadavres.
Interrogé à l’endroit de l’accusé, M. Roumegoux ne croit pas que le crime ait été commis par un étranger ; dans ce cas, on eût volé, et rien n’a été pris.
Guillaume Roumegoux rapporte qu’on avait, dans le pays, mauvaise opinion de Mano, et que l’on croit que c’est lui qui a commis le crime, et c’est son avis aussi, parce que, apostrophant avec véhémence l’accusé, il lui reproche d’être resté couché, lui, bien portant, et jouant au malade, tandis que la désolation et la mort étaient à Tastous, sachant sa femme et ses enfants assassinés.
« C’est un faux témoin, dit l’accusé. Ah! malheureux, tais-toi! tais-toi ! »
Ces paroles produisent une vive impression dans tout l’auditoire.
Quant au chien, dit Guillaume Roumegoux, je ne l’ai pas entendu aboyer ; le mien n’a pas aboyé davantage, aussi, je suis sûr que le chien de Mano n’a pas aboyé.
Antoine Roumegoux, cinquante ans, propriétaire, qui connaît la famille de Johannès et celle de la pauvre Manorine, déclare que l’accusé vivait en mauvaise intelligence avec son propre père, et en aussi mauvais termes avec les parents de sa femme.
Antoine Roumegoux dit que Mano, même en présence des cadavres de ses parents au Tastous, ne montra aucune émotion. Mano ne semblait préoccuper que de lui ; il faisait des « simulacres », mais peu ou point de gens s’y sont trompés. Mano n’avait aucun chagrin ; il n’a fait attention ni au vieux Mano, ni à ses filles. Il a adressé à sa femme morte quelques mots rapides, où perçait, à l’exclusion de tout sentiment, le souci de sa position.
Mano : ce témoin se trompe ; j’avais la tristesse au fond du cœur.
Les vieux Mano étaient très économes, très vaillants, dit Antoine Roumegoux ; il est sûr que le beau-père se fût défendu si on ne l’avait pas attaqué en traître par derrière pour l’assassiner. Quant à Johannès, il était d’une conduite douteuse ; on l’avait marié jeune pour le faire rentrer dans la voie du bien ; dès son mariage et même avant, il avait de détestables habitudes d’ivrognerie et de débauche. Il rendait son père très malheureux.
Autrefois, maire du Barp, Antoine Roumegoux a su que Johannès n’était pas un bon sujet. Quant au crime, il le croit coupable.
Mano : M. Roumegoux m’en a toujours voulu. Au tirage au sort (conscription), il a fait tout ce qu’il a pu pour me faire prendre…
M. le Président : Quel intérêt avait-il à ce que vous fussiez conscrit ?
Antoine Roumegoux : La preuve que je ne lui en voulais pas, c’est que je l’ai occupé très souvent ; d’ailleurs, comme maire, au conseil de révision, je n’avais pas voix délibérative.
Marie Dussaud, femme Larrue, dite la Couenne, trente ans, déclare que Johannès Mano venait souvent chez elle familièrement, mais seulement pour des rapports ordinaires (qu’entend-t-elle par « rapports ordinaires ?) ; ils étaient en relations, parce qu’elle travaillait le bien de la famille Mano ; elle s’inscrit en faux contre les bruits qui ont couru dans le pays, lesquels bruits ont compromis sa réputation. Il est vrai cependant que, quelquefois, elle a reçu assez tard Mano et ses amis et qu’elle leur a laissé faire la partie de cartes pendant la nuit.
Seconde Goujon, 20 ans, couturière au Barp, interrogée sur les bruits qui ont couru à propos d’une liaison assez intime entre elle et l’accusé, répond que rien de ce que l’on a raconté à ce sujet n’est vrai. Elle a toujours ignoré qu’elle portait ombrage à Manorine.
Madeleine Mano, femme Darriet (Jean), trente ans, aubergiste au Barp, dit que Mano allait chez elle tous les jours et qu’il lui doit 34 fr environ. Avant le crime elle lui donna 2 fr 30 c. pour lui acheter de la viande ; il fit l’emplette chez le boucher, mais sans le payer. L’accusé avait gardé l’argent pour lui.
Mano reconnait ce fait.
Le Président : c’est là un petit abus de confiance. C’est bien peu de chose, sans doute, pour un homme accusé de cinq assassinats, mais cela prouve que vous n’étiez pas probe. Du reste, vous avez avoué avoir usé de mensonges pour éluder les réclamations de cette femme.
Pierre Degras, trente-six ans, marchand de poissons, dit que Mano, devant de l’argent à M. Marthiens, s’écria dans une circonstance et sur un ton singulier : « Je vais le régler ce cadet-là ! »
Mano : Je n’avais aucune intention, j’ai voulu seulement dire que je voulais payer mon compte.
Le Président : c’est possible ; je n’insiste pas sur ce point.
Jean Courbin, cinquante-six ans, boulanger, indique un fait relatif à une somme de 2 fr 50 c. que Mano était chargé de recouvrer. L’accusé a touché cet argent, mais il ne l’a jamais rendu.
Mano répond qu’il avait l’intention de 1e remettre à la fin du mois.
Le Président : un homme qui commet de pareilles indélicatesses est bien capable d’avoir pris, après la mort de sa famille, de l’argent dans les armoires de Tastous.
Arnaud Brun, vingt-six ans, forgeron dit que lorsque M. Marthiens mourut, chargé de clouer le cercueil, Mano a enfoncé le cadavre dans la bière avec le genou, en disant : « Ah! je te tiens, toi, tu m’en a assez fait ; je voudrais les tenir tous. »
Mano ne nie pas ce fait, mais il soutient n’avoir pas tenu ce propos ; il s’est contenté de dire : « En voilà un autre ! »
Arnaud Brun ajoute que cette scène lui fit, horreur, car il n’était pas nécessaire d’appuyer son genou sur le ventre de M. Marthiens. De plus, un mois et demi avant le crime, il fit appeler Mano en règlement de compte ; il me redevait 25 francs. Il me promit de me payer à la fin du mois. À !a fin du mois, nous déjeunâmes ensemble ; il me dit qu’il s’était brouillé avec son beau-père, qu’il avait eu des raisons avec lui. Mano dit alors à Arnaud : « Nous n’avons eu avec mon beau-père que deux raisons ; s’il m’en avait donné une troisième, nous nous serions massacrés. »
Mano répond qu’il s’est disputé, mais que le témoin se trompe pour le reste.
Le Président : cela prouve que vous viviez en très mauvaise intelligence. Du reste, vous avez dit vous-même que vous deviez vous séparer.
Pierre Cameley, soixante-et-onze ans, berger, dépose qu’en sciant du bois, l’accusé a voulu faire tomber son père du haut d’un chevalet en coupant la corde.
Le 24 mars, il a vu Mano compter 25 francs à son beau-père.
L’accusé nie avoir eu ce projet. Monsieur, le Président, dit-il, le témoin a rêvé cette raison.
Quelques témoins sont entendus au sujet de savoir si Johannès Mano était absolument probe ; de petits faits d’abus de confiance sont relevés contre lui.
L’audience est levée à sept heures moins vingt minutes.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4612587s/f2n3.texteBrut
Audience du 12 mars 1873
L’aspect extérieur du Palais-de-Justice n’a pas changé, et le mauvais temps n’a guère fait reculer la foule des curieux. L’aspect intérieur de la salle d’audience est resté le même ; grande affluence d’assistants.
À dix heures, la cour entre en séance.
M. le Président fait observer à l’accusé qu’il se défend très mal ; qu’il a attaqué tout le monde de fausseté au cours de l’instruction, et depuis l’ouverture des débats oraux. Le juge d’instruction, le maire du Barp, tous les témoins, il les a accusés de mentir ou d’avoir dénaturé la vérité.
On continue l’audition des témoins.
Pendant près de deux heures se succèdent à la barre de vieilles paysannes au costume pittoresque et coiffées de la traditionnelle marmotte ; ce sont les matrones du village, contemporaines d’âge de la belle-mère de Johannès, et dont chacune a été, plus ou moins, la dépositaire des secrets de la victime.
Que disait la vieille Mano, au cours de ses confidences ? Le plus souvent, elle se plaignait de son gendre, manifestait des craintes pour l’avenir de sa fille, et dépeignait sous de sombres couleurs l’intérieur de la ferme. Tant que je serai là, disait-elle, Manorine n’a rien à craindre ; mais que deviendra-t-elle après ? Et la pauvre femme pleurait, se lamentait et tremblait de tous ses membres.
D’après certaines scènes remarquées à la métairie, les appréhensions de l’infortunée n’étaient que trop justifiées. Tantôt on entendait des querelles, tantôt on assistait aux menaces de Jean Mano à sa femme et à sa belle-mère.
Si Jean Mano est l’auteur des égorgements de Tastous, il ne serait point surprenant que la pensée du crime eût précédé de beaucoup l’exécution ; quand on pense aux précautions prises par le meurtrier, on ne peut s’étonner.
Jeanne Dupin, Marie Poumey, Héloïse Courbin, d’autres encore, viennent, avec des larmes dans la voix, raconter ce qu’elles savent de cette maison où l’intimité d’une famille, heureuse en apparence, était constamment menacée par l’inconduite et les dérèglements du mari de Manorine.
L’accusé proteste énergiquement contre ces assertions ; il reconnaît qu’il lui arrivait parfois de gronder sa femme, d’adresser à sa belle-mère quelques observations ; mais il nie avoir mérité les épithètes de brutal, paresseux, gourmand et ivrogne que répètent plusieurs témoins.
Entre autres dépositions nous rapportons les suivantes :
Thérèse Gaillard, cultivatrice au Barp, quarante-trois ans : entre onze heures et minuit, le soir du 9 avril 1872, je m’éveillai d’un premier somme et entendis passer sur la route, en avant du village du Barp où je demeure, un homme chaussé de sabots ; il marchait dans la direction de Tastous et Marcheprime et semblait hâter le pas.
M. le Président : Était-ce vous, Mano ?
L’accusé : Non, Monsieur le président, à cette heure-là je dormais dans l’écurie de la Poste.
Saturnin Farro : C’est moi qui, l’un des premiers, ai visité les cadavres : ils n’étaient pas encore rigides.
M. le Président : Quelle heure était-il ?
Saturnin Farro : Sept heures du matin. La main de Manorine était froide, mais son bras, que je soulevai, conservait de la flexibilité.
Deux témoins donnent des renseignements relativement au chien de garde de la métairie et le représentent tel que nous le connaissons déjà hargneux et d’un naturel aboyeur. Or, personne n’a entendu le chien la nuit du crime.
Un autre témoin assure que, cette nuit-là, le ciel était fort sombre : l’on y voyait à peine à deux pas devant soi. Cette déposition est en contradiction avec celle qui, hier, affirmait qu’il faisait clair de lune…
Jeanne Tarris, 39 ans, cultivatrice au Barp, déclare que dans le courant de mars 1872, la belle-mère de Johannès l’alla trouver et lui dit : « Mon gendre est, dit-on, à Bordeaux, pour chercher à s’y placer ; je souhaite qu’il réussisse, car je suis fatiguée de lui ; je nourris sa famille, et encore il nous fait des scènes. Voyez, je l’empêche le plus possible de battre sa femme, et je m’expose à recevoir des coups. Avant longtemps vous entendrez parler de notre famille. »
Cette confidence a d’autant plus frappé le témoin, que la belle-mère de Mano était une femme qui parlait peu.
Mano, interpellé, répond qu’il ne croit pas à la véracité de ce récit.
Jeanne Tarris persiste dans ses déclarations.
Jean Templon-Lévesque, interrogé sur l’opinion qu’il a au sujet de la culpabilité de Mano, déclare que, pour lui, Mano a toujours été l’assassin des métayers de Tastous.
Jeanne Jouglens, femme Gourdes, 44 ans, cultivatrice au Barp, a déchaussé la vieille belle-mère ; au moment où elle enlevait les bas à la moribonde, de la poussière s’est échappée, ce qui lui a fait penser que la vieille ne s’était pas couché. Du reste, les Mano se couchaient très tard d’habitude.
Pierre Beyris, 52 ans, garde-champêtre de la commune du Barp, vient déposer sur les événements du 10 avril, bien connus désormais du lecteur.
Pierre Beyris a été chargé, avec un gendarme, de garder Mano à vue. Pendant la nuit qui a suivi la mort de la belle-mère, le gardé a vu Mano allait lui-même chercher du fricot et du pain, s’attabler et prendre un repas confortable.
Pierre Beyris ayant affirmé que personne n’a pénétré dans la grange, Mano lui donne un démenti que le garde lui renvoie sur le champ. Mano assure que la grange est restée ouverte toute la journée ; que par conséquent on a pu y pénétrer et « toucher au pic. » Pierre Beyris affirme que la porte de la grange était fermée, qu’il avait lui-même la clef dans sa poche, et que personne, par conséquent, n’a pu toucher au pic.
Ulysse Toussaint, agent-voyer à Saintes, a visité le pic avec le maire, et y a constaté des taches de suif et de sang ; il a entendu Mano s’écrier en apercevant des cheveux sur le pic : « Ce doit être là l’instrument du crime. »
Jeanne Dupuis, 46 ans, cultivatrice au Barp, fait la même déclaration.
Catherine Beyris, 23 ans, domestique au Barp chez M. Marthiens, est allée, le 3 mars 1873, à Tastous, et y a reçu de la belle-mère les tristes confidences que l’on sait ; la confidence a eu lieu dans un champ.
Catherine Beyris confirme les paroles attribuées à Mano, à propos du pic, instrument supposé du crime, et de l’existence, à l’endroit de la douille, de plusieurs cheveux de nuances diverses. Catherine Beyris ajoute que Mano a fort bien reconnu que quelques-uns de ces cheveux appartenaient à ses petites filles, et qu’au moment où le pic a été retrouvé, Mano a subitement changé de couleur.
Catherine Beyris raconte ensuite la conversation qu’elle a eue avec l’enfant dans un champ, un jour que l’enfant lui dit : « Je n’ai rien entendu, ni rien vu ; mais je sais que c’est mon père qui a tué ma mère, et je veux aller à Bordeaux pour le battre ; et s’il revient au Barp, je le tuerai ».
Mano, interpellé, répond qu’il n’y a que cette fille qui a conseillé à l’enfant de dire tout cela ; il déclare que M. le juge d’instruction pourrait être consulté utilement sur l’influence que Catherine Beyris a exercée sur le petit Bernard.
L’accusé insistant, M. le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonne que le juge d’instruction sera immédiatement entendu.
de Pichard dépose, en résumé, que l’enfant, un jour qu’il se trouvait en présence de son père, dans le cabinet d’instruction, eut peur et alla se cacher derrière une table ; que l’enfant ayant fait ce jour-là une déclaration contraire à ses déclarations précédentes, Catherine Beyris, qui était présente en ce moment, a bien fait un geste ; mais ce geste, dans la pensée du magistrat, était plutôt un geste d’encouragement qu’autre chose.
Catherine Beyris, interrogée, répond qu’elle a haussé les épaules seulement pour engager le petit enfant d’un boulanger, qui était là, à rester tranquille.
Des témoignages sont recueillis, parmi les témoins entendus, sur le caractère et l’honnêteté de Catherine Beyris, et tous concluent à sa parfaite honorabilité, à la confiance absolue qu’elle mérite.
Catherine Beyris affirme que jamais elle n’a eu l’idée d’influencer le petit enfant de Mano ; qu’elle ne l’a conséquemment jamais fait.
L’incident se trouve ainsi vidé.
Jérôme Poumey, 30 ans, terrassier au Barp, a été le locataire de Mano, tandis qu’il s’occupait d’ouvrir une route derrière la métairie de Tastous ; il déclare que Johannès ne rentrait pas tous les soirs ; qu’il se disputait fréquemment avec sa femme. Jérôme Poumey a remarqué que l’accusé montrait peu d’affection à ses petites filles. Le soir, tous les outils étaient remisés dans la grange, dont le vieux Mano fermait la porte à clef ; cette clef était pendue toujours derrière la porte de la maison.
Jérôme Poumey ne croit pas que l’assassin soit un étranger : il déclare s’être servi du pic et l’avoir rendu aux Mano, un peu plus d’un mois avant le crime ; il a déposé l’outil dans un compartiment ouvert ; mais le vieux Arnaud ramassait les instruments, car il avait de l’ordre ; il venait de serrer à clef une masse qui était dans le même compartiment, et il avait dû aussi serrer le pic.
Étienne Templier, 65 ans, propriétaire, au Barp : la belle-mère se plaignait souvent à lui ; son gendre mangeait tout ; il rentrait tard, souvent il ne rentrait pas du tout ; il ne faisait absolument rien pour ses enfants.
Étienne Templier a entendu un jour, dans les champs, Manorine dire, entre autres choses, à son mari : « Malheureux! nous n’osons plus sortir, tant nous sommes bas, et c’est toi qui nous as mis ainsi. Tu devais nous donner de l’argent ; tu nous as payé le premier mois, et puis tu n’as plus rien donné. »
La belle-mère, dit Étienne Templier, intervint et engagea sa fille à prendre patience ; Johannès menaçait sa femme d’un coup de pelle. La vieille entraînait sa fille, lui disant : « Viens Manorine, viens ; tu sais bien ce qu’il nous a promis ; il nous fera quelque mauvais coup. » Et Étienne Templier a entendu Mano dire, à la fin de la scène : « Quelque beau matin, je vous réglerai tous ! »
Étienne Templier a toujours été convaincu que l’assassin de Tastous, c’est Johannès Mano.
Augustin Mano, 53 ans, métayer à Cestas, oncle de l’accusé, déclare que, lorsque le maire a fait voir le pic à Mano, l’accusé a reconnu que le long cheveu était un cheveu de Manorine. (Encore un témoin dont le nom a été classé par erreur dans la catégorie qui nous occupe.)
Femme Fouquet, 41 ans, cultivatrice au Barp, vient déposer que la dinde a été tuée le samedi-saint ; elle dit que Manorine aimait son mari, mais que celui-ci ne le lui rendait pas. Elle raconte une scène de violence entre Mano et sa pauvre femme, dans laquelle fut obligé d’intervenir le beau-père.
Marie Barbe, veuve Ballauze, 59 ans, cultivatrice au Barp, dépose que Johannès Mano était extrêmement redouté par les femmes de chez lui ; elle tient le propos de l’accusé lui-même ; elle raconte en outre une scène violente survenue aux champs, pendant la moisson, entre Johannès et sa femme.
À propos d’une question faite par un juré, des explications se croisent, tendant à établir l’heure à laquelle a pu être commis le crime ; mais c’est là, un point difficile encore à établir.
Arnaud Décis, trente ans, sabotier au Barp, raconte que Mano rentrait souvent très tard à la maison, d’après la belle-mère ; que parfois, même, il ne rentrait pas du tout, et qu’aux remontrances de ses parents, Mano répondait par de « mauvaises menaces, » qui se dirigeaient surtout contre Manorine ; Arnaud Decis qui tient ces confidences de la belle-mère elle- même, ajoute que la pauvre femme avait les larmes aux yeux toutes les fois qu’elle parlait de ces tristes choses.
Arnaud Décis, extrêmement ému, est obligé de s’asseoir.
Jean Marthiens, dit Johannès, soixante-huit ans, propriétaire au Barp, en proie à une profonde émotion, dépose que Mano a travaillé longtemps chez son défunt frère ; jamais Mano n’a manqué à son devoir. Plus tard, le frère de Jean Marthiens étant tombé malade, Mano fut appelé pour le soigner, et il s’acquitta de ce service avec dévouement.
Jean Marthiens dépose sur un fait d’improbité qui ne fait guère honneur au caractère de 1’accusé : Mano travailla longtemps chez moi. Le 11 février, il vint me dire de lui prêter, au nom de mon frère, 95 francs qu’il devait me rembourser fin février ; il ne vint pas. Je lui écrivis le 11 mars, lui disant que s’il ne payait pas, je le ferais assigner. Il vint me dire qu’il me payerait en travaux. Mano est allé travailler trois matinées seulement. On me répéta qu’il avait dit, parlant de moi avec menaces : « En voici encore un que je réglerai ». Un ouvrier, le 4 mars, je crois que c’est Desieux, déclara que Mano lui avait dit « On m’en fait tant chez moi que je tuerai tout ». La belle-mère de Mano me porta en redevance une paire de poulardes ; elle déjeuna. Je lui demandai si elle était contente de son gendre. « Non, il rentre tard ; nous sommes obligés de laisser la porte ouverte pour quand il rentre, car, s’il la trouvait fermée, je ne sais pas ce qu’il nous ferait ».
L’accusé : Ma belle-mère n’a pas pu dire cela car il y a ici des témoins qui vous diront que je ne rentrais jamais chez moi sans frapper à la porte de mes parents. Quant à la menace de tuer tout le monde, le témoin s’est évidemment mépris.
Jean Marthiens, frère du précédent, 72 ans, propriétaire au Barp, raconte qu’un nommé Brun, après le crime, lui avait déclaré en déjeunant, répétant le propos suivant qu’il tenait, dit-il, de Mano lui-même : « Il faut que je me débarrasse de tous ces gens-là ! » Mano parlait des siens. Depuis le crime, j’ai eu de mauvaises idées ; Brun soutient qu’il ne m’avait pas parlé ainsi, mais j’en suis bien sûr.
L’accusé : Je n’ai pas dit à Brun ce qu’on prétend. J’ai simplement indiqué que je voulais me séparer de ma famille.
Jean Marthiens ajoute qu’un témoin lui a raconté que Johannès « voulait tout tuer chez lui. » Il a causé avec la belle-mère de Mano ; la pauvre, femme lui a confié que son gendre menait une mauvaise vie et qu’il fallait lui laisser très tard la porte ouverte ; sur l’observation de Jean Marthiens, elle ajoutait qu’elle ne savait ce qui arriverait si on fermait la porte de la maison.
Étienne Darriet, 62 ans, cantonnier, au Barp déclare que Mano portait souvent un pantalon bleu. Un jour, Darriet a rencontré la belle-mère chez M. Tastes ; la vieille lui a parlé de Johannès ; elle lui a dit que son gendre, afin de s’excuser de l’absence de toute une nuit, avait fait des mensonges à la maison ; elle s’est beaucoup plainte en même temps de Johannès, et a déclaré qu’elle voulait aller « dire quelque chose » au juge de paix, à Belin.
Jeanne Courbin, 49 ans, cultivatrice au Barp, dépose que la belle-mère de Mano se plaignait beaucoup de son gendre ; qu’elle racontait en pleurant que Mano mangeait tout son argent, et qu’on était obligé de lui nourrir toute sa famille ; qu’il avait toujours de méchantes raisons, et qu’il menaçait sa femme. Jeanne Courbin n’a pas été étonné que l’on ait accusé Mano du crime du 9 avril.
L’accusé : Demandez à tous les aubergistes du Barp ; je vous donne pleins pouvoirs pour cela (sic ; hilarité générale), si ma famille a payé mes dettes. Ma belle-mère n’a pas pu dire tout cela.
Marie Poumey, femme Barrière, soixante-et-onze ans, demeurant au Barp, rencontra un jour de février 1872, sous le porche de l’église, la vielle Mano qui lui dit : « Il y a de la misère chez moi. »
« Comment, lui répond Marie Poumey, tu récoltes 50 hectolitres de blé et tu te plains ? »
« C’est la tranquillité qui manque à la maison, réplique la femme d’Arnaud Mano. Depuis que Johannès est chez nous, il menace Manorine de la tuer. » La vieille Mano, en parlant ainsi, versait d’abondantes larmes.
Jean Mano, trente-six ans, tisserand à Belin, cousin de l’accusé, dépose que la vieille Mano lui a fait la triste confidence de ses misères, ajoutant qu’elle avait été menacée par son gendre, que toute la famille avait été également menacée, et qu’elle croyait Johannès « capable de faire un mauvais coup. » La pauvre vieille, en racontant cela, versait d’abondantes larmes.
Jeanne Dumorin, veuve Lacombe, soixante-six ans, cultivatrice au Barp, dépose que Johannès avait eu « des divorces » — lisez des discussions — avec sa femme ; que sa belle-mère s’était plainte. Un jour, l’accusé avait dit à Manorine : « Un beau jour, à toi, je te trouverai ta marche ! » Sa femme lui avait répondu : « Tu ne me tueras pas, peut-être, parce qu’alors on te tuera aussi ! » Jeanne Dumorin déclare qu’elle a entendu ces choses de ses propres oreilles.
L’accusé, interpellé, nie très énergiquement ; il « s’anime » et apostrophe Jeanne Dumorin ; c’est la première fois que Mano se départ de son calme. Il reproche à Jeanne Dumorin d’avoir reçu cinq francs pour déposer ainsi ; il lui reproche, en outre, d’être un faux témoin.
Une discussion s’engage en patois entre le témoin et l’accusé.
le Président : Accusé, n’avez-vous pas dit : « Puisqu’on veut me couper la tête, je la porterai au Barp » ?
L’accusé : J’ai dit qu’on voulait me couper la tête, mais je n’ai pas ajouté que je l’apporterai au Barp.
Pierre Derieux (ou Desieux), 31 ans, menuisier à Salles, en octobre 1871, un jour après boire, a causé avec Mano de sa famille ; il a appris de lui qu’il vivait en mauvaise intelligence avec les siens. Avant de terminer son entretien, l’accusé lui a dit : Tiens, Derieux, garde-moi le secret : il vaudrait mieux pour moi tout abandonner, ou, si je ne craignais point la justice, tout tuer ! Pierre Derieux lui a répondu : Il vaut mieux prendre patience ; car, une fois qu’on est mort, tout est fini. Mano, d’après lui, était un peu échauffé par le vin, sans cependant être ivre. Pierre Derieux avoue qu’il était, lui aussi, un peu échauffé.
L’accusé nie avoir tenu ce propos ; il avoue avec Pierre Derieux que, ce jour-là, ils avaient bu ensemble ; mais, ne le considérant que comme un étranger, jamais il ne lui aurait confié un tel secret.
Serré de près par le président, qui lui démontre de quelle immense gravité est sa déposition, Pierre Derieux affirme devant Dieu que ce qu’il a raconté est l’exacte vérité.
Les témoins Brun et Marthiens sont rappelés. Marthiens est certain que Brun lui dit un jour que Mano avait déclaré qu’il se débarrasserait de sa famille. Brun ne sait plus s’il a tenu ce propos. Marthiens l’affirme, car il en a été tellement frappé qu’il l’a écrit au moment même.
Arnaud Cameleyre, vingt-cinq ans, charpentier au Barp, cousin de la femme Mano (Pierre Cameleyre, le père d’Arnaud, est marié à une Marie Mano), rapporte que la belle-mère de Mano lui disait un jour : « Mano veut se débarrasser de nous! » Arnaud Cameleyre ajoute que Derieux lui avait dit : « Mano veut aussi corriger le maçon (surnom du beau-père) ; il me l’a dit lui-même. »
Arnaud Sulbert (ou Sallebert), 44 ans, horloger à Salles : Mano m’a demandé si je voulais lui louer une maison à 400 mètres du bourg, parce qu’il était trop loin de son travail, et que n’étant pas d’accord avec sa famille, il aimait mieux s’en séparer.
Thérèse Gaillard, 43 ans, cultivatrice au Barp, demeurant sur le bord de la route agricole : « Le soir, dit cette femme, je me suis couchée à dix heures ; j’ai dormi un peu ; vers onze heures, j’ai entendu un homme marchant d’un bon pas ; il s’en allait vers Marcheprime ; on entendait ses sabots. Je ne sais pas si c’était onze heures ou onze heures et demie. »
Mano, interrogé sur la qualité de la chaussure qu’il portait le 9 avril, répond qu’il avait des sabots mais il prétend qu’entre dix heures et minuit il était couché.
À une heure trois quarts, l’audience est suspendue et reprise à deux heures.
Pierre Rambaud, quarante-trois ans, métayer à Pioussec, n’a pas entendu le chien dans la nuit du 9 ; il l’entendait aboyer parfois. La bête n’était ni bonne ni méchante ; mais, à coup sûr, si quelqu’un d’étranger était entré la nuit dans la métairie, elle aurait aboyé. Un soir, le chien s’est précipité sur lui.
Pierre Rambaud n’a pas touché les cadavres, qu’il a pourtant a bien vus, le matin du 10 avril ; il ne peut donc fixer leur degré de raideur.
Thomas Bailliet, 45 ans, adjoint au maire du Barp, le mardi, 9 avril, au soir, revenait de Marcheprime au Barp. Vers onze heures moins le quart, il a passé avec sa charrette devant la métairie de Tastous ; il a rencontré son cousin Templon, vers onze heures et demie, et l’a croisé entre Tastous et le Barp, où lui-même est arrivé à minuit cinq minutes. Le temps était très sombre ; si sombre qu’on voyait à peine les chevaux de l’attelage.
Sur une demande du président, Thomas Bailliet répond qu’au moment où il est entré au Barp, son cousin Templon devait être arrivé à la hauteur du pont de Templier.
Jean Templon-Lévesque, quarante ans, meunier (ou menuisier ?) au Barp, avait, ce soir-là, à conduire deux charrettes jusqu’à Marcheprime ; il faisait très sombre. En route, il rencontra son cousin Rambaud. Quelques centaines de mètres avant d’arriver à Pioussec, une des juments de l’attelage a eu peur ; il n’y avait en cet endroit-là rien sur la route. À onze heures et demie, il est arrivé en face de la métairie de Tastous. Un peu plus loin, une des deux charrettes étant trop en arrière, il a attendu ; il était près du pont de Templier ; c’est alors qu’il a entendu un cri suprême de désespoir. Sur le moment, aucun soupçon ne lui a traversé l’esprit ; mais il a pensé plus tard que le vieux Mano, entendant passer des charrettes sur la route, avait voulu crier au secours, et que s’est à ce moment-là qu’il a dû être frappé.
M. le Président : Et depuis ?
Jean Templon-Lévesque : Depuis ? je ne sais pas.
M. le Président : Dans l’instruction vous avez dit « Quand j’eus connaissance du crime, je pensais que j’avais entendu un cri de détresse de Mano père, qui, averti par un roulement lointain des voitures qui passaient sur la route agricole, se serait élancé vers le sentier pour appeler du secours. » C’est bien votre pensée.
Jean Templon-Lévesque, avec hésitation : C’est …, ce n’est pas…, non…, oui…, c’est ma pensée.
M. le Président : N’aviez-vous pas eu, quelque temps avant, une conversation avec Arnaud Mano ?
Jean Templon-Lévesque : Oui, il me disait qu’il n’était pas content de Johannès.
M. le Président : Et Johannès ne vous a-t-il parlé ?
Jean Templon-Lévesque : Oui, il m’a dit qu’il voulait quitter la ferme. Il a ajouté « Si mon beau-père m’embête, c’est moi qui le réglerai. »
Interrogé sur l’opinion qu’il a au sujet de Mano, Jean Templon-Lévesque déclare que, pour lui, Mano a toujours été l’assassin des métayers de Tastous.
M. le Président : Vous le considérez comme le coupable?
Jean Templon-Lévesque : Du tout, mais je crois que c’est lui qui a fait le crime.
On rit dans l’assistance.
L’accusé, se levant brusquement : Qu’est-ce que tu dis là, Monsieur ? Ne sais-tu pas que je suis chrétien comme toi ?
Jean Templon-Lévesque : Je dis ce qui est, je répète ce que tu m’as dit.
L’accusé : Eh bé ! je prétends, moi, que je ne t’ai jamais dit ça. Tu viens donc ici pour faire un faux serment ? Sais-tu ce que c’est qu’un faux serment, Monsieur ?
Jean Templon-Lévesque, avec une sincérité et une indignation qui percent dans son accent : Un faux serment, moi ! Je suis ici pour dire la vérité, je dis la vérité
L’accusé : Misérable ! moi j’irai dans le ciel, et toi tu n’y entreras pas !
Cette scène impressionne vivement l’auditoire. Elle se renouvelle à peu près dans les mêmes termes à l’occasion de deux ou trois autres dépositions.
Les dénégations de Johannès Mano acquièrent plus d’intensité à mesure que se développent les débats. Son sang-froid ne se dément pas et il déploie pour sa défense une énergie véritablement surhumaine.
Johannés avait dit à Jean Templon-Lévesque : « Mon beau-père, dans le temps a mordu un homme, mais il n’agira pas ainsi à mon égard, car c’est moi qui le réglerai ! »
Nouvelle vive altercation entre le témoin et l’accusé.
Achille Doussin : Il va à la grange, voit le pic, constate des traces de suif, des traces de sang et des cheveux. Mano dit « Ce doit être cet instrument qui a servi à commettre le crime. »
Anne Jougle, fermière : J’allais souvent chez le Mano ; je les voyais en dispute très fréquemment. Le mari était dur pour Manorine ; autant elle était vaillante, autant il était paresseux. Manorine soignait et aimait ses enfants ; Johannès ne regardait pas plus ses petites filles que si elles n’eussent point existé.
Hippolyte Duluc, 45 ans, propriétaire à Bordeaux : c’est chez lui, en 1870, que Johannès et sa femme ont travaillé avant leur installation à Tastous. Johannès, d’après Hippolyte Duluc, était honnête, brave, travailleur et affectueux pour ses enfants ; Manorine, quoique très laborieuse, était moins tendre pour sa famille ; elle n’était pas caressante. Johannès Mano s’est montré, pendant tout le temps qu’il a passé dans la propriété de M. Duluc, digne des plus grands éloges. « Les époux Johannès Mano, ajoute Hippolyte Duluc, après un incendie qui avait tout dévoré chez eux, me quittèrent, sur les résolutions de la femme auxquelles Johannès avait toujours été opposé. »
Une vingtaine de jours avant le crime, l’accusé alla demander à le reprendre ; mais le maître et le domestique ne purent s’entendre. Mano avait dit à Hippolyte Duluc qu’il avait l’intention de revenir seul chez lui ; sa femme ne devait venir le rejoindre que plus tard.
Jean Favereau, 69 ans, résinier au Barp, a fait la vérification des terres exploitées par les Mano, de leur vivant ; il a pu se convaincre que le vieux Arnaud n’avait, à l’époque de sa mort, aucun travail qui nécessitât l’emploi d’une pelle, et qui expliquât, par conséquent, la présence d’une pelle entre les bras du cadavre.
Il est cinq heures moins cinq. L’audience est suspendue pendant quelques minutes.
À la reprise, on entend un aubergiste de Belin, Thomas Matha, âgé de 45 ans qui a entendu ses clients dire que Mano vivait en mauvais termes avec les siens ; on a même ajouté qu’il avait exprimé des doutes sur la légitimité de la naissance de ses deux petites filles. L’accusé demande à Thomas Matha s’il connaît les personnes qui ont tenu ces propos. Thomas Matha répond qu’il était nouvellement installé à Belin, que c’était un jour d’affluence que celui où il a recueilli ces propos, que les personnes attablées dans son auberge étaient des étrangers, et que, dans ces conditions, le contrôle qu’on réclame de lui est difficile.
Marie Donnens, femme Rablade, 42 ans, cultivatrice à Tastous, a entendu dire dans le pays que Johannès doutait de la légitimité de ses deux petites filles.
Jeanne Mano, 42 ans, cultivatrice à Cestas, parente de Mano, a trouvé un mouchoir le jour de l’inventaire ; ce mouchoir avait des taches de sang ; il avait été trouvé dans la grange. Interrogé à ce sujet, l’accusé prétend que le mouchoir en question n’était pas à lui ; qu’il pouvait bien appartenir à ses parents.
Sébastien Gourdes, 33 ans, aubergiste et forgeron au Barbareau, dépose que Mano, le soir de l’enterrement de la belle-mère, a fait une partie de cartes avec lui ; puis il s’est couché et a dormi tranquillement ; Mano était à ce moment-là chez son oncle ; Sébastien Gourdes l’a gardé à vue toute la nuit, assisté de quelques métayers.
À une question du président, Sébastien Gourdes répond : « Mano a fait avec moi huit ou neuf parties, et il m’a fort bien gagné.» Mano répond qu’on lui a commandé de jouer ; que c’est le maire qui a conseillé à Sébastien Gourdes de lui proposer une partie. M. le maire proteste contre les insinuations de l’accusé ; ce n’est pas lui, affirme-t-il, qui a donné le conseil d’offrir à Mano la partie de cartes. Mano fait remarquer qu’il n’a joué que deux parties, qu’il n’y voyait pas, et que la tête lui tournait. On a vu, par la déclaration de Sébastien Gourdes, que la partie aurait été plus longue, et que Mano, y aurait vu très clair, puisqu’il aurait gagné tout le temps.
L’accusé se défend avec énergie ; il accuse le maire de mauvaise foi, et proteste contre tout ce qui vient d’être dit à propos de cette partie.
Le maire et Sébastien Gourdes affirment leurs dépositions et persistent quand même.
M. le Président fait observer à Mano que c’était là une partie horrible.
Mano répond que cette partie « il l’a acceptée exprès » car il la considérait comme un défi jeté par le maire.
L’incident est clos.
Sébastien Gourdes dépose, en outre, que le lendemain Mano ne se souciait pas de ses enfants, et qu’il a fallu lui rappeler que les petits n’avaient pas déjeuné. Johannès ne se préoccupait que de lui ; il disait : « C’est malheureux d’être accusé quand on est innocent ; mais jamais je n’avouerai, perce que je ne suis pas coupable ! »
Plus tard, le petit Bernardin, l’aîné des enfants de l’accusé, a dit à Sébastien Gourdes « qu’il aiguisait son couteau pour tuer son père, à cause qu’il avait tué tous ses parents. »
Sophie Tessandier, femme Chaudon, 26 ans, cultivatrice au Barp, le jour du crime, s’est employée à soigner la moribonde et à couvrir les cadavres des deux petites filles. Le lendemain, au moment de l’enterrement des quatre premières victimes, Mano se tenait auprès des petites filles ; il s’écriait : « Pauvre Marie, après on dira que c’est moi ! » Sophie Tessandier lui a dit : « Retirez-vous ! Si vous êtes innocent, défendez-vous ; si vous êtes coupable, vous êtes perdu. » Johannès a répondu : « À présent, je me défendrai ! » Sophie Tessandier, questionnée sur le point de savoir si la belle-mère de Mano était morte quand ce propos a été tenu, déclare que la vieille avait, en effet, cessé d’exister, mais qu’elle n’a pas interprété ces paroles, ainsi qu’on a pu le croire un moment.
Ici s’ouvre la série des dépositions relatives au pantalon que portait l’accusé la veille du crime.
Octavie Marthiens, femme Perrin, 34 ans, propriétaire au Barp : « J’ai donné des vêtements à Mano, parmi lesquels un pantalon bleu ; je lui avais fait ce cadeau au mois de mai 1871 après la mort de mon pauvre oncle ; Mano était bien reçu chez nous ; il avait ma confiance et celle de mon mari. Il couchait souvent dans la grange ou dans l’écurie ; jamais il n’avait couché avant la nuit du crime, dans le compartiment où il a été retrouvé le matin. »
Octavie Marthiens ne peut fixer l’endroit par où Mano est entré dans l’écurie ; elle croit que c’est par la petite porte qui a été trouvée fermée, tandis que l’accusation pense que c’est par la grande porte, qui a été trouvée le matin toute grande ouverte, malgré les précautions de Larrue, qui l’avait lui-même fermée la veille au soir.
M. le Président, à Octavie Marthiens : « Mano prétend qu’il vous a aidé à tuer un poulet. »
Octavie Marthiens : Non, monsieur ; Mano ne m’a pas tenu le poulet.
Mano affirme, à l’encontre des déclarations de Mme Perrin, qu’il a tenu le poulet. Octavie Marthiens maintient son assertion.
Interrogée, Mme Perrin dit que la terre trouvée dans les chaussettes était de la terre provenant de la route agricole ; elle ne sait quel pantalon Mano portait dans la journée du 9.
Le Président ordonne la lecture d’une importante déposition, la seule qui ait inspiré de la confiance à l’accusé : c’est celle de la femme Jeanne Rancinan, sa belle-sœur, morte depuis. Cette déposition ne dit rien de la couleur du pantalon, malgré les protestations de Mano, qui prétend que sa belle-sœur avait affirmé l’avoir vu le 9 avril avec un pantalon noirâtre.
Un bruit avait couru sur lequel le maire et le juge de paix sont consultés : à savoir s’il est vrai que Mano ait été l’amant de sa belle-sœur (M. le juge de paix et le maire disent que cela a été chuchoté avant le mariage de la femme Rancinan). Il résulte du débat que cela s’est dit dans le pays, mais qu’on n’y a guère ajouté foi.
Johannès Rancinan, 29 ans, résinier à Tournebride, frère du beau-frère de l’accusé, a rencontré Mano sur une route où il travaillait ; ils ont échangé quelques mots. Mano avait une blouse bleue à collet rouge et des sabots ; quant au pantalon, il n’a pas remarqué de quelle couleur il était.
Pierre Tarris, 53 ans, résinier au Barp, a vu Mano le 9 avril : il avait une blouse bleue à collet rouge, des sabots et un pantalon bleu. Pierre Tarris l’affirme.
Mano objecte que Pierre Tarris a pu le voir quelquefois dans ce costume, mais ce jour-là il s’est trompé.
Pierre Tarris rappelle qu’il a vu Mano le matin ; qu’il a déjeuné chez lui, dans sa propre maison ; qu’il s’est chauffé les pieds et a fumé sa cigarette ; qu’il ne s’est point trompé, qu’il est parfaitement sûr. Le pantalon était bleu, rayé de blanc.
Femme Augey (ou Auget), 40 ans, cultivatrice au Barp : J’ai vu Mano le 9, jour du crime, sur la route : il avait des pantalons bleus, j’en suis sûre ; il avait des sabots, une blouse. Son pantalon était raccommodé aux genoux, à petits points. J’étais à trois ou quatre pas. Le pantalon paraissait propre.
M. le Président à la femme Augey : Êtes-vous bien sûre que Mano n’avait pas de pantalon noir ?
Femme Augey : Oh ! oui ; le pantalon était un peu court.
Mano, interpellé : Eh bien s’il est court, on le verra ; je demande qu’on me le mette.
M. le Président : Eh bien ! nous verrons.
M. le Président à Mano : Portiez-vous des bretelles ?
L’accusé : Non, une ceinture.
Armant Salbert, 53 ans, forgeron à Salles : Nous avons bu à quatre heures de l’après-midi du 9 avril ; il était habillé d’une blouse bleue à collet rouge, de sabots et d’un pantalon bleu ; le pantalon était propre.
Mano soutient qu’il avait un pantalon noir ce jour-là.
M. le Président au témoin : Votre déposition est une des plus graves de l’affaire ; je vous adjure de dire toute la vérité.
Armant Salbert : J’en suis certain, absolument. J’ai fait toutes mes réflexions. Je ne me suis pas trompé. Le pantalon était à la longueur ordinaire.
Mano, avec emportement : Peut-on faire ainsi un faux serment ! Il a dit une chose, il ne s’en dédira pas
Grand mouvement dans l’auditoire.
Jeanne Ballion, 12 ans, demeurant au Barp, a vu Mano le 9 avril ; elle s’en retournait de l’école. Mano, le facteur, qu’elle a rencontré, lui a donné une lettre pour son père ; il était habillé d’une blouse bleue à collet rouge, d’une paire de sabots, et d’un pantalon bleu à petits points blancs. Le pantalon était « passé » (raccommodé) aux genoux. Jeanne Ballion, adjure de dire la vérité, répond qu’elle ne ment pas.
Mano reconnaît avoir rencontré Jeanne Ballion sur la route à la date indiquée, mais il nie qu’il eût un pantalon bleu.
Le Président rappelle qu’au cours de l’instruction, Mano a traité la femme Ballion de faux témoin.
Jeanne Ramon, 33 ans, aubergiste au Barp, a vu Mano le 8 avril, deux jours avant le crime ; il était habillé d’une blouse bleue à collet rouge et d’un pantalon bleu pointillé de blanc. Jeanne Ramon, interrogée sur la fixation de ses souvenirs, répond qu’elle est parfaitement sûre de sa mémoire.
Mano nie encore.
Jeanne Lacrampe, 45 ans, épicière au Barp, a vu Mano le 9 avril ; il a passé deux fois par devant sa porte ; il avait un pantalon bleu, il était vêtu de bleu.
Jeanne Lacrampe, sur les instances de M. le Président, affirme qu’elle vient de dire l’exacte vérité, qu’elle ne peut pas se tromper.
Mano réplique vivement que cela n’est pas vrai.
Jeanne Lacrampe persiste dans ses déclarations.
Julie Rostain, 59 ans, bonne du curé du Barp, a vu Mano, le 9 avril, assez bien pour avoir remarqué qu’il était habillé d’un pantalon bleu ; il revenait de sa tournée. Julie Rostain a échangé un mot rapide avec l’accusé. Elle a parfaitement reconnu le pantalon bleu qu’on lui a représenté au cours de l’instruction ; Mano l’a appelée « faux témoin » dans le cabinet du juge d’instruction.
À l’audience, Mano s’oublie jusqu’à l’apostropher très vivement.
Quelques murmures éclatent dans la salle.
La femme Julie Rostain dépose en outre sur des faits déjà connus, relatifs aux plaintes de la belle-mère, dont elle avait reçu les confidences pleines de craintes.
L’accusé : Je ne comprends pas qu’une femme qui est toujours dans 1’église puisse mentir ainsi, oser lever la main devant Dieu. Il ne faut pas avoir confiance aux dévots.
Murmures d’indignation.
Jean Courbin, 25 ans, sacristain, à Salles, a vu Mano le lundi 8 avril, deux jours avant la découverte crime ; il avait un pantalon bleu à points blancs, et un costume comme celui que l’on sait ; le pantalon était réellement bleu.
Mano se lève et appelle Jean Courbin « un faux témoin ». Il s’exprime avec une extrême vivacité.
Gustave Chaudon (ou Chambon), 30 ans, courrier de la Poste au Barp, a fait route, quelque temps avant le crime, avec Mano, qui lui a confié ses projets de séparation prochaine d’avec sa famille. Le 31 mars, jour de Pâques, il apprit de la vieille Mano que Johannès n’avait encore rien donné chez lui de son traitement ; il est vrai qu’il n’avait peut-être pas touché son mois.
Le 9 avril, Gustave Chaudon a vu Mano à trois reprises différentes : Mano portait un pantalon bleu, parfaitement bleu. Gustave Chaudon a vu Mano le 8 avril ; il ne peut pas dire s’il avait ce même pantalon bleu. Mais il affirme, sur l’honneur, que le lendemain, 9, Mano avait bien un pantalon bleu.
Mano, interpellé, oppose les mêmes dénégations.
Gustave Chaudon réplique qu’il est sûr, parfaitement sûr de ce qu’il avance.
L’audience est levée à sept heures et demie.
Malgré cette audience durant depuis dix heures du matin, une foule immense reste dans les salles, les tribunes et aux environs du Palais.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4713562h/f3n1.texteBrut
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k514258q/f3.item.r=ranc.zoom
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4612587s/f3.item.r=le%20barp%20%20tastes.zoom#
Audience du jeudi 13 mars
La foule se presse, plus serrée que jamais, dans les Pas-Perdus. Dès neuf heures, l’accès de la salle d’audience est devenu presque impossible. Il reste fort peu de places aux jurés libres et aux témoins entendus jusqu’à ce jour.
Mano est introduit à 10 heures moins un quart ; il a l’air très abattu, ses traits portent l’empreinte profonde de la fatigue des audiences précédentes ; son teint est cependant assez animé.
À dix heures dix minutes, l’audience est reprise.
Le petit Bernardin Mano est introduit. L’enfant a huit ans, le teint frais, les joues rondes, il a l’air fort intéressant.
Sa déposition est celle qui offre le plus d’intérêt.
Il répond assez bien aux questions d’usage.
M. le Président : Où est ta mère ?
Bernardin Mano : Je ne sais pas !
L’enfant, interrogé sur les faits dont il a déposé au cours de l’instruction, et que le lecteur doit se rappeler (voir l’acte d’accusation), commence par tout désavouer.
Le Président continu de le questionner :
M. le Président : Est-ce qu’il est entré un homme, la nuit, dans la maison ?
Bernardin Mano : Oui.
M. le Président : Était-il grand, cet homme ?
Bernardin Mano : Comme mon père.
M. le Président : À qui ressemblait cet homme ?
Bernardin Mano : À mon père.
M. le Président : Ce n’était pas ton père ?
Bernardin Mano : Je ne sais pas.
M. le Président : Est-ce que tu dormais ?
Bernardin Mano : Non.
M. le Président : Mais tu faisais semblant ?
Bernardin Mano : Oui.
M. le Président : Pourquoi ?
Bernardin Mano : Parce que j’avais peur.
M. le Président : Aimes-tu bien ton père ?
Bernardin Mano : Oui.
M. le Président : Aimais-tu bien ta maman et tes petites sœurs ?
Bernardin Mano : Oui.
M. le Président : Et ton pépé et ta mémé ?
Bernardin Mano : Oui.
M. le Président : Qui est-ce qui les a tués ?
Bernardin Mano : Je ne sais pas.
M. le Président : Comment s’appelle l’homme qui est entré la nuit dans ta maison ?
Bernardin Mano : Il s’appelle Mano.
M. le Président : Ce n’était pas ton père ?
Bernardin Mano : Je ne sais pas.
M. le Président, à voix basse d’un ton confidentiel : Dis-moi, mon enfant, rien qu’à moi, est-ce que tu voulais donner des coups de bâton à ton père ?
Bernardin Mano : Oui.
M. le Président : Et pourquoi voulais-tu battre ton père ; tu sais bien que c’est vilain ?
Bernardin Mano : Parce qu’il avait tué ma mère.
M. le Président : Est-ce que tu as aiguisé un couteau, un jour, dans une forge ?
Bernardin Mano : Oui.
M. le Président : Pourquoi donc ?
Bernardin Mano : Pour tuer mon père.
M. le Président : Tu voulais tuer ton père ! Et pourquoi ?
Bernardin Mano : Parce qu’il avait tué ma mère, mes deux sœurs, pépé et mémé.
M. le Président : Et pourquoi n’as-tu pas dit le lendemain que c’était ton père qui avait tué ta mère et tes sœurs, et tes grands parents ?
Bernardin Mano : Parce que j’avais peur.
M. le Président : Mais qui donc t’a dit de dire tout ça ? Tes camarades, ou Catherine Beyris ?
Bernardin Mano : Non, personne.
M. le Président : Tu n’as pas entendu ton papa et ta maman se disputer dans la nuit ?
Bernardin Mano : Si fait.
M. le Président : Qui est sorti d’abord de la maison ?
Bernardin Mano : Ma mémé.
M. le Président : Et après ?
Bernardin Mano : Ma mère.
M. le Président : Et après encore ?
Bernardin Mano : Mon pépé.
M. le Président : As-tu entendu crier ?
Bernardin Mano : Oui.
M. le Président : Que disait la personne, qui criait !
Bernardin Mano : « On me tue ! on me tue ! »
M. le Président : As-tu du chagrin de leur mort ?
Bernardin Mano : Oui.
Ce douloureux interrogatoire se termine par quelques questions de détail, auxquelles l’enfant répond dans le sens indiqué par l’acte d’accusation.
M. le Président : Mano, votre enfant m’a fait des réponses diverses et contradictoires. Il m’a déclaré qu’un homme était entré dans sa chambre, que cet homme portait des culottes ; qu’il les avait jetées derrière le moulin, puis, qu’il les avait mises dans le coffre. Il a dit ensuite que cet homme ressemblait à son papa ; mais qu’il ne savait pas si c’était son père. Il a ensuite dit qu’il voulait battre son père et le tuer, parce qu’il avait tué sa mère. Il a enfin reconnu que c’est vous qu’il a vu dans sa chambre. Qu’avez-vous à répondre ?
Mano : Monsieur le président, demandez à l’enfant quelle est la personne qui lui a commandé de lui dire tout cela ; si ce n’est pas Catherine Beyris.
L’enfant interrogé, répond : Non, personne ne me l’a commandé.
Et à toutes les questions que le président lui adresse, les mêmes qu’il lui a déjà faites, les mêmes qu’on lui a posées au cours de l’instruction, l’enfant répond « oui, » sans varier.
Le Président, mu par les sentiments d’impartialité qui doivent animer tout magistrat, retourne les questions et les pose à l’enfant dans les termes les plus favorables à l’accusé ; mais l’enfant fait toujours la même réponse : Personne ne m’a commandé de parler ; c’est mon père qui a tué ma mère !
Le moment est solennel ; l’auditoire, où d’ordinaire les murmures les plus divers éclatent à l’audition de certains témoins principaux dans les affaires d’une grande gravité, l’auditoire est muet ; on sent qu’une poignante émotion étreint toute l’assistance.
Le Président parle à l’enfant et à Mano avec une grande douceur.
L’accusé change d’attitude brusquement. Son arrogance vient de l’abandonner ; sa voix, éclatante jusqu’à hier soir, s’est voilée ; elle est devenue très faible ; par moments, cependant, elle reprend un peu de sonorité.
L’accusé, sur l’invitation à lui faite par le Président, une fois l’interrogatoire de Bernardin fini, de questionner son fils, l’accusé répond qu’il n’a rien à demander à son enfant, puisqu’on lui a commandé de parler ainsi.
L’interrogatoire de Bernardin, si douloureux qu’il puisse être, est refait trois fois ; le Président, visiblement ému, recueille d’abord ses réponses du haut de son fauteuil, puis il prend l’enfant et le place près de lui, à côté du chef du jury ; là, il l’interroge une deuxième fois ; puis, enfin, il se déplace encore et confronte le pauvre petit garçon avec l’accusé. C’est alors, après avoir entendu pour la troisième fois les affirmations de son fils, que Mano se refuse à lui poser des questions.
Le jeune Bernardin est retenu quelques instants encore pour répondre à des questions posées par la défense. Il désigne avec une étonnante précision, sur le plan géométral, la place qu’occupait chacun des objets mobiliers de la métairie de Tastous ; il montre successivement tous ces objets sans se tromper une seule fois. L’enfant, à qui l’on demande si on lui a montré des images, dit qu’il en a vu entre les mains des témoins : il fait allusion, probablement, à des plans géométraux publiés par des journaux.
L’enfant est renvoyé à onze heures vingt minutes ; il n’a pas été retenu moins d’une heure et quart.
Les témoins qui suivent déposent sur les révélations faites antérieurement dans le pays par le jeune Bernardin.
Michel Delys, 26 ans, instituteur communal au Barp, a conseillé, dans les premiers jours, à ses élèves, de ne point interroger l’enfant au sujet du massacre de Tastous.
Le 5 juillet, au matin, un des élèves vint me rapporter que Bernardin avait raconté les allées et venues de son père pendant la nuit ; le récit était très précis.
Suivent les détails que le lecteur connaît sur ce point…
Michel Delys, sa déposition achevée, affirme que si l’enfant n’a pas parlé plus tôt, c’est qu’il paraissait en proie, à une grande souffrance, et que personne ne l’a tracassé par d’inopportunes questions. Bernardin, frappé outre mesure par tout ce qu’il avait vu, n’osait plus parler, et il avait une peur extrême de son père.
Paul Balliet, 11 ans, écolier au Barp, a reçu les déclarations spontanées de l’enfant ; il a su de cette façon que celui qui avait tué les Mano c’était Johannès ; « c’est mon père ! » dit l’enfant.
Suivent les détails de l’entretien des deux enfants.
Pierre Téchouerre, 14 ans, boulanger au Barp, a prévenu l’instituteur des propos accusateurs tenus à Balliet par Bernardin.
Lamy Duphyl, 12 ans, confirme les déclarations précédentes.
Adolphe Ballet, 11 ans ; Chéri Dupont, 8 ans ; Maurice Mano, 8 ans, font les mêmes dépositions.
Voici une des dernières dépositions, celle de M. Perrin, qui est encore terrible pour l’accusé ; Maxime Perrin, quarante ans, propriétaire au Barp, est le neveu des Marthiens, propriétaires de la métairie de Tastous. L’émotion que provoque ce témoin est justifiée par l’intérêt qu’il portait à l’accusé, et le chagrin qu’il ressent depuis que Mano est sous la main de la justice ; c’est une des personnes les plus intimement liées aux débats, en ce sens que Mano était, dans sa maison, l’homme de confiance. On a vu que, pendant ses absences du Barp, M. Perrin confiait à l’accusé, soit pendant le jour, soit pendant la nuit, son intérieur, ses affaires, avec le plus entier abandon, et jamais il n’avait eu à se plaindre de cet excès de confiance.
Perrin est le maître de l’Hôtel de la Poste ; Mano couchait souvent chez lui, comme il y a couché le soir qui précéda le crime. Jusqu’au dernier moment il a cru en l’innocence du facteur. Quand il le sut sous le coup de poursuites, il l’engagea à fuir.
Invité à refaire aussi complètement que possible l’épouvantable histoire du massacre de Tastous, Maxime Perrin commence ; mais bientôt il s’arrête, les larmes jaillissent de ses yeux, et l’émotion le force à s’asseoir. Cette émotion est si grande, que le Président suspend l’audience durant cinq minutes, afin de donner à Maxime Perrin le temps de se remettre.
À la reprise de l’audience, Maxime Perrin n’est pas encore parvenu à reprendre empire sur lui-même ; il pleure abondamment et tremble de tous ses membres. Il s’excuse et dit que ce n’est point de parler en public qu’il est ému, mais que c’est parce qu’il revoit aujourd’hui tous ces pauvres corps mutilés, tant ce deuil, toute cette désolation de Tastous, et qu’il sent Mano si gravement compromis, « Mano, qu’il affectionnait et qu’il chérissait tant! »
Mano : Monsieur le Président, si M. Perrin m’aimait, c’est que je n’étais pas un mauvais garnement.
le Président, faisant allusion à la douleur de Perrin : « Ah ! Johannès, si seulement vous aviez pu verser une de ces larmes, une seule ! »
Mano : Je ne peux pas pleurer ! Alors on dit que je n’ai pas de cœur.
le Président : Allons, taisez-vous, vos paroles ne vous font pas beaucoup de bien.
Tout le monde, dans l’assistance, a les larmes aux yeux.
Maxime Perrin, après avoir, raconté toutes les horribles scènes que l’on sait, déclare que seul, pendant trois jours, il a défendu Mano contre le sentiment implacable de tout le monde, parce qu’il le croyait innocent. Mais, ajoute-t-il, c’est le 12 au soir, tandis que le dernier cadavre quittait la maison, c’est alors que j’ai eu le soupçon de la culpabilité de Johannès. La pauvre belle-mère allait être enterrée ; le corps était à peine à 150 mètres de la métairie, Johannès, en ce moment, s’occupait du soin de vendre des volailles et des lapins, que les métayers élevaient de leur vivant. Johannès débattait le prix de deux lapins avec un paysan : « Tu ne les auras pas à moins de 1 fr50 c la pièce ; tu as déjà acheté une paire de poulets à trop bon marché ; si j’avais été là, tu ne les aurais pas eus. »
Perrin répète que, dès ce moment, le soupçon naquit dans sa pensée.
Le trouble, un trouble profond l’assaille à nouveau ; les larmes coulent encore ; un huissier est obligé de lui porter à boire.
La déposition de M. Perrin se prolonge fort longtemps ; elle a trait à tout ce qui s’est passé durant les premières phases de l’instruction. Nous n’y reviendrons pas.
Seulement, un fait matériel est révélé aux débats, lequel se rapporte à la déposition de l’enfant. « Quand les maçons eurent découvert les taches de sang sur la muraille, dit Perrin, la justice revint sur les lieux et fit mander le petit Bernardin. L’enfant avait quitté les lieux depuis le jour du crime et n’avait plus reparu à Tastous. » M. le juge d’instruction au petit Bernardin lui demande s’il savait qu’il y eût du sang dans sa maison ; l’enfant répondit: « Oui ! » À quel endroit était ce sang ? L’enfant répondit que c’était sur la muraille. S’il le retrouverait ? L’enfant répondit : « Oui ! » Sur l’invitation du magistrat, le petit Bernardin a marché vers l’endroit de la muraille où était, en effet, le sang, et l’a montré sans hésiter davantage. Toutes les personnes présentes à cette scène sont restées convaincues que l’enfant devait connaître depuis longtemps l’existence de ces taches.
Perrin parle encore pendant près d’une demi-heure sur des questions de détail. Répondant à une dernière question du Président, Perrin dit : « Je l’ai déjà dit dans ma déposition, Monsieur le Président, je crois depuis longtemps que Johannès est coupable. »
M. le Président : Je prie le témoin de répondre à une question : il a cru Mano innocent, le croit-il encore ?
Perrin : J’ai douté longtemps, je ne doute plus.
L’accusé : Monsieur Perrin, vous avez été plusieurs mois à me soutenir contre tout le monde. Je vous trouve bien changé. Vous dites comme les autres, à présent. On vous a influencé.
Mouvement de réprobation au fond de la salle.
Perrin : Mano, vous me connaissez, vous savez que je suis incapable d’obéir à une influence. Je parle selon la vérité et selon mes convictions. En joignant ma voix à celle de l’accusation, je n’ai pour guide que ma conscience ! Johannès, je voudrais vous croire innocent, car alors vous reviendriez sans doute parmi nous ; mais, malheureusement, vous êtes coupable pour tous et pour moi.
Sensation prolongée.
Maxime Perrin est neveu de M. Marthiens, propriétaire de la métairie de Tastous. Il fut, comme tel, amené à des constatations dont il rend compte : en octobre dernier, les maçons travaillaient à la ferme. J’arrivai là un mercredi avec M. Roumegoux. Les ouvriers me dirent qu’ils venaient de découvrir des taches de sang sur les murs de la chambre des garçons. Je vérifiai aux endroits signalés par les maçons et je vis des taches qui me parurent avoir été faites ou par des gouttes de sang ou par le frottement d’un linge ensanglanté. Un groupe de taches de sang à quelques centimètres de la ligne qu’atteignait le moulin ; des taches de sang, mais celles-là plus petites, à un mètre cinq centimètres du sol, et rapprochées d’une légère brèche dans le mur, brèche due à l’une des charnières du coffre. J’ai donné aux ouvriers l’ordre de cesser les travaux, et je fermai la maison, qui est restée close jusqu’à l’arrivée de M. le juge d’instruction.
Tout cela a été dit d’une voix entrecoupée. Un murmure de sympathie accompagne M. Perrin jusqu’à sa place qu’il regagne péniblement.
M. le professeur Roussin est retenu à Paris, par la maladie.
L’audience est levée.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k46125886/f3.item.r=13%20mars%22affaire%20mano%22.zoom
Audience du 14 mars 1873
La salle d’audience est tumultueuse, des cris, des bousculades, la gêne, la difficulté de la circulation, les saluts échangés, les politesses rendues, tout donne à l’audience aujourd’hui une physionomie plus animée que jamais.
L’accusé est introduit 10 minutes avant l’ouverture ; il laisse voir sur son visage un abattement profond ; il a la voix faible, le regard fatigué, le geste découragé.
L’affluence est si grande, le désordre est tel dans la salle que l’audience ne peut être commencée qu’à 10 heures 20 minutes.
Pendant deux heures environ les pièces à conviction de toute nature — et elles sont nombreuses — passent sous les yeux des membres du jury. Les vêtements de Mano et les meubles de la métairie de Tastous font l’objet de longues discussions de détail, provoquées tant par la défense que par le jury.
Plusieurs témoins, ceux dont la déposition se rattache à la production des pièces à conviction, sont rappelés et entendus rapidement. Ils confirment tout ce qu’ils ont déjà déposé soit à l’audience de mercredi, soit à celle de jeudi.
L’accusé demande à revêtir le pantalon bleu, afin de montrer aux jurés s’il est réellement aussi court que l’ont déclaré certains témoins. L’audience est suspendue pendant dix minutes. À la reprise de l’audience, Johannès Mano est revêtu de son pantalon bleu. Ce pantalon est court, en effet. L’accusé objecte aux observations du président que c’est là la longueur habituelle des pantalons portés par les gens de la campagne.
Il est midi un quart ; M. l’avocat général Fauconneau-Dufresne, chargé de soutenir l’accusation, prend la parole.
Voici comment La Gironde résume son réquisitoire, ainsi que le plaidoyer de Me de Brezetz, avocat chargé de la défense :
M. Fauconneau-Dufresne se lève au milieu d’un silence religieux. Il a l’air d’être profondément ému, non pas parce qu’il porte pour la première fois à Bordeaux la parole dans une affaire criminelle, mais parce que la cause est en elle- même exceptionnelle.
M. Fauconneau-Dufresne est un homme doué d’une parole abondante et incisive ; dans un exorde dont nous ne pouvons qu’imparfaitement reproduire les termes, il dit que Johannès Mano vient répondre, devant le jury de la Gironde, à une épouvantable accusation de quintuple assassinat
Il a sacrifié, dit-il, sans pitié, comme sans remords, ceux-là mêmes qui se rattachaient le plus intimement à lui par les liens étroits de la famille. Il a frappé les parents de sa pauvre femme ; il a frappé sa femme ; il a frappé même ses deux pauvres petites filles, parce qu’elles avaient le tort impardonnable de survivre à ceux qui les avaient aimées ; parce qu’elles étaient un trop lourd fardeau pour ses épaules !…
L’information devait être longue pour une affaire si horrible, si ténébreuse ; les témoins manquaient On n’avait en face de soi qu’un seul inculpé, qu’un seul homme, impassible, impénétrable ; et la seule femme qui avait pu échapper au massacre, le seul être qui eût pu éclairer la justice des hommes, agonisait, en proie à des douleurs inexprimables… »
M. l’avocat général, à ce moment, fait rapidement l’éloge du magistrat instructeur qui a montré une persévérance inaltérable durant cette longue instruction ; il rend hommage à la conscience loyale et ferme du magistrat qui a présidé ces débats douloureux ; et, ce devoir accompli :
« J’espère, messieurs, poursuit-il en s’adressant aux jurés, j’espère, avec tous les éléments d’accusation que je vais soumettre à votre jugement, arriver à la manifestation de la vérité. Les charges sont trop accablantes pour que vous puissiez y résister ; la lumière vous inonde, et si j’avais éprouvé quelque hésitation à l’endroit de la culpabilité de l’accusé, je frémirais à l’idée de la responsabilité que j’encours en développant, en soutenant devant vous cette vaste accusation. Mais non, la lumière est trop évidente. »
L’avocat général entre alors dans le cœur même du procès, et il s’attache à faire la preuve de tous les griefs reprochés à l’accusé. Son argumentation est serrée, impitoyable. Il retrace à grands traits l’histoire des antécédents de Mano, de sa femme, de ses parents par alliance ; il développe, comme premier élément d’appréciation, l’inconduite de l’accusé, qu’il met en opposition avec les excellents exemples que le malheureux eût dû puiser au sein de cette laborieuse et honnête famille.
Nous ne pouvons entrer, on le comprend, dans tous les détails de cette longue démonstration, non plus que dans le développement des charges qui pèsent sur l’accusé et que le ministère public matérialise en quelque sorte.
Retraçons seulement l’ordre dans lequel se sont produites les preuves que l’accusation s’est efforcée d’établir. Les antécédents, on vient de le voir, les mésintelligences perpétuelles qui aigrissaient chacun des habitants de Tastous ; les violences de l’accusé envers les siens ; ses menaces ; les pressentiments sinistres de la vieille belle-mère ; et puis l’examen des cadavres ; l’idée qu’un seul meurtrier avait donné la mort aux cinq victimes, idée venue de la similitude des blessures, qui dénonçait un seul et même instrument, et de la région, toujours la même, où les plaies s’étaient ouvertes, toutes ces considérations doivent, en effet dégager le débat de cette préoccupation qu’il pourrait y avoir eu plusieurs assassins ayant usé d’instruments divers.
Revenant à l’accusation qui atteint Johannès Mano, l’avocat général s’attache à démontrer que le crime de Tastous n’est point imputable à des étrangers ; ceux-ci, en effet, eussent pillé la maison, et s’ils avaient été contraints à l’assassinat, n’eussent pas distingué parmi les victimes, et auraient vraisemblablement tout immolé à leur rage.
L’incident du chien, qui ne donne pas l’alarme durant la nuit du crime, qui veille tout le temps auprès du cadavre de son maître infortuné, et qui, le lendemain, s’éloigne manifestement de Mano qu’il connaissait pourtant bien, a été signalé aussi par M. l’avocat général.
Viennent enfin les preuves et les présomptions les plus accablantes dans ce débat, qui passionne depuis si longtemps et à un si haut degré l’opinion publique. Nous voulons parler du changement de pantalon ; de l’existence sur les vêtements de l’accusé des taches de sang accusatrices ; de la connaissance exacte des lieux, qui a permis à l’assassin de se guider dans les ténèbres sûrement pour trouver le terrible instrument du crime et l’aller remettre à sa place, et qui lui a permis aussi de frapper avec tant d’assurance ses tristes victimes, soit qu’il les ait atteintes en plein air, soit qu’il les ait frappées à l’intérieur de l’habitation.
Revenant au fait du pantalon, l’organe du ministère public rappelle que des témoins nombreux sont venus affirmer, sous la foi du serment, qu’ils ont vu, la veille du crime, l’accusé vêtu d’un pantalon bleu ; que lui-même déclare et affirme ne pas être rentré à Tastous ce jour-là ni ce soir-là, et que le lendemain, cependant, on le trouvait vêtu d’un pantalon noir :
« Avez-vous donc, au Barp, un dépôt d’effets de rechange, s’écrie l’avocat général en se tournant vers Mano, que vous ayez revêtu, le soir du 9 avril, un pantalon noir, vous qui portiez dans la journée un pantalon bleu ? Non ; car vous n’eussiez pas manqué d’opposer à l’accusation cette circonstance, qui vous eût été si favorable ! »
L’honorable organe du ministère public n’oublie pas que la discussion doit embrasser aussi le développement des présomptions nées de l’attitude de l’accusé en présence des victimes : le tableau qu’il fait à ce sujet est saisissant d’horreur ; il essaie d’établir en même temps que le crime a été commis au milieu de la nuit…
Et, en terminant : « Messieurs les jurés, s’écrie l’avocat général, ma conviction est inébranlable ; l’assassin de Tastous, le voilà, c’est Johannès Mano ! La mémoire de ce crime effroyable dépassera les plus lugubres souvenirs des annales judiciaires. Si vous partagez ma conviction, prononcez-vous dans la loyauté de vos consciences. Quant à moi, je suis absolument convaincu. C’est l’expiation suprême qui attend Johannès Mano, et cette expiation, je viens la demander à votre haute impartialité. »
L’audience est suspendue pendant une demi-heure ; à la reprise, la parole est au défenseur de l’accusé.
Me de Brezetz, dont la plaidoirie se prolonge de trois heures et demie à sept heures et demie, commence, comme l’a fait M. Fauconneau-Dufresne, par rendre hommage à la justice ; il la remercie des efforts qu’elle a déployés dans la recherche de cette vérité, peu dégagée encore, selon lui, des ténèbres qui enveloppent la cause. L’honorable défenseur se demande si les jurés, dont la décision va être souveraine, possèdent cette vérité : « Mano, dit-il, est le plus malheureux des hommes, s’il n’est le plus profond des scélérats. Si Mano est reconnu absolument coupable, que les juges soient sans pitié ; mais si cette culpabilité n’est pas établie, si le doute tourmente encore la conscience de ses juges, qu’il soit sauvé ! qu’il soit sauvé, au nom de la justice, au nom de la société, au nom de l’humanité ! »
Et l’avocat, reprenant un à un tous les griefs, tous les arguments du réquisitoire, dispute, durant quatre heures, la tête de son client à la justice des hommes. Il combat énergiquement, mais sans toutefois sortir de la modération de langage à laquelle il nous a accoutumés, les dépositions de chacun des témoins ; il admet que les témoignages doivent s’être produits sincèrement ; mais il démontre qu’ils ne se sont produits que sous l’influence irrésistible de 1’opimon publique, qui, dès les premiers jours, accablait Mano et le condamnait sans l’entendre.
Me de Brezetz a accompli sa mission avec conscience, avec talent. Rien n’a été négligé par lui dans la longue discussion des motifs pouvant protéger son client contre un de ces verdicts inexorables qui ne laissent à la justice aucun moyen d’atténuer la peine, et qui enlèvent au coupable tout espoir dans l’avenir, toute possibilité de retour à des sentiments meilleurs.
M. l’avocat général Fauconneau conclut à la peine de mort.
Le verdict ne sera rendu que dans la nuit.
L’audience, interrompue à six heures, est reprise à huit heures.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k31256586/f3.item.r=mano%20tastous.zoom#
Le verdict, … au bénéfice du doute !
Cette fois nous nageons en plein dans le crime et dans l’horreur. La France aussi bien que l’étranger fournit son contingent à cette chronique sanglante : l’Angleterre a la femme Cotton, la France a Johannès Mano ; on ne peut nier que l’Angleterre ne l’emporte en cette circonstance : Johannès Mano n’a tué que cinq personnes ; la femme Cotton en a mis trente à mort, sans compter celles de ses victimes qui peuvent n’avoir pas été découvertes…
Laissons les juges de Durham faire leur œuvre, et revenons en France, où nous trouvons l’assassin de Tastous sur les bancs de la cour d’assises de la Gironde. Il y a presque un an, le 10 avril, que fut commis ce crime exécrable. Un beau matin, dans la métairie du Tastous, habitée par la famille Mano, on relève cinq cadavres mutilés. Le vieux père et la vieille mère Mano ; leur fille, la femme Johannès, deux de leurs enfants, ont été assassinés pendant la nuit. Seuls les deux plus jeunes enfants, un petit garçon de trois ans et un autre de sept ans ont été épargnés… Ce sont ces deux pauvres petits êtres qui, rencontrés errants sur la route, bégayèrent les premières révélations… « Vite à la maison ! s’écrie le plus grand des deux ; maman, mémé, pépé sont morts ». On court à la métairie et l’affreuse vérité se fait jour : cinq cadavres sont là. On n’a rien entendu dans le voisinage ; le chien n’a pas aboyé, et Johannès, mari, gendre et père des victimes, n’est pas là.
Qu’était-ce Johannès ? Le facteur rural dont on ne dit pas grand bien ; on le sait joueur, buveur, dissipé. On n’ignore pas qu’il a de fréquentes discussions, des querelles violentes avec ses parents ; qu’il a été question tout récemment de son départ de la métairie. Il est le premier soupçonné et bientôt accusé positivement. La singularité de son attitude en présence des cadavres n’a pas peu contribué à fortifier les présomptions. Il s’est montré froid, farouche, presque indiffèrent. Il est arrêté, on instruit, et le détail le plus dramatique se produit dans l’instruction. Le fils aîné de Mano, cet enfant de sept ans dont nous avons parlé, fut un jour surpris aiguisant un couteau sur une pierre. Quand on lui demande la raison de cette action, l’enfant répond froidement et avec un étrange accent : « Ce couteau, c’est pour tuer papa qui a tué maman, mémé et pépé » L’enfant a vu Mano, pendant la nuit sinistre, se glisser dans la chambre où il couche à côté de son petit frère, s’approcher du lit où l’enfant fait semblant de dormir, retenant son souffle : le père secoue les deux dormeurs pour s’assurer de leur sommeil ; et le petit voit Johannès déposer sur un coffre le pantalon qu’il portait dans la journée, un pantalon bleu qui a joué un grand rôle dans l’affaire ; c’est ce pantalon fatal qui perd l’accusé, l’enfant l’a vu, plus d’un voisin l’a remarqué. Le lendemain du crime alors que Johannès prétend n’être pas rentré chez lui, le pantalon bleu, pointillé de blanc, qu’il portait la veille, fait place à un pantalon noir que Johannès soutient n’avoir pas quitté.
La question est grave. Les témoignages de l’enfant concordent avec les dépositions des voisins, le pantalon bleu retrouvé maculé de sang portant de nombreuses traces de sang, tout cela doit contribuer à ruiner le système de défense de l’accusé, système consistant à tout nier. Mais enfin, il s’est trouvé tant de personnes pour indiquer le fameux pantalon bleu, que Johannès, agacé, finit par perdre beaucoup de son assurance, et qu’on l’a vu sortir tout à coup de l’impassible et froide réserve où il s’était renfermé obstinément jusqu’alors : de dédaigneux, il devient arrogant, insultant les témoins, criant au mensonge, évidemment fort mal à son aise.
La confrontation de Johannès avec son fils devenu son accusateur n’a pas laissé d’être émouvante. L’enfant s’est avancé un peu timidement d’abord, mais après quelques hésitations de langage, il renouvelle sa déposition foudroyante. Pendant une heure et demie il est resté en face de l’accusé sans baisser le regard, sans plus se laisser intimider, sans se montrer le moins du monde ébranlé, maintenant ses accusations, affirmant le meurtre et dénonçant le meurtrier. Pour cette fois, Johannès retrouve son impassibilité, i1 reste maître de lui-même, il se contente de dire d’un ton hypocrite : « Pauvre enfant, on t’a poussé à mentir. »
Des dépositions accablantes pour l’accusé se sont produites dans les deux dernières audiences.
Après avoir entendu l’avocat général et la défense de l’avocat de Mano, le jury s’est pénétré de ces paroles honnêtes et intelligentes ; il a écouté le résumé des débats, résumé consciencieux, digne du magistrat qui l’a prononcé.
Après une délibération d’une heure et quart, sur les vingt-huit questions qui lui sont posées, le jury, au bénéfice du doute, répond par un verdict de culpabilité, tempéré par les circonstances atténuantes.
Ce verdict est rendu à 1 heure et demie du matin.
La Cour « condamne Mano aux travaux forcés à perpétuité » … seulement !
Le condamné, interrogé par le Président, qui lui demande s’il n’a aucune observation à faire sur l’application de la peine, répond : « Monsieur le Président, la justice n’est pas juste, car je suis condamné étant innocent ! »
Il faut bien le dire, ces paroles ne produisent aucune impression favorable sur le public, et Mano n’a même pas soulevé cette pitié suprême qui s’attache à ceux que frappe le bras justement vengeur de la Société.
L’audience est levée.
Le Petit Journal des Tribunaux, 23 mars 1873
Bordeaux, 2 h matin : À l’instant, on nous assure que Mano s’est pourvu en cassation, contre l’arrêt de la Cour d’assises. En raison de l’importance de l’affaire Mano, notre rédacteur en chef, L. Fleury, a dû suspendre sa Causerie judiciaire, pour ce numéro seulement. Nous recevons à l’instant de notre correspondant de Londres, les débats in extenso de l’affaire Mary Cotton, dix-neuf empoisonnements, et sa condamnation, que nous publierons dans le prochain numéro.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9773291w/f1.item.r=barp%20mano.zoom
Pour en savoir davantage sur l’affaire Mary Cotton :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5737389g/f8.item.r=%22johann%C3%A8s%20mano%22.zoom
Au lendemain de la condamnation prononcée par la Cour de la Gironde, M. le Président des assises reçoit une lettre anonyme, dont l’auteur innocente Mano en se déclarant seul coupable des assassinats de Tastous
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k458709s/f2.image.r=tastous
Arrêt de renvoi
17 avril 1873
Au nom du Peuple français,
La cour de cassation a rendu l’arrêt suivant sur le pourvoi de Jean Mano, dit Johannès, en cassation d’un arrêt rendu le 15 mars dernier, par la cour d’assises de la Gironde, qui l’a condamné aux travaux forcés à perpétuité.
La cour ouï M. le conseiller Robert de Chènevière, en son rapport, M. de Chambareaud, en ses observations pour le demandeur en cassation, M. Bedarrides, avocat-général en ses conclusions ; sur l’unique moyen pris de la violation de l’art. 372 du code d’instruction criminelle, en ce que le procès-verbal des débats mentionne en dehors du cas prévu par l’article 318 du même code, la substance de la déposition de plusieurs témoins relative à l’une des charges de l’accusation portée contre Mano.
Vu le dit article 372 ainsi conçu : « Il ne sera fait mention, au procès-verbal, ni à des réponses des accusés, ni du contenu aux dépositions des témoins, sans préjudice toutefois de l’exécution de l’article concernant les changements, variations ou contradictions dans les dépositions des témoins ; etc. ; les dispositions du présent article seront exécutées à peine de nullité. »
Attendu que l’instruction devant la cour d’assises est essentiellement orale et que la prohibition de l’article susvisé a pour but d’empêcher qu’elle ne dégénère en une instruction écrite qui pourrait ultérieurement, si la procédure annulée revenait devant d’autres jurés, être invoquée comme preuve ;
Attendu qu’après avoir constaté que le président, au cours des différentes audiences, a fait représenter, tant à l’Accusé qu’aux témoins, les objets déposés sur le bureau et servant de pièces à conviction, le procès-verbal ajoute qu’à celle du 14 mars, neuf de ces témoins ont été rappelés et ont reconnu, après les avoir bien examinés, pour être ceux dont l’accusé était porteur dans la journée du 9 avril, le pantalon et la blouse qui leur ont été présentés.
Attendu que la reconnaissance des pièces à conviction, qui est une partie essentielle de la déposition des témoins que, dans l’espèce, cette reconnaissance avec les particularités que les témoins y ont rattachées, reproduisait la substance même des déclarations par eux faites au cours du procès et sur l’un des points fondamentaux de l’accusation.
Attendu que cette reproduction, consignée au procès-verbal, n’était motivée par aucuns changements, additions ou variations qui auraient existé entre la déposition orale des témoins et leurs déclarations précédentes ; qu’ainsi elle ne saurait s’habiliter de l’exception apportée par l‘art. 318 aux prohibitions de l’art. 372 du code d’instruction criminelle d’où il suit qu’il y a eu violation formelle des dispositions de ce dernier article pour ces motifs, faisant droit au pourvoi de Mano.
Casse et annule les débats, la déclaration du jury et l’arrêt de condamnation rendu le 15 mars 1873, par la cour d’assises de la Gironde.
Et pour être statué conformément à la loi sur l’accusation portée contre ledit Mano Johannès, le renvoie en l’état où il se trouve et les pièces du procès devant la cour d’assises du Lot-et-Garonne, a ce spécialement déterminée par délibération prise en chambre du conseil.
Ordonne qu’à la diligence du procureur général, le présent arrêt sera transcrit en marge de la décision annulée.
Renvoi, à Agen-même
Si le mystère a sur l’esprit humain un irrésistible et poignant empire, c’est surtout lorsque, de la vérité, dépendent le sort et la vie d’un homme. De là, ces causes célèbres qui ont le don de remuer profondément le cœur des masses ; de là, ces grands procès qui passionnent la foule.
Aucune cause judiciaire, depuis bien longtemps, n’avait réuni au même degré que l’affaire Mano les conditions auxquelles le mystère ajoute son saisissant intérêt. L’affreuse tragédie de Tastous n’est pas seulement l’un des forfaits les plus exécrables qui aient ensanglanté les annales criminelles, elle reste encore une énigme, même aux yeux de ceux qui ont porté dans la découverte du mobile, des intentions et de la personnalité du vrai coupable, leurs plus minutieuses investigations.
Nous le disions au lendemain du verdict rendu par le jury de la Gironde, la loi s’est prononcée et, néanmoins, le doute et l’incertitude persistent et pendant que les uns trouvent trop douce la sentence qui ne condamne qu’à une peine perpétuelle celui qui, ajoutent-ils, a mérité la mort, d’autres s’élèvent contre un arrêt rendu en dépit d’une insuffisance de preuves qui devait, d’après eux, suffire à disculper l’accusé.
Deux mois se sont écoulés et le procès Mano, par décision de la Cour de cassation, va revenir, le 13 juin, aux assises du Lot-et-Garonne.
Le facteur Johannès aura encore pour avocat l’éloquent Me de Brezetz, qui semblerait avoir recueilli des données importantes et jusqu’ici ignorées, dans l’intérêt de sa défense.
L’accusation, de son côté, n’est pas restée inactive : quinze ou vingt dépositions nouvelles ont été recueillies par l’instruction. Parmi les cent cinq témoins entendus aux assises, un certain nombre a été l’objet d’interrogatoires ultérieurs ; quelques-uns, parait-il, auraient contredit leurs premières assertions tandis que d’autres, assure-t-on, se montreraient plus énergiquement affirmatifs que précédemment.
Quoiqu’il en soit, tout fait présager que le retentissement sera, à Agen-même[1], plus considérable encore qu’à Bordeaux.
« Agen-Même ». L’expression, que l’on retrouve déjà dans les écrits Nostradamus qui vécut six années à Agen au début du XVIe siècle ; il l’utilise dans son traité des Fardements et des Confitures paru en 1552 : « J’ay autrefois practiqué […] la plus grande part au pays d’Agenois, à Agen mesmes. » est donc très ancienne et a la dent dure. Elle reste, aux oreilles de ceux qui ont l’habitude de « faire le boul’ » (percé en 1880 sous le mandat de Jean-Baptiste Durand) non loin des « quatre-feux » (qui ne sont plus que trois), une façon de désigner Agen « intra-muros », cette ville bien ancrée sur la rive gauche de Garonne et à ne surtout pas confondre avec la voisine, rive gauche, du Passage-d’Agen.
La Gironde annonce que deux magistrats de la cour d’Agen, MM. Roë, procureur général, et Audidier, conseiller, désigné pour présider les assises de juin devant lesquelles va être portée l’affaire Mano, ont dû partir jeudi matin 15 mai pour Tastous et le Barp, afin de visiter les lieux du crime ; Me Brezetz, défenseur de Mano, accompagne ces deux magistrats. La même précaution avait été prise à Bordeaux, en février dernier, par M. l’avocat général Fauconneau-Dufresne, qui avait été chargé de soutenir l’accusation, et par M. Habasque, conseiller, Président de la session criminelle.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7556811d/f3.item.r=%22johann%C3%A8s%20mano%22Brezetz.zoom#
Mano dans sa prison
Johannès Mano, dont on a, depuis quelques jours, demandé le transfèrement, quitte le Fort du Hâ le mercredi 14 mai pour être transféré à la maison d’arrêt d’Agen.
Ce nom de Mano est dans toutes les bouches, accompagné de commentaires les plus variés ; le prévenu est arrivé à Agen précédé par la renommée terrible que lui a faite sa première condamnation, et son entrée à la maison de détention est, à elle seule, un événement assez considérable pour défrayer pendant plusieurs jours les conversations des habitants que compte le chef-lieu du département de Lot-et-Garonne.
Johannès Mano arrive dans un établissement pénitentiaire très perfectionné que la prison d’Agen, et fort remarquablement tenu. Nous devons à une obligeante permission d’avoir pu le visiter dans toutes ses parties, et nous avons d’abord éprouvé quelque surprise d’y voir Mano tout simplement mêlé aux autres détenus, alors que tout le monde le prétendait soumis au régime cellulaire et confiné (déjà !) dans le secret le plus absolu.
Le gardien chef, M. Delorme, est un fonctionnaire aussi tempéré dans l’exercice de ses pouvoirs qu’inexorable sur le chapitre de la discipline. La modération et la fermeté qu’il sait allier à un degré égal, produisent des résultats qui surprendraient peut-être des geôliers farouches, trop habitués à voir dans tout prisonnier un souffre-douleur. « Je garde les hommes que la justice me confie, dit-il, et la justice n’exige rien de plus. Aussi longtemps qu’ils sont sous ma surveillance, je réponds d’eux ».
Cette responsabilité exclut-elle l’humanité ? Non certes. Plus est terrible l’accusation qui pèse sur un individu, plus les ménagements doivent être complets, tant que n’est pas prononcée la sentence qui le déclare coupable. D’après ce principe, appliqué dans toute l’étendue compatible avec la sécurité intérieure, les prisonniers ont été divisés en deux sections principales : d’un côté les condamnés, de l’autre les prévenus.
Cette division est rendue facile par la structure même de la prison et les dispositions de son aménagement intérieur, qui pourraient servir de modèle à plus d’un établissement des centres importants.
L’édifice s’élève à l’une des extrémités de la ville, près d’une place plantée d’arbres, qu’on nomme la plate-forme.
Le Palais de justice & la prison
Sur cette place, on voit également la Préfecture et le Palais de justice. Ce dernier confine à la prison. C’est un monument de construction récente, d’un style un peu lourd, mais non dépourvu de distinction. Il est en pierre de taille, avec une façade sculptée, un escalier monumental surmonté d’un péristyle et deux ailes qui avancent sur une cour.
La prison est vaste, aérée, largement éclairée sur toutes ses faces elle enclave trois préaux spacieux, ou les détenus ont la latitude de passer plusieurs heures chaque jour, tout en restant strictement surveillés.
Au rez-de-chaussée sont les ateliers où travaillent les condamnés correctionnels, les uns à des ouvrages en corde, les autres au tissage de la toile, d’autres à la cordonnerie, etc. ; les réfectoires, sains, soigneusement appropriés, et meublés presque avec luxe, où ils prennent leurs repas en commun, puis le préau et la cellule commune des prévenus, qui ne sont astreints, eux, à aucun travail. Au-dessus se trouvent les dortoirs, les cellules isolées destinées aux condamnés criminels, la chapelle et les chambres des gardes. La cuisine et les services occupent une partie du sous-sol.
Le nombre des détenus en prévention est actuellement de six : Mano possède donc cinq compagnons de captivité avec lesquels il passe les journées en cellule, au réfectoire ou au préau, et la nuit dans un dortoir où six lits en fer, bas, à un matelas, garnis de draps que l’on change une fois par mois, et de couvertures de laine brune, sont rangés côte à côte.
Le Journal de Lot-et-Garonne rapporte que Mano n’est pas soumis à un régime sévère. « Il a, dit le journal d’Agen, quelque argent et peut se procurer quelques douceurs qu’on ne refuse jamais à un homme dans sa position. Il est doux et poli avec ses gardiens et l’on n’a pas jugé utile de lui mettre ni fers, ni camisole de force. »
Le facteur Johannès est vêtu du costume gris de la prison. Il n’a pas sensiblement changé depuis Bordeaux ; un peu maigri peut-être. Sa physionomie est restée la même. Ses yeux caves, son long nez, son front bas, n’ont rien perdu de l’énergique entêtement dont leur ensemble offre l’expression. Il porte toujours ses cheveux bruns coupés ras, et une moustache à l’état naissant, à peine perceptible.
Mano se montre peu expansif surtout pour ce qui a trait aux crimes de Tastous. En revanche, il cause assez volontiers de sujets étrangers à cette l’affaire.
Nous l’apercevons assis, après le repas, sur une table du réfectoire, les jambes pendantes, tenant à la main un large mouchoir à carreaux dont il se sert comme d’éventail, tout en répétant par instants : « Il fait chaud ! »
De son sort actuel, le condamné de Bordeaux ne se préoccupe guère, du moins en apparence de l’avenir, il semble ne point vouloir chercher à sonder les profondeurs. Il attend tout de l’imprévu. Il se félicite de l’admission de son pourvoi, et chante les louanges de la Cour de cassation. En somme, dit-il, on me devait cela ! Que signifient les travaux forcés dans mon cas ? Ou j’ai fait cinq cadavres, et c’est la peine de mort, ou je suis pur et intact et c’est l’acquittement En s’exprimant ainsi, il étaie sa démonstration de gestes très accentués, tels qu’il en a l’habitude, contorsionnant ses longs doigts noueux et les tordant vers le pouce de la main, pareil à un violoniste appuyant sur les cordes de son instrument. Cette habitude semble chez lui tout à fait invétérée.
Voici que depuis quelques jours, Mano est soumis au régime alimentaire strict de la prison, c’est-à-dire qu’il ne mange que la soupe et le pain réglementaires. Comme tous ses codétenus, il avait pu jusque-là se procurer, moyennant payement, les quelques douceurs que débite la cantine. Mais il n’a plus d’argent, pas même pour acheter du tabac.
Avant de quitter Bordeaux, il a écrit à l’administration des postes, réclamant un reliquat de 9 francs qui reste dû, prétend-il, sur son ancien compte. Sa demande étant demeurée infructueuse, il l’a renouvelle à son arrivée à Agen, mais sans plus de succès. Elle a amené un résultat, néanmoins : quelques employés s’étant cotisés, ont réuni 3 ou 4 francs, qu’ils lui ont fait parvenir. Sa situation pécuniaire parait affecter le prisonnier au-delà de toute mesure ; il retourne ses poches en murmurant : « Plus l’ sou ! »
Mais que feriez-vous de votre argent, si vous en possédiez encore ?
Tiens, pardine, j’achèterais du tabac et aussi du saucisson.
En parlant de saucisson, Mano s’anime, son regard s’allume de convoitise, ses lèvres s’entrouvrent avec sensualité. La charcuterie est, décidément, un de ses péchés mignons ; il a la nostalgie du saucisson.
Quant au tabac, il n’en manque jamais absolument. Il porte toujours sur lui une pipe en terre, qu’il fume chaque fois qu’il en trouve l’occasion. Hier, ses camarades lui avaient refusé de quoi bourrer sa pipe. Il s’est adressé à un gardien, se plaignant amèrement de leur égoïsme : le gardien lui a généreusement octroyé du tabac.
En résumé, cette existence de prévenu n’est que peu incidentée. Ni en prison, ni en face du jury dont le verdict va décider de sa destinée, le calme de Mano ne s’est jusqu’à présent démenti.
Parmi ses compagnons de détention figure un de ses collègues de la Poste. Ce dernier n’est accusé que de détournements. Par moments, lorsqu’ils sont ensemble dans la cellule, Mano le regarde avec envie : « Y a-t-il des facteurs qui ont de la chance » s’écrie-t-il. Nous apprendrons bientôt, sans doute, si l’homme de Tastous doit être rangé dans cette dernière catégorie.
Mano proteste énergiquement de son innocence et aurait dit à son avocat : « Ce que je vous répète depuis quinze mois, est la vérité. Je suis innocent. On a prétendu que j’avais tué ma pauvre femme, il me tarde d’aller la retrouver au ciel, parce qu’elle sait très bien que je ne l’ai pas assassinée. M. de Brezetz, vous êtes un honnête homme. Un jour nous nous rencontrerons devant Dieu et c’est là que je vous donne rendez-vous pour comprendre comment je suis innocent. »
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2254197/texteBrut
Audience du jeudi 12 juin
La cour suprême ayant cassé l’arrêt de la cour d’assises de Bordeaux pour défaut de forme, l’affaire est actuellement soumise au jugement de la cour d’assises de Lot-et-Garonne. Mano, l’auteur présumé des massacres du Tastous, comparaît de nouveau devant le jury.
Ce procès est de ceux pour lesquels un Chroniqueur judiciaire ne doit pas hésiter à se mettre en voyage. N’en eussions-nous pas été d’avance certain que l’émotion dont nous avons retrouvé ici le spectacle eut suffi à nous le faire comprendre.
Tel était Bordeaux, il y a trois mois, tel est Agen en ce moment agité, nerveux, inquiet, se passionnant pour ou contre un accusé, transformant la culpabilité ou 1’innocence de Mano en objet à peu près exclusif de ses préoccupations.
Le trajet de cent à cent-vingt paysans landais du canton de Belin à Agen, représente un déplacement fort important. C’est une bonne partie des bras du village du Barp, du hameau de Tastous et de quelques localités avoisinantes, qui va ainsi émigrer pour huit jours, laissant, pendant ce temps, chômer les travaux de la terre.
En vue d’obtenir un moyen de transport facile et peu coûteux, étant donné le chiffre des témoins, on avait eu l’idée, d’abord, de fréter un vapeur qui les aurait amenés directement de Bordeaux à Agen, par la Garonne.
Mais ce projet a été abandonné. L’administration des chemins de fer du Midi a consenti une réduction de cinquante pour cent sur le prix des places. Un convoi qui partira de Marcheprime le 12 juin, à midi, conduira les témoins à Bordeaux, qu’ils quitteront pour Agen par le train d’une heure trente.
Johannès Mano a été transféré déjà au siège de la juridiction de laquelle dépend désormais son sort. Le Président de la session est M. le conseiller Audidier, un magistrat de haut mérite. On assure que l’accusation sera soutenue par M. le procureur général lui-même, assisté de M. l’avocat général Frézouls.
L’accusé du quintuple crime de la métairie de Tastous, le condamné des assises de Bordeaux, paraît assez calme, malgré la terrible partie dont sa tête va être l’enjeu. Il assure qu’il a confiance dans le résultat final.
« Mais si vous échouez ? lui demandait-on.
Eh bien ! tant pis! Acquitté ou guillotiné je ne veux pas autre chose. »
Aussi Mano a-t-il énergiquement résisté à tous ceux qui, après l’acceptation de son pourvoi, l’ont engagé à se désister, et parmi ceux-là se trouvaient des magistrats éminents.
Me désister ! s’écriait-il, non ! Je ne me désisterai pas, je n’ai pas été jugé, jusqu’ici ; on n’appelle pas cela juger ! Eh ! bien, je veux l’être !
On se souvient, pourtant, de la conscience et de l’habileté que M. le Président Habasque apporta dans la direction des débats à Bordeaux, ils durèrent cinq jours ; six jours leur sont assignés à Agen et il ne serait pas surprenant, même, que ce laps de temps fût excédé.
Le prisonnier n’a pas un instant cessé d’accomplir ses devoirs religieux. Au fort du Hâ, l’aumônier était édifié de sa piété et répétait en toute occasion : « Cet homme est innocent ! »
« Monsieur l’abbé, disait souvent Mano, de son côté, rappelez-vous que je suis une victime des erreurs judiciaires. »
Et, cependant, l’un des principaux témoins nous écrit : « Ma conviction qu’il est coupable est plus inébranlable que jamais. »
Plusieurs fois, le détenu a demandé des nouvelles de ses fils. L’aîné, Bernardin, à la suite de ses émotions de comparutions devant la cour d’assises, a fait une courte maladie, dont son tempérament robuste s’est vite relevé, d’ailleurs. Il n’est point décidé qu’il doive se rendre à Agen ; on voudrait éviter le retour de cette scène cruelle d’un enfant se faisant l’accusateur de son père. Il se pourrait cependant que le Président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, jugeât utile de faire intervenir encore le jeune Bernardin Mano.
De toute façon, cette cause se présente avec des éléments d’intérêt inattendus. Pour tous ceux qui ont accordé quelque attention aux premiers débats, dont nous avons donné un compte rendu fidèle, il est évident qu’il faut s’attendre à de dramatiques péripéties.
Nous devons à nos lecteurs de suivre dans sa phase nouvelle cette affaire qui déjà les a intéressés si vivement, et d’en rendre compte de la façon la plus rapide et la plus complète.
Sur le siège du ministère public est assis M. Roë, procureur général, assisté de M. l’avocat général Frézouls. Un assesseur supplémentaire est adjoint au tribunal. MM. les jurés prêtent une oreille attentive à la lecture de l’acte d’accusation que nous connaissons…
À mesure que se déroule le récit des faits énumérés dans ce document et qu’apparaît le rôle que joueront aux débats les pièces à conviction, les regards de l’auditoire se portent avec avidité sur les objets nombreux, et pour la plupart encombrants, rangés au bas du prétoire. À Bordeaux, il n’avait pas été besoin de leur ménager la place ; ici, l’espace fait défaut. Il a fallu disposer face à face contre la barre du jury et contre la barre des avocats deux pièces capitales, un coffre à bois et un blutoir ; diverses caisses renfermant l’instrument du crime, des vêtements, des fragments de toutes sortes, des meubles, des objets ayant appartenu aux victimes, des débris retirés de l’habitation de Tastous, sont rangés çà et là au pied du tribunal.
Trois plans sont entre les mains de chacun des jurés. L’un représente la métairie de Tastous, l’autre une portion du village du Barp ; le dernier, la route du Barp à Tastous. Un interprète, après avoir prêté serment, s’est assis en face du tribunal, dans le prétoire. Il s’appelle Baillet, est instituteur primaire et passe pour un excellent traducteur du patois landais.
Derrière les fauteuils des conseillers, on remarque la présence de M. Pichard de Latour, le juge d’instruction de Bordeaux, qui a, pendant ses dix mois de prévention, interrogé le prévenu Johannès Mano.
Ce dernier, en se levant pour répondre à l’interrogatoire de M. le Président, aperçoit le magistrat instructeur. Cette vue lui cause une commotion assez vive.
Les premières questions posées à Mano portent sur son passé, les premières années de son mariage, les manifestations de son caractère, habituellement sournois et brutal. Mano est toujours le même homme froid, impassible, incapable de manifester la moindre sensibilité. Il persiste à nier, comme il l’a toujours fait. Au demeurant, les débats se poursuivent et reviennent à redonner à peu près le mot à mot du premier procès.
À l’époque où s’est commis le crime, il y avait neuf ans environ que l’accusé était marié, on sait que sa femme, bien que n’étant point de la même famille que lui, était une fille Mano ; ce nom est fort commun dans les Landes.
À diverses reprises, la mère Mano avait assisté à des scènes de violence entre Johannès et sa femme.
« Fais attention criait un jour le mari, je te réglerai ta marche. »
« Tu ne me tueras toujours pas ? » répliquait la malheureuse.
« Et qui sait ? si je ne craignais pas la justice. »
Il semblait que la belle-mère de Mano eût des pressentiments : « Voyez-vous, disait-elle parfois au voisin, il y aura un malheur, ici ; un jour ou l’autre on entendra parler de nous. »
Arrivé à Tastous au commencement de 1871, Johannès était nommé facteur au mois d’octobre. Ses appointements étaient de 45 fr par mois. Sur cette somme, il devait donner mensuellement 25 fr aux parents de sa femme pour part de loyer et nourriture. L’on n’était pas riche à la métairie ; ils étaient là huit, quatre grands et quatre petits, à vivre sur un maigre champ. C’était bien le moins que ceux qui travaillaient apportassent leur contingent à la caisse commune. Ce n’était point ainsi, paraît-il, que l’entendait Johannès Mano. Au lieu d’exécuter ses engagements, il conservait pour lui tout l’argent de sa paye, le dépensant dans les cabarets où il passait ses soirées à jouer et à boire. Durant les semaines qui précédèrent le crime, l’existence était devenue tout à fait intenable à la ferme. Ce n’était pas par des explosions de colère ou des récriminations violentes que procédait Mano, mais par de sourdes allusions et de sombres menaces. L’état des esprits, à Tastous, se ressentait d’une telle situation. Le vieux père, la vieille mère, la jeune femme vivaient dans des transes continuelles. Les quatre enfants menaient l’existence la plus triste. Jamais un sourire ni une caresse de leur père ne venait les égayer. Jamais le facteur ne rentrait chez lui sans proférer quelques paroles de haine et de vengeance.
Pourquoi ? À cause, sans doute, de cette maudite question d’argent qui faisait de Johannès un parasite dans l’enclos de Tastous, où peu à peu la misère élisait domicile.
Froidement, avec un calme imperturbable, sans une marque d’émotion, sans un tressaillement, l’accusé repousse ces imputations. À l’entendre, il était le meilleur des époux et le plus tendre des pères.
Le Président n’insiste pas ; ce ne sont là, après tout, que des préliminaires d’un ordre moral, considérables au point de vue des faits antérieurs, mais d’importance secondaire pris en eux-mêmes.
L’interrogatoire porte enfin sur les événements de la nuit du 9 et de la journée du 10 avril 1872.
M. le Président : Dans la soirée du 9, qu’avez-vous fait ?
Mano : De retour de ma tournée, je suis entré à l’auberge pour diner. Après diner, j’ai bu quelques verres de vin et fait quelques parties de cartes, entre autres avec le maire du Barp.
M. le Président : Et puis ?
Mano : Je suis allé me coucher.
M. le Président : À quelle heure ?
Mano : À dix heures et demie.
M. le Président : Où ?
Mano : Dans l’écurie de la Poste, chez M. Perrin.
M. le Président : Oui, vous couchiez quelquefois au Barp, dans l’écurie de M. Perrin, quand vous ne vouliez pas rentrer à Tastous, nous le savons. Mais, vous vous jetiez sur la paille dans la grande pièce de l’écurie, habituellement, tandis que, ce soir-là, vous vous êtes couché dans une pièce remplie d’ordures et de fumier, où un dormeur devait être fort mal, mais qui offrait pour vous un immense avantage, celui d’y être vu. Être vu, voilà ce qu’il vous fallait. Votre préoccupation, c’était d’établir un alibi.
Mano : Non, monsieur.
M. le Président : Comment étiez-vous habillé le 9 avril ?
Mano : J’avais une veste, un gilet et un pantalon noir.
M. le Président : Noir ? dites-vous.
Mano : Oui monsieur ; il y a une femme qui me l’a vu, la femme Rancinan.
(Jeanne Mano, épouse du résinier Jean Rancinan, décède au Barp le 29 avril 1872 lors de l’accouchement de son fils Jean Rancinan.)
M. le Président : Oh! je vois où vous voulez en venir ; la femme Rancinan est morte peu de temps après le drame de Tastous, vous invoquez son témoignage parce que vous savez qu’elle ne vous contredira pas! Eh bien! sachez-le cette femme, dont nous avons la déposition écrite, a déclaré que vous aviez un pantalon court et non un pantalon noir. Cette distinction est importante.
Mano : La pauvre malheureuse! Que n’est-elle encore, de ce monde ! Elle me sauverait!
M. le Président : Le 10, vous l’aviez ce pantalon noir ; le 9, c’est un pantalon bleu que vous portiez. Ne niez pas ! Dix témoins l’affirmeront. J’appelle sur ce point toute l’attention du jury. Un pantalon bleu, ensanglanté a été trouvé, le 10, dans la chambre des enfants Mano. C’était celui que Mano portait la veille. Quand il sera démontré que, le 9, il avait sur lui ce pantalon bleu, sa culpabilité se trouvera établie de la façon la plus irréfutable. C’est le point capital de la cause. N’est-ce pas, Mano ? Vous avez été à Tastous et substitué le pantalon noir au bleu, après le crime. Pourquoi nier ?
Mano : Je ne nie que la vérité (sic).
Me de Brezetz. J’entends l’auditoire rire de la réponse de mon client ; on comprendra, je pense, qu’il s’exprime incorrectement et qu’il a voulu dire qu’il nie ce qui est contraire à la vérité.
M. le Président : La cour a compris. Ce n’est pas sur des nuances de mots que MM. les jurés baseront des griefs. Mano, qui donc aurait commis le crime, si ce n’était vous ?
Mano : Des étrangers.
M. le Président : Votre famille avait-elle des ennemis ?
Mano : Pas que je sache,
M. le Président : Eh bien on tue par vengeance ou pour voler. Ils n’avaient pas d’ennemis donc on voulait les dépouiller. Et de quoi, bon Dieu, ils n’avaient rien ! Le peu, le très peu qu’ils possédaient, on l’avait retrouvé intact.
Mano : On n’a pas retrouvé d’argent et je sais qu’il y avait au moins 50 francs dans l’armoire.
M. le Président : Mais des voleurs auraient emporté du linge, ils n’auraient pas laissé une montre d’argent qui est restée suspendue à un clou. Or, on a bien vu du linge sorti de l’armoire, déposé en pile à terre mais ce n’était pas là le désordre réel qui résulte des recherches des voleurs, c’était un simulacre, c’était la comédie du désordre.
Mano : Moi, je crois toujours que les coupables sont des étrangers. Je le crois encore plus depuis des propos que j’ai entendus dans la prison.
M. le Président : Eh bien! nous croyons, nous, qu’il n’y a pas d’autre coupable que vous. Vous haïssiez votre femme, envers laquelle vous aviez de grands torts ; vous haïssiez vos filles. Des témoins vous ont entendu manifester le projet de garder avec vous vos garçons, et de laisser les autres enfants avec leur mère. C’était une intention arrêtée. Ah ! vous l’avez exécuté, ce projet, vous avez gardé les garçons. Ils dormaient, eux, ou faisaient semblant de dormir. Leur sommeil les a sauvés. Quant aux filles, les pauvres créatures, vous les avez laissées avec leur mère. Elles sont ensemble, là-bas, au fond du cimetière.
Une sensation de terreur, poignante, prolongée, court à travers l’auditoire. Sur les bancs du jury on s’agite un instant. Il se fait un silence, pendant lequel le public et la cour semblent attendre de l’accusé une réponse, un mot, un souffle, un geste. Rien ! Immobile et muet au milieu de l’émotion générale, Mano seul, paraît avoir conservé son sang-froid. Il est pâle, il tient la tête baissée, selon sa coutume, mais il regarde en face ses juges, et pas un muscle de son visage ne trahit le trouble ou la peur. Sa voix, pourtant, est moins ferme que nous ne l’avons entendue à Bordeaux. Il n’hésite point dans ses réponses, mais il répond sur un ton assez faible. On dirait, en vérité, qu’il veut ménager ses moyens.
L’interrogatoire continue
- le Président : Mano, vous êtes bien fort ; vous rêviez la célébrité ?
Mano : Moi, monsieur ? Jamais !
M. le Président : « On entendra parler de moi », avez-vous dit plus d’une fois ; on a entendu parler de vous, en effet, vous êtes un homme célèbre, votre nom a fait le tour de l’Europe. Vous prétendez que ce sont des étrangers qui ont tué ? Non ! C’est vous ! Qui aurait eu le courage de tuer des enfants, une fille de quatre ans, une autre fille de onze mois, pour quoi faire ? Le père seul l’a eu, ce courage. Et quand on a trouvé les tristes êtres avec leur couronne blanche sur la tête, la couronne qu’avait fait leur cervelle en jaillissant, vous, vous leur père, vous ne les avez pas même regardés.
Mano : On ne me l’avait pas commandé.
M. le Président : C’est horrible, ce que vous dites-là. On ne vous l’avait pas commandé ! De quel limon êtes-vous donc pétri ? Du reste, après le meurtre, vous n’avez montré ni émotion, ni sensibilité. Je me trompe…
Mano : Oh ! oui.
M. le Président : Je me trompe deux fois, on vous a vu terrifié la première, lorsque à côté des quatre autres victimes achevées, on a remarqué que le cinquième corps, celui de votre belle-mère, respirait encore. Alors, vous vous êtes évanoui, ou plutôt vous avez fait semblant de vous évanouir. La deuxième, c’est quand a été découvert le pic, souillé de sang et de cheveux Vous êtes devenu livide !
Mano : C’est mon teint ordinaire. Les gens qui disent tout ça, ce sont des témoins dont la plupart n’ont rien vu.
M. le Président : Ils n’ont rien vu, prétendez-vous ?
Mano : Laissez-moi finir. Je dis que les témoins racontent des choses qu’ils ont entendu dire et que je ne tremblerai pas pour cela. Je peux mourir d’une minute à l’autre, car j’ai la conscience tranquille.
M. le Président : Vous prétendez alors que tous les témoins mentent ; vous avez fait la même remarque à propos de M. le juge d’instruction.
Mano : Oh ! monsieur.
M. le Président : Eh ! oui. À vous entendre, c’est lui qui aurait inventé la plupart des dépositions, ou qui les aurait arrangées à sa guise.
Mano : Mon cher monsieur, je ne dis pas cela.
M. le Président : Et le sang qu’on a trouvé sur vos vêtements ? sont-ce vos ennemis qui l’y ont mis ?
Mano : C’est du sang de volaille.
M. le Président : Et puis ?
Mano : Du sang de veau. J’ai reçu le sang de la volaille en la plumant, le sang de veau en allant au Barp, chez le boucher, comme je le faisais souvent, voir souffler le bétail mort.
M. le Président : On entendra les médecins-experts. Ils diront que la pluie de sang reconnue sur vos vêtements ne saurait avoir une origine parallèle. C’est le sang de vos victimes que vous avez reçu, le sang que le pic avait fait jaillir.
Mano : Vous dites toujours que ce sont mes victimes. Et pourtant je suis innocent, monsieur le président.
M. le Président : Comment un étranger se serait-il procuré le pic qui était enfermé dans la grange ?
Mano : Quelquefois, des étrangers étaient venus demander l’hospitalité à la ferme ; on les avait fait coucher dans la grange ; c’est peut-être ainsi que cela s’est passé cette nuit-là.
M. le Président : Et le 12, deux jours après le crime, on trouva du sang sur vos poignets ! Et on trouva, en découvrant le pic, qu’il portait, auprès des taches de sang, une tache de suif ; or, il y avait aussi une tache de suif sur la pelle que portait votre beau-père, et qui a été retrouvée sur le cadavre. Donc, celui qui a retiré la pelle de la grange est aussi celui qui en a retiré le pic, la nuit, une chandelle à la main.
Mano : Ce n’est pas moi.
M. le Président : Il y avait un chien, à la ferme ; ce chien n’a pas aboyé ; admettez-vous qu’il n’aurait pas aboyé, si un étranger s’était approché ?
Mano : Ceci confirme ce que je disais : on aura fait coucher l’étranger dans la grange ; alors, pour le chien, il devenait un ami.
M. le Président : Et ce chien aurait assisté aux meurtres sans aboyer ?
Mano : Quant à ceci, monsieur le Président, je n’en puis rien savoir.
M. le Président : Ce chien vous a pris en horreur, par la suite ; il vous fuyait et à ce point que, ayant à choisir entre deux routes, dont l’une était suivie par vous, et l’autre par un sieur Larue, qu’il n’avait jamais pu souffrir jusqu’alors, il s’élança sur les traces du sieur Larue.
Mano : Ça peut être un caprice.
M. le procureur général. L’accusé prétend que le meurtrier aurait eu le vol pour mobile ; où le père Mano tenait-il son argent d’ordinaire ?
L’accusé : Dans le tiroir de l’armoire d’une chambre où je couchais.
M. le Président : Et où couchaient aussi les petites filles assassinées ?
Mano : Oui.
M. le Président : Bien. N’avez-vous pas saigné un porc ?
Mano : Oui monsieur.
M. le Président : Où ? Dans la maison ou dehors ?
Mano : Dehors.
M. le Président : Pas d’autres animaux ?
Mano : Si, des volailles, une dinde.
Me de Brezetz : Je prie M. le Président de faire bien apprécier l’endroit où était accrochée la montre.
Cette dernière question est l’objet d’une courte discussion, de laquelle il résulte que la montre était placée au pied d’un lit, dans un endroit peu apparent.
Mano se rassied. À deux ou trois reprises il passe la main sur son front. Il respire péniblement. Entre le col blanc de sa chemise et la partie du cou sur lequel il appuie, il passe son doigt, comme si cela le serrait, l’étouffait. La jaquette grise qu’il porte est boutonnée du haut en bas. La fraîcheur de la température extérieure justifie cette précaution.
Suspension d’audience.
Reprise par l’audition du premier témoin, M. Cazeaux, juge de paix à Belin. Dans la matinée du 10 avril 1872, M. Cazeaux fut le premier à porter ses investigations sur la scène du crime. Ses fonctions de juge de paix lui imposaient des devoirs dont l’exercice, en la circonstance, exigeait une grande délicatesse de tact et une parfaite sûreté de jugement. Il fit preuve d’une sagacité remarquable, et nous retrouvons la trace du talent déployé alors par M. Cazeaux dans la déposition très complète, très précise qu’il fait entendre.
Le 10 avril 1872, j’appris, par une dépêche télégraphique de M. le maire du Barp, qu’un horrible assassinat avait été commis dans sa commune, au lieu de Tastous, dans une petite métairie située à quatre kilomètres environ du village du Barp et qu’il y avait trois victimes. Il était huit heures du matin ; à neuf heures et demie, j’étais sur le lieu du crime et j’y trouvai monsieur le maire qui me dit qu’au lieu de trois victimes, il y en avait cinq. Je me rapprochai de la maison, et voilà le spectacle qui s’offrit à mes yeux : à quelques mètres de la maison, et près de la grange, deux personnes, dont l’une, la belle-mère de 1’accusé, vivait encore et recevait des soins assidus de quelques femmes, parmi lesquelles la supérieure des sœurs du Barp, et la femme Chaudon, et l’autre victime, la femme de l’accusé, complétement privée de vie et étendue sur le dos, les jambes et les bras écartés, et la tête près de la porte de la grange. La vieille Mano avait deux blessures qui montraient la cervelle à nu, l’une sur le frontal à gauche, et l’autre sur le pariétal gauche. Cette femme était complètement vêtue ; il lui manquait seulement son mouchoir de tête qui était à ses côtés ainsi qu’un de ses sabots qui était aussi près d’elle. La jeune femme avait à la face une horrible blessure qui lui avait enlevé l’œil gauche, le nez et une partie de la joue gauche. Elle avait dû être frappée d’une grande force pour être ainsi mutilée. Du côté opposé, à l’extrémité d’un sentier parallèle à la façade de la maison et se dirigeant vers la route agricole, se trouvait le père Mano, la face contre terre, complétement vêtu, même avec ses sabots, ayant sous le bras droit une pelle en fer et à côte de lui son chien.
En revenant de voir Mano, j’examinai la maison dont la porte et les contrevents étaient ouverts, et qui ne présentait aucune trace d’effraction. J’entrai dans la cuisine. Je remarquai le désordre du foyer ; sur la table, des pelotons de fil, tout près le dévidoir, et sur une chaise les bas de Manorine, femme de l’accusé. Je pénétrai dans la pièce à droite, chambre à coucher de l’accusé et de sa famille. Au fond, à droite et à gauche, deux lits, dans chaque lit une victime ; dans celui de droite, une fillette de quatre ans, dont la cervelle avait été jetée au vent, et par suite méconnaissable, et dans celui gauche, une petite enfant de onze mois, ayant une blessure faite avec un objet pointu et légèrement frappée à la tempe gauche d’un coup qui avait dû être mortel.
Dans l’appartement se trouvaient deux armoires à chaque côté de la porte. Ces armoires étaient ouvertes à deux battants, les tiroirs étaient grands ouverts et fouillés, et le premier rang de linge jeté.
Dans la chambre des vieux, à la suite de la cuisine, un seul lit servant aux époux Mano. Contre le chambranle de la porte, et à gauche, pendue à un clou, une montre en argent très apparente, une table et un coffre.
Enfin dans la chambre à droite, un lit, aussi à droite, le lit des deux enfants seuls survivants de cet affreux carnage. Le lit paraissant avoir été récemment occupé. À côté un coffre, puis un moulin.
En sortant de la maison, mon impression était donc celle-ci. Victimes complètement vêtues par conséquent non surprises par un étranger, puisqu’elles ne s’étaient pas couchées. Armoire peu fouillée, montre apparente non volée, pas de trace d’effraction, donc le vol n’a pas été le mobile des cinq assassinats.
Je procédai alors à une première enquête, j’entendis d’abord Chaudon et Goujon qui étaient les premiers arrivés sur les lieux, attirés par les enfants qu’on avait rencontrés s’en allant au Barp chercher leur père. J’entendis ensuite les personnes qui avaient été avertir Johannès Mano de la catastrophe arrivée chez lui ; j’appris qu’il n’avait rien dit, fait aucune question et pris aussi sans observation le chemin de Tastous.
J’entends M. Roumegoux qui me dit avoir veillé très tard par suite d’un dérangement de sa femme et n’avoir pas entendu aboyer le chien de Tastous ni même le soir, alors que ces deux chiens aboyaient très fréquemment lorsque quelqu’un passe non loin des habitations à leur maître.
Enfin j’interrogeai le petit Mano, qui me déclara n’avoir rien vu ni rien entendu la nuit, s’être couché la veille de bonne heure, comme à son ordinaire, et avait été très étonné, le matin, de n’avoir pas vu ses parents venir l’habiller comme d’habitude.
Par suite de quelques bruits qui couraient déjà que l’enfant aurait vu quelqu’un, la veille du crime, venir parler à sa grand-mère, je l’interrogeai à ce sujet, mais il nia tout.
Enfin, l’enfant me dit que, quand il avait rencontré son père près du Barp, il ne lui avait fait aucune question et ne l’avait pas même embrassé. Du reste, je remarquai l’air tout contraint et préoccupé de cet enfant.
Après cet interrogatoire, je pris, avec M. le maire, des renseignements sur la famille de Mano, et j’appris alors qu’il y avait un gendre qui avait dû coucher au Barp cette nuit. Mais M. le maire me fit part de ses habitudes de débauche, de la mésintelligence régnant entre lui et les siens ; enfin, que ce Mano s’était évanoui dans l’allée de Tastous, et avait dû être transporté dans une chambre d’une métairie de M. Roumégoux, où il se trouvait encore. J’allai immédiatement le voir.
Je le trouvai couché et paraissant exténué. Je l’interrogeai sur son état qui ne me paraissait pas assez grave pour le dispenser d’aller au moins voir sa famille assassinée, mais il me répondit qu’il ne le pouvait pas et qu’il se sentait très mal. Je le fis lever et alors l’état de sa chemise me frappa, tant elle était affreusement sale et imprégnée de sueur. Je lui demandai depuis quand il avait cette chemise.
Depuis dimanche, me dit-il.
Comment, lui dis-je, vous voulez me faire croire que vous avez mis cette chemise en pareil état, depuis dimanche, vous, facteur rural, habitué à la marche, ce n’est pas possible !
Mais, me dit-il, j’ai une incontinence d’urine.
C’est bien, lui dis-je, pour le bas de votre chemise, mais le haut ?
Il ne répondit rien, et alors j’eus un tel soupçon de sa culpabilité que je le fis immédiatement garder vue par un nomme Hazera, charpentier, muni de sa hache, et par un de ses ouvriers, n’ayant point assez de gendarmes à ma disposition.
Voilà, messieurs, ce que j’ai à vous dire, et ce que j’ai fait comme magistrat instructeur arrivé le premier sur les lieux. Si maintenant vous avez quelques questions à me faire sur les faits qui vous seront relatés par les nombreux témoins que, du reste, j’ai tous entendus, je me tiens à la disposition de la cour et de MM. les jurés.
Après, quelques questions de peu d’importance adressées au témoin, soit par l’accusation soit par la défense, Mano demande à M. le juge de paix s’il n’est pas vrai que d’abord il avait déclaré que sa belle-mère était venue se plaindre des menaces qu’il lui aurait faites, et que le témoin aurait ensuite déclaré s’être trompé.
M. Cazeaux. En effet, une femme s’était plainte à moi, l’hiver dernier, des menaces de son gendre ; cette femme était du Barp, et, renseignements pris, je crus en effet que c’était la femme Mano, belle-mère de l’accusé.
Mais depuis lors, j’ai acquis la certitude que je m’étais trompé et que ce n’était pas elle. Je suis heureux de le déclarer.
Ces déclarations si nettes, si claires, produisent un effet considérable. La loyauté du témoin qui n’a pas hésité à reconnaître une erreur dans laquelle il s’était laissé entraîner lors de l’instruction, ajoute à ses paroles un intérêt nouveau. Le caractère de M. Cazeaux leur donne, du reste, un poids tout particulier. Ce juge de paix est l’oracle de son canton, en même temps qu’il en est le bienfaiteur. M. Cazeaux est, en outre, un lettré ; il s’exprime avec élégance et correction et il faut bien avouer que, dans cette cause où la plupart des témoignages sont apportés par de simples et braves paysans, nous aurons rarement l’occasion d’entendre un aussi pur langage.
Une exception pourtant pour le maire du Barp : M. Jean Tastes, lui aussi, a rendu à la justice des services sérieux ; il a été intelligent et perspicace. Ce qu’il a vu, ce qu’il a fait, il se plaît à le redire. Nous avons consacré à sa déposition une part importante, lors des débats de Bordeaux. Les détails méticuleux, les descriptions pittoresques, les déductions pleines de logique de ce témoin sont encore suffisamment présents à la mémoire de nos lecteurs pour que nous nous dispensions de les relater ici autrement que pour mémoire. M. Tastes est l’auteur de la découverte du pic, trouvé ensanglanté, trois jours après le crime, parmi les outils de la grange. Il a, l’un des premiers, remarqué la position du cadavre du père Mano et la position de la pelle entre les bras de ce cadavre, comme au port d’armes, position qui indiquerait que l’outil a été placé là avec intention, pour faire croire que le vieillard allait à son travail lorsqu’il a été assailli. M. Tastes, enfin, a réuni avant même que le parquet se trouvât en possession des notions complètes de l’événement, le faisceau de preuves qui commençait à accabler Mano.
Au maire de Barp succède Guillaume Templier, qui a bu avec Mano à l’auberge Duprat, dans la soirée du 9 avril.
Guillaume Templier, au moment où il s’est séparé de Mano, vers dix heures et demie, a vu l’accusé se diriger vers la maison Duprat, pour se coucher dans l’écurie. Le lendemain matin, il apprit, avec une douloureuse surprise, le crime commis pendant la nuit. Lorsqu’il témoigna à Johannès Mano l’horreur que lui inspirait cet attentat effroyable, l’insensibilité du facteur le frappa. Mano ne témoigna ni désespoir ni rage. Il contemplait les cadavres d’un œil sec. « Malheureux, s’écria Guillaume Templier, scandalisé de cette sécheresse de cœur, comment ne t’es-tu pas précipité sur ton sang ? » Mano ne répondit rien et détourna la tête.
À l’issue de l’audience, le public s’entretient avec animation de toute cette première partie des débats. La rapidité, la précision, l’allure serrée de l’interrogatoire ont été particulièrement remarquées.
Un nombre considérable de curieux assiste au défilé des témoins regagnant leurs logis. On se montre le petit Bernardin Mano, que nous retrouvons un peu souffrant et maladif. Cet enfant a été cité pour comparaître au même titre qu’à Bordeaux. Il est probable qu’il sera entendu, bien qu’en droit strict, le défenseur du prévenu puisse, contester à la cour cette faculté de recueillir les accusations d’un jeune enfant contre son père.
On annonce l’arrivée de MM. Roussin, Lafargue et Robineau, expert.
Le savant docteur Roussin, on s’en souvient, a émis dans l’expertise un avis tout différent de l’opinion soutenue par l’une des sommités médicales de Bordeaux, le docteur Lafargue, assisté du pharmacien-chimiste Robineau.
L’état de santé de M. Roussin ne lui permit pas de se présenter aux premiers débats. Depuis, le docteur s’est rétabli, et l’on s’attend dès lors à une discussion des plus vives entre les experts.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k591861c/f4.item.r=le%20barp.zoom
Audience du vendredi 13 juin
Agen, 13 juin 1873, 4 h. du soir.
Un 13 et un vendredi ! Quel pronostic, si l’accusé était superstitieux. Mais la superstition n’est point le faible de Mano. Mano est un sceptique. C’est assez de le voir pour en être convaincu.
Dix heures sonnaient au moment où les gendarmes l’ont introduit dans la salle, où l’on étouffe et l’on s’écrase pour le voir. Impassible, il a pris place au banc des prévenus, a prononcé quelques mots à l’oreille de son avocat, Me Brezetz, assis au-dessous de lui, à la barre ; puis, lentement, il promène ses regards sur la foule.
Singulière nature ! Étrange caractère ! Cet homme, pour qui s’apprêtent les angoisses de six longues audiences ; ce condamné, qui vient recommencer à Agen les terribles étapes du procès de Bordeaux ; ce réprouvé, sur qui pèsent les charges les plus sanglantes, garde le même sang-froid, la même sérénité que pourrait conserver en face de ses juges, un innocent certain du triomphe de sa cause. Le condamné de mars serait-il donc en possession de quelque argument décisif, découvert après coup ? Aurait-il entre les mains un moyen de salut encore ignoré de nous tous ? Garderait-il, pour s’en servir au moment opportun, une de ces vérités tellement éclatantes que les présomptions en apparence les mieux fondées doivent se dissiper tout à coup devant elle ? L’avenir seul, un avenir prochain, pourra répondre à ces questions.
Jusque-là, selon toute apparence, plus d’un fait curieux se produira à l’audience, plus d’un incident imprévu traversera les débats. Le public est houleux, les témoins paraissent être sous l’influence d’une agitation mal contenue.
C’est hier au soir qu’un train a amené de Bordeaux les nombreux habitants de Belin, du Barp et de Tastous, appelés à déposer dans la cause. Ils étaient cent cinq à l’origine de l’affaire ; ils sont cent seize maintenant.
Ces naïfs campagnards semblent fort étonnés du va-et-vient auquel la justice les force à se livrer. Après avoir envahi la gare, leur cohue s’est répandue par la ville, cherchant à se caser et y parvenant tant bien que mal.
Ce débordement de la Gironde sur le Lot-et-Garonne n’a pas été sans apporter quelques perturbations dans la calme cité d’Agen. La fièvre – qui n’a rien de commun avec la Covid 19 – que ces gens ont apportée avec eux a gagné aussitôt la population locale, déjà surexcitée par les récits dont Mano était le héros.
La presse est là, heureusement, pour donner satisfaction aux curiosités ; elle se doit à l’utile mission de faire ressortir la moralité de cette cause. Le nombre des personnes admises dans l’enceinte de la cour ne pouvait qu’être extrêmement restreint, l’exiguïté de la salle n’a jamais été plus déplorée.
Le style de cette salle n’est sévère qu’à demi. Le prétoire, avec ses lambris boisés et son ameublement de chêne ne manque pas d’une certaine grandeur. Mais le prolongement des murailles et le plafond, décorés dans le goût pompeïen, contrastent quelque peu avec la majesté du lieu. Le coloris violent et bariolé de ces fresques étrusques rappelle, de loin, l’ornementation de la salle de Théâtre du Conservatoire de musique à Paris. Irréfutable démonstration du proverbe : Les extrêmes se touchent.
Mais nous aurons tout le temps de revenir sur ces détails. Écoutons la lecture à laquelle procède M. le greffier Favéreau, au milieu du silence obtenu à grand peine.
Agen, 13 juin, 6 h soir : l’interrogatoire de l’accusé a été, comme à Bordeaux, très rigoureux, très serré. Mano est toujours aussi flegmatique ; sa voix est pourtant plus faible.
Plusieurs dépositions ont été entendues. La première a été celle du juge de paix du canton de Belin.
Cette déposition est extrêmement pathétique !
À demain les détails.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5918592/f3.image.r=%22Robert%20de%20Ch%C3%A8nevi%C3%A8re%22mano?rk=42918;4#
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5918592/f3.image.r=barp%20pichard?rk=85837;2
Audience du 14 juin
(Correspondance particulière du Petit Journal)
Cette cause, on le sait, est remplie de mystères ; à chaque pas, l’on s’y heurte contre un obstacle. Personne n’a vu commette le crime. Il est donc impossible de procéder, à l’égard de l’accusé, à une de ces attaques foudroyantes qui, soit qu’elles viennent du président, soit qu’elles émanent du ministère public, soit enfin qu’elles résultent de questions précises, directes, posées par quelques membres du jury, terrassent un prévenu et l’écrasent sous le poids de l’évidence. Force est de recourir à des coups détournés au lieu d’un assaut rapide, impétueux ; c’est le siège en règle de Mano qu’il a fallu entreprendre.
C’est en l’enlaçant dans un réseau de dépositions dont chacune apporte son contingent de probabilités, que l’on peut espérer parvenir à forcer la vérité dans les retranchements derrière lesquels elle s’abrite. De là résultent nécessairement des redites inévitables étant donné le nombre considérable des témoins.
Il semblerait que, dans la phase nouvelle où est entrée l’affaire, l’œuvre de la justice dut être simplifiée, et que la cour d’Agen put bénéficier des faits acquis déjà devant la cour de Bordeaux.
Mais d’abord, l’arrêt de la cour de cassation, en annulant les débats de Bordeaux, interdit aux juges actuels de se reporter à ces débats ; c’est dans l’instruction seulement qu’ils ont le droit de puiser les notions de la procédure. En outre, la mémoire des témoins se trouve assez fréquemment en défaut : les événements ont aujourd’hui quatorze mois de date, et il n’est pas surprenant que quelques particularités, même parmi les plus importantes, se soient effacées de l’esprit.
Nous nous trouvons donc plutôt en présence d’un redoublement de difficultés, avec la nécessité sans cesse renaissante, pour l’habile président, de remettre, sous les yeux de la plupart de ceux qui déposent, leurs déclarations de l’instruction.
Voici, par exemple, Hazera, un brave cultivateur du Barp qui, le 10 avril au matin, a rencontré sur la route les fils de Johannès. Le récit du quintuple meurtre commençait à se répandre.
M. le Président : Vous avez adressé une question à l’ainé des enfants Mano ?
Hazera : Oui, monsieur le président, je lui ai demandé s’il n’avait rien entendu. Il m’a répondu non.
M. le Président : Mais vous avez dit dans l’instruction qu’il ne vous avait rien répondu.
Hazera : Peut-être bien.
M. le Président : Dans l’instruction également, vous avez déposé avoir ouï dire que la famille Mano avait eu à se plaindre du facteur.
Hazera : C’est vrai des personnes disaient que Mano voulait se débarrasser de sa famille. Je l’avais oublié.
Deux enfants sont entendus à la suite d’Hazera. L’un dépose des faits à peu près insignifiants. Le second est le fils de l’aubergiste Martin, chez qui Mano se trouvait le 10 au matin ; c’est un petit garçon de dix ans à la mine éveillée et à l’œil intelligent.
M. le Président : Racontez ce que vous savez ?
Martin fils : Mano était chez mon père au moment où, dans le village, on s’entretenait des assassinats de Tastous. Il était de bonne heure. Je courus chez nous, j’ouvris la porte, et apercevait Johannès, je lui criai « Tout le monde chez vous a été tué ». Il se leva, en mettant un mouchoir sur ses yeux, mais sans dire un mot.
M. le Président : Pleurait-il ?
Martin fils : Je ne sais s’il pleurait ou faisait semblant de pleurer.
M.le Président : Mano, je respecte les secrets d’une âme, même celle d’un accusé dites-nous seulement si vous pleuriez.
Mano : Oui, monsieur le président.
M. le Président : Vous répondez oui. Eh bien Jusqu’à présent, vous avez toujours affirmé le contraire. Vous ajoutiez même « Est-ce que c’est ma faute, si je ne peux pas pleurer ? » Témoin vous êtes certain que Mano n’a pas parlé ?
L’accusé : je n’ai pu lui parler parce qu’il n’est pas resté, il n’est pas même entré dans la salle à peine m’avait-il annoncé la nouvelle qu’il est parti à toutes jambes. Quand je suis sorti de la salle, il était à cinquante pas.
Le fils Martin : Nous sommes sortis en même temps, que l’accusé.
L’accusé : Oh ! peut-on dire des choses comme ça !
L’aubergiste Martin, père du précédent, dépose dans un sens analogue à celui du témoignage de son fils. Un détail diffère, néanmoins :
M. le Président : Mano n’a rien dit, en se levant pour sortir ?
Martin : Faites excuse, il a dit Ah ! et puis encore Ah !
M. le Président : Voilà tout ?
Martin : Voilà tout.
Sensation dans l’auditoire.
Rablade, berger : Quand il été arrivé sur le théâtre du crime et quand il a vu que sa belle-mère grouillait encore, il s’est trouvé mal et on l’a mis sur une charrette pour le transporter dans une chambre, chez Maurice Mano, au Tastous. Alors, mon maître m’a envoyé chercher une bouteille d’eau-de-vie. On en a mis sur le coin d’un mouchoir pour lui en frotter les tempes, et on lui a passé le mouchoir sur les lèvres, et il a tiré la langue et agité les lèvres pour sucer le mouchoir.
M. le Président : Il n’était donc pas évanoui ?
Rablade : Dame ! Faut croire qu’il n’était plus esbahi dans ce moment-là.
M. le Président : Ainsi, il simulait l’évanouissement. N’étiez-vous pas un ennemi de la famille Mano ?
Rablade : Jamais, monsieur.
M. le Président : Vous aviez eu quelques discussions, cependant ?
Rablade : C’est vrai.
M. le Président : Mais vous ne les auriez pas tués pour cela ?
Rablade : Moi! monsieur le président, vous pouvez demander dans tout le pays.
Anne Rambeau : le matin du crime je passais sur la route en même temps que les enfants allaient à l’école. Parmi eux étaient les petits Mano. L’aîné courut à moi et me dit : « Vous ne savez pas ? Mama, pépé, mémé, sont morts là-bas, chez nous.» Je ne voulais pas croire à cela. Je me mis à rire. Alors le petit reprit « Si vous ne voulez pas me croire, allez-y ». J’y allai et vis l’affreux spectacle.
M. le Président : N’avez-vous pas assisté ensuite à l’évanouissement de Mano ?
Anne Rambeau : Oui, on lui a apporté de l’eau-de-vie et il s’est dévanoui pour boire et puis il s’est révanoui après. Il n’était pas pâle, il était rouge.
M. le Président : Vous connaissiez la famille, vous saviez les discussions ?
Anne Rambeau : Oui, Mano rendait les femmes bien malheureuses. Toutes deux s’en plaignaient ; la vieille Mano le redoutait, Manorine tremblait devant lui. Un jour qu’elle avait pris un petit morceau de confit d’oie qu’il voulait garder pour lui, il se mit à la brutaliser.
M. le Président : Et ses deux petites filles ? Il disait qu’elles n’étaient pas de lui, qu’il ne les garderait pas. Manorine avait-elle manqué à ses devoirs ?
Anne Rambeau : Jamais, la pauvre femme
Jean Pauquet, métayer : Moi, je suis pour la dinde, c’est sur la dinde que je peux donner des renseignements, parce que je sais le jour où elle a été tuée. C’était la samedi. Le dimanche, Manorine me fit part que la veille on avait tué cette dinde.
M. le Président. Cette déposition a une portée que je dois expliquer à MM. les jurés. Mano prétend que le sang trouvé sur son pantalon est le sang de cette dinde qu’il aurait lui-même tuée et plumée le jeudi. Si la dinde a été tuée le samedi, comme tout ce jour-là Mano a été absent de chez lui, son allégation se trouve détruite.
Mano : C’est cependant bien le jeudi que je l’ai fait.
Jean Pauquet : je maintiens samedi. Le 9 avril au matin, j’ai rencontré Manorine elle était courroucée contre son mari à cause de sa conduite.
Mano : Ma pauvre femme ! elle n’avait aucun motif pour ça.
Guillaume Roumégoux, propriétaire : de Tastous, où j’habite, j’ai entendu, dans la nuit du 9 au 10 avril, ou plutôt le 10 avril au matin, un cri épouvantable.
M. le Président : Quelle heure était-il ?
Roumégoux : Entre quatre et cinq heures. Ce cri me fit dresser les cheveux sur la tête, tout grand et fort que je suis. Maintenant, je dois dire que, dans mon esprit, personne que Johannès n’a pu commettre le crime. Johannès était joueur et débauché, et si c’était un autre, on aurait volé dans la maison. Et puis, j’ai vu le facteur quand il faisait le malade, il n’était pas plus malade que vous et moi !
De Brezetz : Le témoin n’a-t-il pas un chien ?
Guillaume Roumégoux : Oui. Ce chien est méchant.
M. le Président : Avez-vous entendu votre chien aboyer dans la nuit du 9 au 10 ?
Roumégoux : Parfaitement.
Le défenseur : Ah Permettez ! je vous prends en flagrant délit d’inexactitude. Voilà votre déposition écrite : « Ma femme était malade elle ne dormait pas ; elle me dit que notre chien avait aboyé, mais moi je ne l’ai pas entendu. »
Guillaume Roumégoux : Ça doit être ça.
Me de Brezetz : Je tiens à faire constater ces contradictions, parce que le système de l’accusation…
- Le Procureur Général : M. le défenseur, je vous prie de ne vous point préoccuper du système de l’accusation. Le ministère public a un devoir à remplir. Nous sommes ici complétement étrangers à ce qui s’est passé à Bordeaux, et je ne permets à personne de pressentir et d’expliquer quel sera mon système.
On introduit un témoin, la fille Goujon, accueilli avec d’autant plus de curiosité que, assigné à la suite de l’instruction complémentaire, ce témoin n’a pas été entendu dans le premier procès. C’est une fille vulgaire de tournure et de visage, à cheveux blond filasse, coiffée d’un mouchoir bleu. Âge 25 à 30 ans. Elle est dans un état de grossesse avancé.
M. le Président : Que savez-vous ?
Fille Goujon : Rien.
M. Le Procureur Général : elle a eu des relations avec l’accusé.
M. le Président : Vous avez eu des relations avec l’accusé ?
Fille Goujon : Oh ma foi, je ne sais ; en tout cas, pas plus qu’avec d’autres.
M. le Président : Vous aviez plaisir à le voir.
Mano. Je serais curieux de savoir qui a fait assigner ce témoin ; celui qui a fait cela est plus coupable que moi ! Je comprends l’intention !
Me de Brezetz : Allons, Mano, pas de vivacité, asseyez-vous.
M. Le Président : Un témoin, que nous entendrons, M. Perrin, le seul témoin qui ait défendu Mano, a rapporté que la fille Goujon avait dit qu’elle irait moissonner chez lui si Mano y allait. Une autre fois, c’est Mano qui a demandé à coucher à l’auberge, dans une chambre voisine de celle où couchait cette fille. La justice pensait pouvoir tirer du témoin quelques renseignements utiles.
Fille Goujon : Je ne sais rien de ce qui a rapport aux crimes.
Arnaud Brun, forgeron, raconte un incident qui ne se rattache qu’indirectement au procès, et que nous avons, il y a trois mois reproduit déjà en détail. Il s’agit d’un M. Marthiens, décédé, qui avait été un bienfaiteur pour Mano. Quand il mourut, Johannès le mit en cercueil, en l’y poussant du genou et proférant ce propos « Je te tiens donc, gredin à présent, tu ne feras plus rien à personne. Je voudrais tenir tous les richards comme ça ! »
Mano nie ce fait, ou du moins le sens qu’y attache l’accusation, comme il l’a nié naguère. Nous remarquons, toutefois, que ses paroles et ses gestes ont perdu beaucoup de la violence qu’ils affectaient à Bordeaux.
Quelques témoignages suivent, relatifs aux rapports qu’entretenait l’inculpé avec sa famille. Il exécrait son beau-père. Un jour que celui-ci sciait du bois, le pied appuyé sur une corde tendue en travers d’un chevalet, il s’approcha traîtreusement et coupa la corde pour le faire tomber. Le vieillard était vif, emporté, mais point méchant.
Pierre Paris, cultivateur : J’étais présent quand fut trouvé le pic.
M. le Président : Prenez-le.
Pierre Paris : C’est bien celui-ci, lourd, gros manche, forte lame. Tenez, je vois encore le sang. Je ne vois plus les cheveux, mais il y en avait ici, là et là. Des blancs, ceux des vieux ; un brun, de Manorine, et de tous petits, blonds, frisés, qu’on reconnaissait pour ceux des pauvres anges. Tenez, cela me fait mal de revoir tout ça. On est tout de même un homme, n’est-ce pas ? Je pris l’outil et le montrai à Johannès. En ce moment-là, il était libre. Il le regarda « Oui, fit-il, c’est avec ceci qu’on a fait le coup ! » Il est devenu très blanc, et puis il est devenu très rouge, Alors, je me suis dit « Toi, tu en sais plus que tu ne veux paraître. » J’avais raison.
Nous omettons intentionnellement quelques témoignages secondaires. Par exemple, celui de M. Jehan Marthiens, à qui Mano devait quelque argent. Pour l’en rembourser, il lui avait proposé d’aller travailler dans sa propriété. Mais M. Marthiens apprit que le facteur, à qui il réclamait payement, avait dit « Celui-là aussi me demande de l’argent ; en voilà encore un que je régalerai. »
Que signifient ces mots ? En français, ils prêtent à un double sens ; mais les linguistes de la région landaise prétendent que leur sens patois ne saurait donner lieu à un doute « Un couère üng que reuglerey » signfie clairement : « Encore un qui aura affaire moi ». M. Marthiens est un frère du défunt ; sa fortune est l’une des plus considérables du département.
Vers la fin de l’audience, le bruit se répand que le jeune Bernardin Mano est malade. Nous l’avions approché en effet, à son débarquement du chemin de fer et il souffrait un peu de la fièvre. Une dame de la ville prend soin de lui, et l’on espère qu’il sera rétabli assez promptement pour jouer dans ces débats le rôle important auquel, assure-t-on d’autre part, le défenseur de Mano s’efforcera de tout son pouvoir de le soustraire. Il semble, en effet, qu’une question juridique des plus délicates doive être soulevée lors de la comparution du fils accusateur. Me de Brezetz est d’avis même que, dans le cas où, en vertu du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, M. le Président persisterait à passer outre, la défense se créerait ainsi, pour l’avenir, un cas de cassation complètement inédit.
Il reste à entendre soixante-dix témoins environ, dont certains sont attendus avec une véritable impatience.
Agen, 6 h. soir : plus de quarante témoins ont été entendus à l’audience d’aujourd’hui. La lumière ne se fait pas encore. L’indécision persiste, toujours aussi grande, aussi poignante.
Demain, dimanche, audience pour la suite des dépositions.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k591862r/f2.item.r=mano.zoom
Audience du 15 juin 1873
(Correspondance particulière du Petit Journal)
À mesure que le débat s’élargit, l’intérêt devient plus vif, l’émotion plus grande. Chaque fois que Mano est extrait de sa prison, chaque fois qu’il y rentre, comme il lui faut traverser la route, il se trouve exposé aux regards d’une foule curieuse.
Mano est décidément entré dans la célébrité parmi ces calmes Agenais, qui n’avaient pas cru tout d’abord à tant d’atrocité dans le massacre de Tastous, à tant de force morale chez l’homme sur qui pèse la responsabilité de l’effroyable tuerie.
Malgré le dimanche, malgré la Fête-Dieu, la Cour d’assises tient séance. Ainsi le veut la loi. Aux termes de ses exigences, toute cause criminelle doit être jugée sans désemparer. Le public, un certain public tout au moins, avide d’émotions, mais habituellement retenu par ses occupations de la semaine, trouve dans cette continuation des débats l’occasion de donner pâture à sa curiosité.
Ce n’est pas que les journées de chômage fassent défaut à la population des travailleurs. On dit à Paris « Quand le bâtiment va, tout va ». À Agen, tout va quand la prune va. Or, cette année la prune ne va pas !
Le 27 avril 1873, il fait -2.7°C à Paris, et le 28, il y a de la grêle sur le Médoc.
La récolte sera nulle ; c’est une perte de plusieurs millions pour le département. Le Lot-et-Garonne a donc des loisirs ; il est probable que bien des gens seraient accourus des environs d’Agen, s’ils ne savaient que l’exiguïté de la salle d’assises rendrait inutile leur empressement.
Après avoir fendu à grand-peine le flot des curieux évincés qui obstruent les issues extérieures, il faut, pour se pouvoir placer, enjamber les assistants que la salle d’audience a engouffrés. Mais ce n’est plus déjà une salle d’audience ; c’est une vaste étuve où chacun s’évente, ruisselle et s’éponge désespérément. Aucune place ne reste libre, la porte extérieure du Palais, tenue fermée par précaution, s’ébranle à tout instant sous le choc de la foule que quelques factionnaires ne contiennent qu’à grand-peine.
Dans le prétoire, les autorités départementales sont réunies : le préfet, le maire, des membres de la magistrature, du Conseil général. L’aristocratie féminine d’Agen est représentée par quelques jolies personnes dont les fraîches toilettes attirent les regards. La presse locale et la presse de Bordeaux sont à leurs bancs, au grand complet. Parmi cet auditoire où toutes les « couches sociales » se coudoient, les conversations les plus diverses, les commentaires les plus variés se heurtent et s’entrecroisent. On s’attend à des débats extrêmement mouvementés. Le début de l’audience tient largement cette promesse.
Tout d’abord une discussion prend naissance au sujet du cri entendu par Templon, le meunier, durant la nuit tragique du 9 avril. Ce cri, d’une expression indéfinissable, accusait les terribles angoisses de la personne qui l’avait poussé. La défense l’ayant voulu rapporter aux cris de rassemblement jetés dans l’air par les bergers des landais, il a été nécessaire d’en préciser pour ainsi dire la qualité. À peine la cour a-t-elle pris place, que M. le Président donne ordre aux huissiers de rappeler M. Tastes, maire du Barp.
M. le Président : Connaissez-vous les cris des bergers du Barp ?
M. Tastes : Il y a ici un berger. Il peut vous indiquer cela exactement.
M. le Président : Qu’il s’approche.
Le berger Rablade : Me voici.
M. le Président : Imitez le cri des bergers appelant leurs moutons.
Rablade : Aahoou! Aahoou!
M.le Président : Maintenant, faites avancer le témoin Templon.
Templon : Je suis là.
Le témoin Templon n’a pas reconnu là le gémissement qui était venu frapper ses oreilles et retentir jusqu’à son cœur, et, appuyant son récit d’une démonstration, il exhale à son tour une plainte qui résonne dans le silence de la salle comme le râle d’une poitrine vigoureuse.
M. le Président : Faites le cri que vous avez déposé hier avoir entendu dans la nuit du 9 au 10 avril sur la route de Tastous.
Templon : Ahahahahï !
M. le Président : Il n’y a aucun rapport entre ces cris. Le premier est en voix de tête, lugubre, mais aiguë ; l’autre est un cri de désespoir, voix de poitrine, triste et déchirante, un vrai cri de victime en danger de mort.
Ce premier incident est extrêmement pathétique, et plus d’un assistant en a ressenti la secousse. L’écho répercute longuement les cris entendus.
On reprend l’audition des témoins.
Étienne Templier : Un jour, en me cachant derrière une haie, j’ai entendu une dispute entre Mano, sa femme, son beau-père et sa belle-mère ; Manorine lui reprochait de tout dépenser et rôdait autour de lui, cherchant à lui donner des coups. L’accusé menaçait sa femme d’une pelle. Quand il fut seul, il dit: « Allez ! allez ! un de ces matins je vous réglerai tous » Depuis, en me rappelant ces menaces, j’ai pensé que Mano était l’auteur, du crime.
M. le Président : Les deux femmes, en s’en allant, ont-elles entendu ce propos ?
Templier : Elles ont dû l’entendre.
Me Brezetz : J’ai à poser au témoin une question grave. Le lendemain de l’arrêt rendu par la Cour d’assises de la Gironde, Templier n’a-t-il pas eu un entretien avec M. Alexandre Dutauzin, à qui il raconta avoir entendu l’enfant Mano dire « Je n’ai rien vu, rien entendu. » Templier ajoutait : Bernardin Mano a dit aussi que le soir du crime, au moment où sa grand-mère le déshabillait pour le mettre au lit, un homme entra, parla avec sa grand’mère, et sortit ? Mais vous n’avez rien dit de cela, devant la Cour d’assises fit remarquer M. Dutauzin avec étonnement. « Oh ! répliqua Templier, je ne risquais pas, Messieurs, ceci est fort caractéristique il en résulte la preuve que certains témoins ont apporté dans leurs dépositions une déplorable partialité. » Je ne risquais pas, cela veut dire, dans la bouche de Templier « Pas de danger que j’aille révéler une particularité qui pourrait être favorable à Mano ».
M. le Président : Templier, est-ce que vous auriez quelque malveillance pour l’accusé ?
Templier : Non, monsieur le Président.
M. le Président : Je prie M. le maire du Barp de s’avancer et de nous donner des renseignements sur ce témoin.
M. Tastes : c’est un parfait Honnête homme.
Ce curieux incident est suivi de rumeurs qui indiquent à quel point il préoccupe l’auditoire.
On accueille avec curiosité l’entrée de M. Alexandre Dutauzin, Propriétaire à Bordeaux et négociant*.
- Statistique générale topographique, scientifique, administrative, industrielle, commerciale, agricole, historique, archéologique et biographique, Féret, 1874.
https://archive.org/stream/statistiquegnra01frgoog/statistiquegnra01frgoog_djvu.txt
Dutauzin : le lendemain de l’arrêt de la cour d’assises à Bordeaux, je me trouvai avec Templier, par hasard. Nous avions à faire l’un et l’autre au greffe. En faisant route ensemble, il me raconta que le fils aîné de Johannès Mano avait déclaré avoir vu un homme entrer à la métairie pendant qu’il était déshabillé par sa grand-mère. Je remarquai qu’il eût dû ce détail à la Justice. Oh ! fit-il, je ne risquerais pas.
M. le Président : Comment traduisez-vous ces mots?
Dutauzin : Cela peut vouloir dire « je ne voulais pas, » ou bien, « cela n’eût servi à rien. »
Me de Brezetz : Quelle est l’opinion personnelle du témoin à cet égard ?
M. le Président : Le témoin n’a pas à émettre ici son opinion personnelle. Cette question ne mérite aucune réponse.
Le défenseur : Permettez ! La même question a été adressée à des témoins par l’accusation. M. le Président a plusieurs fois consulté les personnes qui déposent sur leur avis particulier à propos de tel ou tel détail. Je ne me suis opposé à aucune de ces questions. Mais je m’étonne qu’on ne m’accorde pas la réciprocité.
Le Président : le jury appréciera.
Jean Favereau : Quand j’ai vu le cadavre du vieux Mano portant une pelle, j’ai cherché à quoi cette pelle aurait pu lui servir. Je n’ai vu aucune trace d’un travail qui nécessitât une pelle.
M. le Président : Et vous en avez conclu que la pelle a été ajoutée au cadavre avec intention ?
Favereau : Oui.
M. le Président : N’avez-vous pas été victime d’un vol, quelque temps avant les meurtres de Tastous ?
Favereau : Oui ; j’étais dehors, ma femme était seule à la maison, un homme entra, la tint en respect par des menaces, mais sans la frapper, s’empara de 300 fr dans une armoire et s’enfuit.
Me de Brezetz : Ceci prouve qu’il y a dans le pays des voleurs étrangers ; les uns tuent et les autres ne tuent pas, voilà tout.
Goury, cultivateur : J’étais présent quand Mano a été confronté avec les cadavres. Il gémissait « Quel malheur d’être accusé ». Quand on eut enseveli sa belle-mère il s’écria: « Maintenant je peux me défendre ! » J’ai entendu, plus tard, Bernardin Mano accuser son père d’être l’auteur des assassinats.
Me de Brezetz : Je prie M. le Président de demander au témoin si, dans l’instruction, il n’a pas déclaré que le petit Bernardin mentait fréquemment ?
Goury : Je ne m’en souviens pas.
Me de Brezetz : Il faut vous souvenir ; c’est sérieux. Il y va de la tête d’un homme
Goury : Je ne me rappelle rien de semblable.
M. le Président. Je vous adjure de dire la vérité. Vous vous taisez?
M. le Procureur général : Le temps écoulé lui a permis d’oublier.
Me de Brezetz : Oh! mais la question est trop grave pour que nous la laissions éluder. M. le juge d’instruction, ici présent, se souvient peut-être, lui. Je fais appel à sa loyauté.
M. Pichard de la Tour : En effet, le témoin Goury a semblé dire, dans les dépositions recueillies de sa bouche par l’instruction, qu’il arrivait au petit Mano de mentir.
Mouvement sur les bancs du jury. Sensation prolongée dans l’auditoire.
Il est extrêmement probable que l’audition du fils de l’accusé entraînera des incidents graves. Bernardin Mano sera entendu demain. L’enfant est en voie de rétablissement, et on l’a, tout à l’heure, aperçu un instant dans la salle des témoins.
Les dépositions qui se succèdent à la barre à la suite des précédentes, roulent sur un autre ordre de faits. C’est le séjour de Mano dans l’écurie de la Poste, au Barp, qui est en, cause. La femme du propriétaire de l’hôtel de la Poste, Mme Perrin, apporte aux débats de minutieux détails.
On n’a pas oublié que, dans la partie de l’écurie où coucha Mano, fut trouvée, sous une cuve, une paire de chaussettes souillée de terre et tachée de sang.
Pourquoi ce sang et cette terre ? demande l’accusation. Et elle explique la terre par cette circonstance que Mano, afin de marcher sans bruit, aurait quitté ses sabots pour courir, la nuit, du Barp à Tastous. En effet, cette terre n’appartient pas au sol noir et gras de l’écurie, mais au terrain gris et friable de la route. Elle explique le sang par un jaillissement provenant des victimes.
M. le Président : Les chaussettes retrouvées dans l’écurie avaient été cachées à dessein ou étaient-elles tombées sous la paille ?
Mme Perrin : Je n’en sais rien.
M. le Président : Mano a prétendu que le sang découvert sur ces chaussettes provenait des poulets qu’il aurait tués ou plumés chez vous.
Mme Perrin : Il n’a jamais tué ou plumé de volailles chez moi.
Deux autres témoins attestent les mêmes faits. Ils décrivent le costume exact que portait Johannès Mano le 9 avril sabots, chaussettes de laine « couleur de la bête », veste d’alpaga recouverte d’une blouse de facteur à collet rouge et or, enfin pantalon bleu.
M. le Président : Êtes-vous sûr que ce pantalon était bleu ?
Pierre Taris : Parfaitement sûr.
M. le Président : Voici ce pantalon. Huissier, présentez-le. Témoin, le reconnaissez-vous ?
Pierre Taris : Oui monsieur.
M. le Président : Gendarmes, emmenez l’accusé, faites-le se vêtir de ce pantalon bleu et ramenez-le à l’audience.
Mano se lève, blême, chancelant ; les gendarmes l’emmènent. Pendant les trois ou quatre minutes que dure son absence, l’émotion du public est à son comble. Quand s’ouvre la petite porte placée derrière le banc des prévenus, un frémissement parcourt la salle.
À mesure que se développent les témoignages qui vont suivre, les sentiments qui agitent l’auditoire semblent s’accroître encore en intensité.
Sur un geste du Président, l’un des gendarmes amène l’accusé jusqu’au milieu du prétoire. Le pantalon qu’il a été revêtir est en toile, fond bleu, entièrement bleu, même si on le regarde à quelques pas de distance en s’approchant, on distingue de minces raies d’un blanc gris qui traversent l’étoffe bleue dans le sens de la largeur ; en s’avançant plus près encore, on s’aperçoit que ces rayures sont formées de petits points très rapprochés ainsi : ces particularités expliquent certaines divergences qui se sont produites à Bordeaux où les témoins étaient bien d’accord quant au fond bleu du pantalon, mais différaient sur le détail des portions blanches que les uns dépeignaient comme des carreaux, d’autres comme des points, d’autres comme des raies.
M. le Président : Témoin, reconnaissez-vous positivement ce pantalon ?
Pierre Taris : Positivement, monsieur.
M. le Président : Messieurs les jurés, l’affirmation de Pierre Taris est absolue.
Femme Auger : J’ai vu l’accusé le 9 avril ; il portait son béret, des sabots, des chaussettes grises, une blouse bleue par-dessus une veste et un pantalon pointillé.
M. le Président : Tournez-vous du côté de Mano.
Femme Auger : C’est bien ce pantalon.
Armand Salbert, cultivateur : Le 9, veille du crime, Mano avait un pantalon bleu.
M. le Président : Regardez celui que porte l’accusé.
Salbert : Je le reconnais.
M. le Président : Sans aucun doute ?
Salbert : Oh sans aucun doute.
Jeanne Téchouère, sage-femme : le 9 avril, j’étais à l’auberge Duprat, dans l’après-midi. J’ai vu entrer Mano, il avait un pantalon bleu.
Me de Brezetz : Était-il debout ou assis ?
Jeanne Téchouère : Puisque je vous dis qu’il entrait !
M. le Président : Où ?
Jeanne Téchouère : Dans la cuisine.
Me de Brezetz : On comprend 1’importance de ma question ; si Mano avait été assis, les jambes sous une table, il eût été difficile de distinguer la nuance de son pantalon.
Femme Duprat, aubergiste : Mano est entré le 9 avril chez moi en pantalon bleu.
Jeanne Lacrampe : J’ai vu Mano la veille des assassinats et je reconnais sur lui le pantalon qu’il avait ce jour-là.
Jean Courlier : Johannès portait, le 9 avril, le même pantalon qu’à présent.
Julie Rostaing : J’ai vu Mano le 9, je le revois maintenant. Le pantalon qu’il avait alors au Barp, il l’a aujourd’hui ici.
Le Président : Gendarmes faites marcher l’accusé
Mano, marchant : Voilà, monsieur le Président.
M. le Président : Témoin, vous avez la certitude de ne pas vous tromper.
Julie Rostaing : Oh ! oui ; le pantalon était bien comme celui-ci, bleu, à raies, ni trop long ni trop court.
Il est très curieux de suivre, pendant cette scène, les jeux de physionomie de 1’inculpé. À Bordeaux, l’on s’en souvient, Mano opposait à chaque témoignage des dénégations forcenées : « Menteur! Faux témoin ! imposteur éhonté », s’écriait-il après chaque déposition. À Agen, le facteur baisse la tête et reste silencieux, et de pâles qu’elles étaient, ses joues deviennent livides.
Mais poursuivons :
Courbin, sacristain : Nous étions au Barp le 9 avec Mano, attablés côte à côte. Nos pantalons se touchaient presque. Je remarquai qu’ils étaient de la même couleur, bleus tous deux, je le fis, en riant, observer à Johannès.
Voilà, assurément, une circonstance bizarre et un curieux souvenir.
Écoutons une dernière déposition plus concluante encore et plus singulière par les détails :
Jeanne Baillou (ou Baillon, ou Balliou), quinze ans : Le 9 avril, je revenais du catéchisme. Je me croisais sur la route avec Mano. Il était vêtu de son costume ordinaire de facteur, y compris le pantalon, bleu. J’allais, passer, lorsqu’il me fit signe de m’arrêter et cherchant dans sa boîte : « J’ai une lettre pour ton père », me dit-il. Je l’examinais tandis qu’il poursuivit ses recherches et je remarquai que son pantalon bleu avait une pièce au genou droit.
M. le Président : Mano, avancez le genou droit.
Jeanne Baillou : C’est cela ! La pièce y est toujours !
M. le Président : Ainsi, pas d’hésitation ? Certitude absolue ?
Jeanne Baillou : Certainement, monsieur.
M. le Président : Je ferai remarquer que l’on pourrait croire que la rencontre de cette enfant avec l’accusé a eu lieu une autre date que le 9. Si la lettre remise par Mano à Jeanne Baillou n’avait été retrouvée.
M. le Procureur général : J’ai cette lettre ; elle n’est pas sous enveloppe : l’adresse a été écrite au verso même du papier, et l’on y lit distinctement le cachet de la poste portant la date 9 avril 1872.
Il semble, à ce moment que le doigt de Dieu s’appesantisse sur Mano. Tremblant, éperdu, il tord ses doigts une contraction convulsive et courbe la tête comme par une indiscutable évidence.
Mano avait passé son pantalon bleu, et ces expériences se faisaient sur sa propre personne. Et quand tous eurent accablé le malheureux, une contre-épreuve a lieu sur le pantalon noir, qui sera tout aussi fatalement concluante. Les gendarmes emmènent Mano, le temps de passer le pantalon noir qu’il prétend, lui, avoir porté le 9 avril, au lieu du pantalon bleu retrouvé ensanglanté sur le coffre à bois de la chambre de la métairie de Tastous. Dès sa rentrée dans la salle, on remarque que ce pantalon noir, en velours de coton, est beaucoup plus court que le bleu. Entre son extrémité inférieure et le soulier découvert dont est chaussé l’accusé, il reste un large vide.
M. le Président : Ceci est une contre épreuve. Je vais rappeler chacun des témoins qui ont reconnu le pantalon bleu. Jeanne Baillou, reconnaissez-vous ce pantalon noir que Mano portait le 9 avril ?
Jeanne Baillou : Non, monsieur.
M. le Président : Courbin, regardez l’accusé et le pantalon qu’il porte.
Courbin : Ce n’est pas celui dont il était vêtu la veille du crime
M. le Président : Et vous, Julie Rostaing ? Mano avait-il ce pantalon noir
Julie Rostaing ; Non.
[…]
Personne n’a reconnu ce pantalon noir.
En même temps que l’accusation se matérialise, la physionomie de l’audience prend une teinte plus sombre ; une vive agitation court dans l’auditoire ; les exclamations s’élèvent d’instinct ; on sent que l’opinion se modifie profondément. Dès lors, la physionomie de l’audience change entièrement ; de vague qu’elle semblait vouloir rester, l’accusation devient plus serrée, plus pressante, plus positive. Les témoins, qui doivent fixer la couleur du pantalon dont Mano était revêtu la veille du crime, défilent durant plus d’une heure, déposant en termes rapides, confirmant leurs déclarations de Bordeaux, protestant de la sincérité de leurs paroles, soutenant, sans se déconcerter, la discussion avec l’accusé, inexorables du premier au dernier.
Terrible séance pour l’accusé, que celle qui se termine ! Et redoutable séance que celle qui se prépare ! car demain il faudra qu’il subisse les dénonciations, inconscientes peut-être, de son propre enfant ! À tort ou à raison, on prête au défenseur de Mano la résolution de soulever une question grave : l’incapacité de l’enfant à déposer contre son père. En outre, le jeune Bernardin est malade ; les fièvres intermittentes consument sa frêle constitution.
Un autre témoin éprouve également, depuis peu de jours, une assez grave altération de santé : c’est Deycart, bientôt septuagénaire, le même qui, en 1814, échappa, tout enfant, au massacre de toute sa famille, massacre accompli mystérieusement une nuit, dans les landes du Barp, à quelques centaines de mètres de Tastous. On a beaucoup remarqué cette bizarre coïncidence, qui absorbe ici les esprits impressionnables.
Quant à Mano, il se renferme dans une sorte de résignation à laquelle il nous avait peu habitués. Il nie bien ; parfois même il le fait avec énergie ; mais ces manifestations durent peu ; il lance un démenti à brûle-pourpoint à presque tous les témoins, puis il hausse légèrement les épaules, entrelace ses doigts, qui sont d’une longueur démesurée, se rassied et redevient apathique.
Cinq gendarmes sont là pour le garder ; mais l’attitude de Johannès rend inutile, ce nous semble, une telle profusion de baudriers.
Ils emmènent Mano. L’audience est renvoyée à demain. De nouvelles émotions, plus violentes peut-être que celles d’aujourd’hui, nous attendent encore.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k591862r/f1.image.r=mano
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5918634/f4.item.r=mano
Audience du 16 juin
(Correspondance particulière du Petit Journal)
Après l’audience d’hier, il semble que la coupe des émotions est pleine ; il n’en est rien ! La foule, de plus en plus compacte, qui, de bonne heure, envahit la salle d’audience, s’est dirigée vers le Palais en traversant des rues toutes remplies encore des souvenirs des processions de la Fête-Dieu : charpentes d’autels, vases de fleurs, tapis de feuillage, lambeaux d’étoffe, ne sont regardés que d’un coup d’œil distrait. Seul le procès préoccupe la masse ; on ne s’entretient que du procès, et longtemps avant l’heure où la Cour entre en séance, on aperçoit dans toutes les mains une brochure publiée à Bordeaux à la suite des premiers débats : « Affaire Mano, historique et dépositions », par le chroniqueur Y. Y.
Suivre à Agen même les péripéties de la cause, ce n’est pas assez ; on veut encore savoir comment elle s’est déroulée devant la cour d’assises de la Gironde. Là-bas l’accusation hésitait, tâtonnait, cherchait sa voie. Ici, elle frappe fort et juste et ne s’aventure qu’à coup sûr. De son côté, la défense dispute le terrain pied à pied. M. le Procureur général Roë et Maître de Brezetz sont deux adversaires dignes l’un de l’autre et qui ne se cèdent en rien en acharnement et en habiletés oratoires.
L’affluence est de plus en plus grande. Dans l’enceinte réservée se pressent des dames, des avocats, des officiers, mêlés aux témoins déjà entendus ; quelques jurés, non désignés pour l’affaire, suivent le débat avec un intérêt qui augmente à mesure que le dénouement approche.
La Cour entre en séance à dix heures vingt minutes, et l’audition des témoins reprend.
Nous n’appuierons pas sur les détails déjà très familiers à ceux qui ont suivi l’affaire depuis son origine. L’achat de volailles auquel s’est livré Mano, en présence des cadavres à peine refroidis, les parties de cartes qu’il a jouées le soir même du jour où avait eu lieu l’enterrement des victimes sont suffisamment connus. Parlons plutôt d’un fait nouveau qui s’est dégagé d’une courte discussion relative à la lanterne qui, on s’en souvient, était placée devant la porte de la grange de Tastous, sur une pierre, entre les corps des deux femmes, le pic instrument du crime, la pelle trouvée sur le vieux Mano, portant des taches de suif de chandelle. Or, dans cette lanterne, il y avait une bougie. Ce n’est donc pas muni de cette lanterne que le meurtrier a dû chercher les outils. D’ailleurs, une lanterne n’aurait pas laissé échapper de traces du passage de celui qui la portait. Il y avait là un petit mystère qui est éclairci aujourd’hui. Dans une chambre de la métairie, on a trouvé sous un lit un couteau portant des traces de chandelle coupée ; ce couteau était celui du vieux Mano. On a trouvé également deux petits morceaux de chandelle.
La femme Catherine Beyris, la servante des Marthiens, est accueillie avec une certaine curiosité. Le lecteur n’a pas oublié que Mano, pour mieux se défendre contre les révélations accablantes de son enfant, avait lancé une accusation de faux témoignage dont il attribuait la cause à l’influence de Catherine Beyris sur le faible esprit du jeune Bernardin. Catherine Beyris, une brave jeune femme, estimée de tous au Barp, avait protesté — elle proteste encore — avec une énergie pleine de vivacité, et, sa bonne renommée aidant, l’opinion avait fait prompte justice du moyen de défense invoqué par Mano.
Elle dépose : quelque temps avant le crime, je me trouvai un dimanche avec la vieille Mano. Elle me raconta que souvent son gendre ne rentrait qu’au matin, après avoir passé la nuit au jeu.
« – Alors, lui dis-je, il faut que vous vous leviez pour lui ouvrir ?
– Non, reprit-elle, il nous force à laisser la porte ouverte, sans quoi il nous fait de mauvaises menaces.
– Mais, oserait-il vous battre ?
– Oh! Oui, et peut-être pis que cela. »
Après le crime, je vis Johannès quand on lui présenta le pic. Il pâlit affreusement.
À quelques temps de là, j’étais aux champs ; le petit Bernardin vint à moi et je lui parlai.
« – Tu n’as rien vu, rien entendu ? lui demandai-je.
– Non, me répondit-il d’abord.
Je le fis causer encore, et, un moment après, il me dit :
– C’est papa qui a tué maman, mémé et pépé.
– Tu en es sûr?
– Oui, et je veux aller avec un bâton Bordeaux pour le battre.
– Et s’il revient au Barp ?
– Je le tuerai. »
Nous retrouvons dans cette déposition ces variations de l’enfant de Mano dont les récits incohérents et les versions parfois fort divergentes n’ont pas peu contribué à entretenir, autour de cette cause, l’obscurité qui l’enveloppe.
Un incident, issu du conflit entre le témoin et l’accusé, avait marqué à Bordeaux l’audience du 12 mars. M. de Pichard, juge d’instruction, dans le cabinet de qui la scène primitive s’était déroulée, avait été entendu par le jury de la Gironde. Or, le cas se représente à la cour d’assises d’Agen : Mano réédite l’histoire du geste fait par Catherine à Bernardin pour le pousser à charger son père, déjà si compromis. Catherine a bien reconnu avoir fait signe à Bernardin, mais elle ne lui a fait qu’un signe d’encouragement, afin de l’arracher, dit-elle, aux terreurs qu’inspirait à son jeune fils la présence de Johannès.
Le juge d’instruction Pichard de la Tour est appelé à la barre, en vertu des pouvoirs discrétionnaires du Président. Il confirme tout ce que nous savons déjà. M. Fontayrol, greffier du juge d’instruction, et témoin naturel de la scène est également entendu. Un ou deux témoins, peu importants, sont entendus encore ; l’audience a repris un instant le caractère de longueur que lui imprime, depuis deux jours, la monotonie des dépositions que l’on sait et que la production de quelques témoins nouveaux n’a pu rompre. Mais tout à coup, après une courte suspension, le débat se ranime : un témoin vient raconter que Mano lui a tenu ce propos très gravement significatif, en réponse à des exhortations bienveillantes, quelques heures après la mort de la vieille : « À présent, je me défendrai ! »
Le nom qui suit le leur sur la liste des témoins est celui de l’enfant Bernardin Mano.
Long mouvement sur tous les bancs.
Au moment où l’huissier va appeler le petit Bernardin Mano, M. le Procureur général se lève, et, au milieu du plus profond silence, il prononce, d’une voix émue, quelques paroles sur l’inutilité qu’il y a désormais à entendre Bernardin Mano : « Cet enfant est là, dit-il ; il était de notre devoir de le faire venir jusqu’à vous. Nous estimons cependant que ses déclarations, dont on vous lira la reproduction très fidèle, ne viendraient plus rien ajouter à la clarté de ce débat ! Pour notre part, nous renonçons à l’entendre ; car nous sommes soucieux de lui épargner le renouvellement de la douloureuse épreuve de si affreux souvenirs. Cependant, nous restons aux ordres de la cour, nous inclinant d’avance, quelque décision qu’elle doive rapporter de la salle du conseil ; et son désir, ainsi que celui de MM. les jurés et du défenseur, restera pour nous une loi suprême. »
À cette allocution, Me de Brezetz répond : « La cour fera ce qu’elle jugera à propos de faire ; quant à moi, je n’ai rien à dire encore. »
Or, la cour repousse les conclusions du ministère public, et, considérant que l’audition de Bernardin peut avoir son utilité, ordonne l’introduction de l’enfant.
L’assemblée entière est profondément agitée.
Un huissier va chercher le petit garçon et l’amène par la main jusqu’à la table du tribunal. Tous les regards sont braqués sur cet enfant pendant que le Président, lui faisant avancer une chaise, l’invite à s’asseoir tout, en face de lui. La maladie l’a miné ; il est pâle et amaigri.
Sa déposition s’est trouvée retardée de quelques minutes, à cause du mouvement qui s’est produit à son entrée le calme s’est rétabli peu à peu, et l’orphelin doit répondre aux questions du président.
Silence religieux.
M. le Président : Tu connais cet homme, là-bas ?
Bernardin : Oui, c’est mon père.
M. le Président : Qui a tué ta mère ?
Bernardin : C’est lui.
M. le Président : Tu l’as vu ?
Bernardin : Oui, la nuit.
M. le Président : Que faisait-il ?
Bernardin : Il posait une paire de culottes sur le coffre et sur le moulin.
M. le Président : Il faisait donc jour ?
Bernardin : Non. Mais il y avait une chandelle sur le coffre dans la chambre de ma grand-mère et notre porte était ouverte.
M. le Président fait remarquer que la chambre des vieux Mano et des petits garçons n’était séparée que par une porte, qui, naturellement, a été ouverte par l’assassin au moment où il a pénétré dans la dernière chambre.
M.le Président : Es-tu bien sûr d’avoir reconnu l’homme ?
Bernardin : Oh oui.
M. le Président : Il s’est approché de toi ?
Bernardin : Oui, et j’ai fait semblant de dormir.
M. le Président : Qu’as-tu fait le matin, en te levant ?
Bernardin : Je me suis habillé et j’ai habillé mon petit frère
M. le Président : Mais tu as fait autre chose, tu as pris des livres pour lire ?
Bernardin : Oui, en attendant l’heure d’aller à l’école.
M. le Président : Et qu’as-tu vu en prenant ces livres ?
Bernardin : Du sang.
Bernardin a vu du sang à la muraille (les mêmes taches que plus tard il a si bien indiquées sans les avoir jamais plus revues), et qu’il est allé au Barp chercher, non son père, mais les premières personnes venues, afin de leur raconter ce qu’il avait vu et pour les engager à se rendre à Tastous.
À ce moment, une scène que nous allons décrire vient de nouveau remuer l’auditoire. Le Président se lève de son siège et va se placer avec le jeune témoin tout près du premier juré, afin que les membres du jury ne perdent pas un seul mot de ces lamentables confidences. Le moment est grave ; tout le monde s’est levé dans la salle.
M. le Président : Quand tu es sorti de la maison, où allais-tu ?
Bernardin : Au Barp.
M. le Président : Pour quoi faire ?
Bernardin : Pour dire que ma mère, mémé, pépé et mes petites sœurs étaient tués.
M. le Président : Et la nuit, as-tu entendu quelque chose ?
Bernardin : J’ai entendu crier.
M. le Président : Dis-moi pourquoi la première fois qu’on t’a interrogé tu n’as pas dit cela ? Tu as assuré que tu n’avais rien entendu ? Quelle raison avais-tu pour te taire ?
Bernardin : Je n’osais pas parler.
M. le Président : Pourquoi ?̃
Bernardin : J’avais peur.
M. le Président : De qui ?
Bernardin : De mon père.
M. le Président : Que craignais-tu ?
Bernardin : Qu’il me tuait.
M. le Président : Et maintenant, tu n’as plus peur ?
Bernardin : Non, il y a des gendarmes.
M. le Président : Et tu vois qu’il ne peut plus rien te faire ?
Bernardin : Oui.
M. le Président : Vous entendez, Mano !
Johannès Mano très rouge et d’une voix faible : Tout ça, monsieur le Président, on le lui a fait dire.
M. le Président : Qui ?
Johannès Mano : Catherine Beyris.
M. le Président : Réponds-moi, mon enfant, est-ce vrai qu’on ta dit de dire que ton père est un assassin ?
Bernardin : Oui.
M. le Président : Et c’est seulement pour cela que tu l’as dit ?
Bernardin : Je ne sais pas.
M. le Président : C’est Catherine Beyris qui te l’a dit ?
Bernardin : Non. C’est le petit Henri Martin, à l’école,
Cette réponse, à laquelle peu de gens s’attendaient, produit un incident nouveau.
La Cour, le Jury, le ministère public, la défense, le public tout entier, sont suspendus aux lèvres de l’enfant. Le jeune Bernardin s’exprime d’une voix très faible. On le conduit devant la tribune des jurés pour lui faire renouveler ses déclarations. Après les dernières réponses qu’il a prononcées, M. le Président juge utile d’éclaircir l’influence qu’aurait pu avoir l’élève Henri Martin sur Bernardin Mano.
C’est une grande et sévère figure que celle du Président. L’expression de sa physionomie, habituellement triste, porte en ce moment l’empreinte de la douleur. C’est d’une voix tremblante et les yeux voilés de larmes que M. Audidier a achevé l’interrogatoire du petit témoin.
Le petit Mano est mis en réserve, dans un coin, pour être confronté, plus tard, avec le jeune Henri Martin, son camarade. Et le cours des dépositions ordinaires est repris.
Le Maître d’école du Barp : Dès que les premières rumeurs de la culpabilité de Mano ont commencé à circuler, je me suis fait un cas de conscience de recommander à mes élèves d’éviter à l’égard de l’enfant toute allusion au crime. Un jour, plusieurs d’entre eux vinrent me dire que, prenant les devants, Bernardin avait fait des confidences.
M. le Président : Ainsi, c’est lui qui le premier a dit avoir vu son père ?
M. le Curé du Barp : J’ai été des premiers à savoir les aveux recueillis de la bouche du fils aîné de Mano. Ayant ouï dire que cet enfant accusait son père, je l’interrogeai. Il me répéta ses allégations. C’est grave, remarquai-je, ce que tu dis là ! Es-tu certain de dire la vérité ? Oui, je dis la vérité, accentua-t-il avec une certaine énergie.
Henri Martin, enfant, élève à l’école du Barp : Un jour, Bernardin Mano m’a parlé de 1’assassinat de ses parents. Il m’a dit que ça s’était fait dans la nuit et qu’il avait vu un homme. Je lui demandai quel homme, et il me répondit: « mon père. » C’est de lui-même qu’il m’a dit tout cela.
Un autre élève : Notre camarade Bernardin a raconté à Henri Martin les choses qu’il avait vues, sans qu’Henri l’interrogeât.
Un autre élève : Je ne crois pas que ce soit Martin qui ait questionné Mano.
Un autre élève : Nous avons causé avec Bernardin après qu’il a eu raconté à Henri Martin ce qu’il avait vu, il nous a confirmé que son père était l’assassin.
Autres élèves : Même déposition.
On devait confronter avec ses condisciples le fils de l’accusé, emmené hors de l’audience aussitôt après sa déposition ; Bernardin Mano, miné par la fièvre, ne peut subir l’interrogatoire auquel il est soumis. Un médecin vient d’examiner le petit Bernardin, que la fièvre, une fièvre violente a repris tout d’un coup. M. le Président déclare qu’il est tout à fait hors d’état de subir aujourd’hui la confrontation. Demain, ajouta-t-il, si on le peut sans danger pour la santé et la vie de 1’enfant, il sera de nouveau conduit devant la Cour.
Mano est atterré.
C’est principalement à cette audience qu’ont été produits les nouveaux témoins auxquels on prêtait de si importantes révélations. Quelques-uns, parmi eux, se sont fait l’écho de propos plus ou moins vrais, plus ou moins sages, mais nullement intéressants pour la cause, propos recueillis n’importe où et qui n’ont eu pour résultat que de retarder les dépositions des experts.
Trois de ces témoins ont cependant rapporté une phrase de Mano, prononcée dans un moment assez solennel, devant de nombreuses personnes. C’était le soir du 13 avril 1872 ; on attendait à la station de Marcheprime, le train d’Arcachon à Bordeaux que Mano devait prendre en compagnie de gendarmes (on se rappelle qu’il avait été arrêté le matin même). Quelqu’un qui causait avec le prisonnier, lui dit ; « Savez-vous, Mano, que si vous êtes le coupable, vous méritez de mourir sur l’échafaud ? » et Mano répondit : « Je suis innocent ; et quand même on me trainerait sur l’échafaud, je protesterais encore de mon innocence ; on n’a pas vu, donc on ne peut pas condamner. »
Il ne reste plus à entendre qu’un nombre restreint de témoins. Il est impossible de considérer Mano sans rester frappé du changement de plus en plus marqué que reflètent ses traits. Hier, ils exprimaient la lassitude ; aujourd’hui, ils indiquent l’abattement le plus complet.
Un prêtre qui se trouvait à la gare de Marcheprime le jour où l’assassin présumé fut emmené prisonnier, a été entendu dans l’instruction complémentaire. Il vient déclarer que Mano, en montant en wagon, s’est écrié : « J’aurais le cou sur la guillotine que je n’avouerais pas, parce que ce n’est pas moi. On n’a pas vu, les hommes ne peuvent pas condamner. »
Le chef de gare et un homme d’équipe confirment ce propos.
On s’attend, maintenant, à une discussion assez vive entre les deux experts MM. les docteurs Roussin et Lafargue dont les avis sont, sur plusieurs points, en opposition. L’expérimentation, par les moyens chimiques, des taches constatées sur les vêtements de Mano et sur son poignet gauche, a révélé l’existence du sang. Certains de ces vêtements étaient souillés d’un sang dont on n’a pu exactement expliquer la provenance, à cause du lavage tout récent auquel ces objets avaient été soumis ; sur d’autres, on a constaté la présence de taches de sang humain, ainsi que sur le poignet de l’accusé, ainsi que sur le pic, instrument reconnu du crime.
Cependant, ainsi que nous l’explique pendant une suspension d’audience le savant docteur Lafargue, ces divergences sont beaucoup plus apparentes que réelles. Les experts, en effet, avaient à déterminer la nature des taches de sang découvertes sur les vêtements de Mano. Ceux de Bordeaux ont analysé les taches peu de jours après le crime, presque fraiches encore, conséquemment ils ont constaté la présence de sang humain. Le célèbre chimiste de Paris, au contraire, n’a vu les vêtements, que six ou huit mois après l’événement ; les taches étaient desséchées. M. Roussin a conclu à du sang de mammifère sans se prononcer pour du sang humain.
La parole est aux experts, MM. Lafargue et Robineau. Leur rapport n’a pas varié ; il est le même qu’à Bordeaux.
La parole est au premier des experts, M. Lafargue. Le médecin délégué par la justice fait frémir l’auditoire par la description qu’il présente, de l’état de chacun des cadavres : crânes brisés, membres fracturés, cervelles jaillissantes, yeux déjetés hors des orbites, poitrines transpercées, mares de sang, tel est le long tableau, dont nous épargnerons à nos lecteurs les hideux détails. Il semble qu’on assiste à une autopsie et la salle du palais de justice se transforme pour une heure en amphithéâtre de la Morgue.
La déposition du docteur Lafargue soulève un mouvement d’horreur, dans l’auditoire.
Le docteur Lafargue maintient les affirmations qu’il a soutenues à Bordeaux quant à la nature des taches de sang.
La cour et le jury examinent longuement les traces de sang que portent le coffre à bois, le blutoir, les vêtements de l’accusé.
M. Robineau, chimiste expert, professe les mêmes doctrines que le docteur Lafargue. Il s’explique longuement dans un sens identique.
Robineau, déclare que le sang trouvé sur le pic est du sang humain, ainsi que quinze taches qui se trouvaient sur la blouse ; le pantalon bleu avait de nombreuses taches qui avaient dû être lavées avec une éponge. Il a reconnu des taches semblables sur la cravate de Mano, ainsi que sur son mouchoir, et sur le mur de la chambre des petits garçons.
On attendait M. Roussin, le chimiste expert de Paris, qui a été chargé de faire la contre épreuve de l’expérience tentée à Bordeaux. Il devait arriver par le train de deux heures. Il est six heures et le docteur Roussin n’a paru.
L’audience est levée au milieu d’une émotion indicible.
À demain donc l’audition de ce dernier témoin.
P. O.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k46125886/f4.item.r=Marthiens%20Mano https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k591862r/f3.item.r=mano%2217%20juin%201873%22# https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k591864h/f3.image.r=mano# https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5918634/f3.image.r=mano#
Audience du 17 juin
Depuis les premières lueurs du jour, des curieux rôdent autour de la prison, dans l’espérance d’entrevoir Mano. Espérance audacieuse, pour peu que l’on considère la hauteur des murailles qui entourent la maison de détention. N’importe ! On attend, et si l’on n’aperçoit rien pour l’instant, on est payé de sa peine lorsque, vers dix heures, le prisonnier traverse, escorté des gendarmes, la ruelle qui sépare du palais la maison de justice.
Parmi les préoccupations qui agitent le public, la plus vive, assurément, a trait à l’état de santé du petit Bernardin. Est-elle provoquée par le seul intérêt que mérite l’enfant ? Ne redoute-t-on pas plutôt d’être privé, par l’absence du jeune témoin, de quelques-unes des émotions qui doivent mouvementer l’audience d’aujourd’hui ?
À l’appel des témoins, les doutes se dissipent. Bernardin Mano est parmi eux. Le pauvre petit est bien faible encore. Nous le trouvons pâli et abattu. Cet état est si apparent, même, que M. le Président déclare renoncer à la confrontation projetée hier. Il se borne à adresser au fils de Johannès quelques questions qui semblent destinées à fixer le jury d’une façon définitive sur le prix qui doit être attaché à ses déclarations.
L’accusé jette vers son fils des regards effarés. Bernardin, au contraire, évite de tourner les yeux du côté où est assis son père. Il reste debout, appuyé à la table du tribunal, bien en face du Président qui l’interroge.
Le petit Bernardin Mano, le seul témoin qui dans le premier procès ait apporté une preuve matérielle à toutes les autres preuves purement morales, ne tient plus aujourd’hui le même langage.
L’accusé a toujours prétendu et prétend encore qu’une femme — une commère selon lui peu bienveillante — aurait fait la leçon à son enfant.
M. le Président : Est-ce que cette femme t’a donné ce conseil ? dit le Président à ce pauvre enfant.
Bernardin : Non.
M. le Président : Est-ce que tes camarades, et notamment Henri Martin, t’ont conseillé d’accuser ton père ?
Bernardin : Oui.
M. le Président : Et c’est pour cela que tu as parlé ?
Bernardin : Oui.
Cette rétractation a produit une grande émotion dans l’auditoire. On le comprend sans peine. Cet incident donne aux débats nouveaux un caractère tout particulier. Si l’enfant persiste dans ses dénégations, l’accusation n’est plus armée contre Johannès Mano que de preuves à faire par déduction, et l’accusé est de taille — avec le sang-froid qui ne l’abandonne jamais — à lutter et à déduire lui-même des contre-preuves.
Comme on emmène l’enfant, le bruit se répand que le train de dix heures et demie doit amener l’expert qu’il reste à entendre. Le docteur Roussin vient de Lyon, où il a été récemment envoyé comme médecin en chef des hôpitaux. Une double haie de curieux, postée à la gare pour attendre son arrivée, l’accompagne jusqu’au Palais de justice. Au moment où il pénètre dans la salle d’audience, les têtes se tendent vers lui. Tout le monde veut voir « M. le chimiste de Paris ».
Le docteur Roussin est un homme, de quarante-cinq ans environ, de taille peu élevée, de traits fortement accentués. Il a le front très haut et l’œil à fleur de tête. Sa physionomie est celle d’un travailleur, d’un savant plein d’expérience ; entrerons-nous dans le détail de la déposition de ce témoin ?
François-Zacharie Roussin 1827-1894 naît le 6 septembre 1827 aux Grands-Moulins, en la commune du Vieux-Vy-sur-Couesnon petite commune de l’Ile et Vilaine. Après son baccalauréat, il quitte sa famille et entre en pharmacie à Rennes puis part à Paris en 1848 pour préparer et réussir en 1849 le concours d’internat des hôpitaux de Paris. Roussin se présente au concours du service de santé militaire et il est admis dans le corps des pharmaciens militaires en janvier 1853. Il est muté en Algérie. En 1857, il est appelé comme surveillant au Val-de-Grâce. L’année suivante, il est nommé sur concours professeur agrégé de Chimie et de Toxicologie et entre au conseil de la société Chimique de Paris puis devient membre de la Société de Pharmacie et rédacteur des Annales d’Hygiène publique et de médecine légale. Il multiplie les découvertes dans le domaine de la chimie : les nitrosulfures doubles de fer, une méthode de contrôle de la pureté du chloroforme, technique de synthèse du cyanogène. Connu pour sa découverte des colorants diazoïques acides, il travaille également dans de nombreux domaines, y compris en servant lui-même de cobaye pour ses expériences. En 1858, il devient expert-chimiste près du Tribunal de première instance de la Seine.
En 1861, en plus de ses activités hospitalières, de ses cours et de ses expertises, il mène des travaux brillants sur la naphtaline.
En 1867, Roussin tombe gravement malade mais il se remet.
En mai 1870, un complot est démasqué et Roussin fait l’examen des bombes prévues pour cet attentat.
À la déclaration de guerre contre l’Allemagne, Roussin est sous-directeur de la Pharmacie Centrale de l’Armée. Il reste à Paris durant son siège et l’instauration de la Commune, après la défaite et l’armistice du 20 janvier 1871. Ne voulant pas accepter les ordres d’un membre de la Commune pour un transfert de fonds, il est arrêté. Après une semaine, Roussin est libéré et réussi à passer les lignes prussiennes.
De retour à Paris à la fin de la Commune, il rejoint son ancien poste et en 1873 il est nommé pharmacien principal de 2ème classe et envoyé à Lyon comme pharmacien en chef de l’hôpital militaire.
En 1875, de retour à Paris, il est nommé Pharmacien principal de 1ère classe et reprend ses recherches sur les colorants et passe un accord avec l’industrie pharmaceutique pour l’exploitation de ses découvertes.
Malgré ses hautes fonctions il est muté en Algérie ; il refuse cette mutation et démissionne en 1879 et crée son laboratoire où il travaille jusqu’à sa mort. Celle-ci survient en 1894, à l’âge de 72 ans axphyxié par le gaz d’éclairage dans son laboratoire.
Cinq siècles de pharmacie hospitalière, 1495-1995, Ivan Ricordel, 1995.
http://apothicaire.armee.pagesperso-orange.fr/biblio/biblioFZ-Roussin.html
Les explications du médecin-expert ne durent pas moins d’une heure ; elles roulent tout entières sur des questions scientifiques de l’intérêt le plus élevé, mais qu’on ne saurait résumer sans en dénaturer le sens. C’est une véritable conférence sur l’état comparatif des globules sanguins chez l’homme ou chez les animaux, un cours complet où se trouvent passées en revue toutes les influences qui peuvent affecter, dans tous les cas prévus, le diamètre et la composition des globules.
Le docteur Roussin conclut :
– Que le pic ne portait point de traces de sang ;
– Que la blouse de Mano était tachée de sang de mammifère, sans qu’il soit possible d’indiquer que ce soit du sang humain ;
– Que le pantalon de l’accusé n’avait ni sang pur, ni sang dilué par le lavage ; aucune épreuve n’a pu lui démontrer que les taches rougeâtres qu’on y remarquait par endroits renfermassent des vestiges de la matière colorante du sang.
Ces conclusions sont diamétralement opposées à celles des experts de Bordeaux.
Ceux-ci sont rappelés à la barre des témoins : une longue controverse, fort courtoise dans les termes, s’engage entre les deux parties ; MM. Lafargue et Robineau maintiennent leurs affirmations. Le débat se prolonge jusqu’au moment où le docteur Roussin reconnaît que les six mois qui se sont écoulés entre ses expériences et celles de l’expert de Bordeaux ont pu modifier la nature des taches, dessécher ou même effacer les traces de sang.
Il est midi. Toutes les dépositions sont entendues.
Un bruit prolongé de chaises, un long frou-frou de robes, quelques sourdes rumeurs, quelques entrées précipitées d’auditeurs en retard, témoignent de l’empressement avec lequel va être écouté le réquisitoire.
M. le Procureur général Roë se lève.
Le calme se rétablit ; les dames, les élégantes d’Agen, aujourd’hui en nombre imposant, sont les premières à réclamer le silence.
Rapidement, à grands traits, sans s’attarder aux minuties, l’organe de l’accusation débarrasse la cause des éléments accessoires et des faits de tout ordre qui l’obscurcissent. Le Procureur général passe ensuite à 1’examen des charges qui attestent sûrement la culpabilité de Mano ; il s’étend longuement, ici il est au cœur même de la terrible question. Son langage incisif aiguise le fer sous le coup duquel doit succomber l’accusé dont 1e représentant de la vindicte publique dresse en cet instant l’échafaud.
Mano courbe la tête, littéralement anéanti et quand M. le Procureur général M. Roë arrive à la péroraison de son réquisitoire, le prévenu semble plus mort que vif.
Ce réquisitoire a duré 4 heures et demie.
À l’éloquence du ministère public, va répliquer l’éloquence de la défense.
Mais l’heure est trop avancée pour que Me de Brezetz puisse prendre la parole ; sa plaidoirie est renvoyée à demain.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k591865w/f3.image.r=mano
Audience du 18 juin 1873
Depuis quelques instants les places réservées de la salle d’audience, sont complètement envahies. Au fond, la partie réservée au public est encore vide. Dix heures sonnent. La grande porte d’entrée s’ouvre à deux battants.
La foule se précipite avec un mugissement de mascaret et vient déferler contre la cloison de chêne, à hauteur d’appui qui sert de limite à son domaine. Mano est déjà à son banc, affaissé, abattu ; cette prostration où il est tombé depuis trois jours, paraît être devenue son état normal. Le défenseur de l’accusé s’assied à la barre ; à ses côtés prend place un jeune maître du barreau de Bordeaux, M. Lafabrie qui, depuis le commencement des débats, prête à Me de Brezetz un utile et précieux concours.
Un huissier annonce : « La Cour ».
Lentement, le silence se fait.
La parole est à l’avocat, dit M. le Président.
Me de Brezetz se lève et commence sa plaidoirie.
Nous y retrouvons, dès les premiers mots, cette science de l’argumentation, cette vigueur dans la riposte, cette chaleur persuasive, que, déjà le premier procès, nous avait appris à connaître.
Interrompue par un court repos, vers une heure, la défense est reprise et se poursuit encore à l’heure où le courrier réclame notre envoi.
De mémoire de plaideur, jamais la patrie de Bernard Palissy, de Lacepède et de Jasmin, n’avait assisté à de pareils efforts d’éloquence.
L’audience de nuit commence à huit heures du soir. Avant de déclarer clos les débats et de présenter son résumé, M. le Président Audidier pose à l’accusé la question obligatoire d’après le code d’instruction criminelle : Accusé, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense ?
Mano se lève et répond, se dandinant légèrement à l’exemple de certains orateurs à la tribune : Messieurs les jurés, j’ai à vous dire de bien réfléchir à la sentence que vous allez rendre.
Il y a six jours que je suis en votre présence ; on m’a jugé à Bordeaux, les débats ont duré cinq jours. Après ma condamnation aux travaux forcés à perpétuité, plusieurs jurés sont venus me voir dans la prison. Je leur ai demandé : « Sur quelles preuves m’avez-vous condamné ? » Ils ne savaient point ; ils n’étaient pas sûrs ; ils ne connaissaient pas alors les résultats de l’expertise faite à Paris. Sans cela je ne serais pas ici aujourd’hui. Eh bien ! ce que j’ai demandé à Bordeaux, je le demande encore : la liberté ou la mort. Si vous me condamnez, condamnez-moi à mort. Un bon Français ne recule pas devant l’ennemi ; un innocent ne recule pas devant la mort. Je suis, je suis innocent !
Un long silence suit ce petit discours que Mano avait très probablement préparé depuis longtemps ; il l’a débité avec beaucoup d’aplomb.
- le Président déclare les débats clos et prononce son résumé.
C’est une grande et belle page d’éloquence qui débute par un tableau saisissant du crime de Tastous.
- le Président, avant de rappeler les détails de l’assassinat, précise l’heure du crime : minuit ! Un rapprochement poignant va sortir bientôt de cette constatation.
Pendant que M. le Président Audidier expose de nouveau cette dramatique affaire, la foule qui se presse aux abords du Palais de justice est bruyante au point qu’à plusieurs reprises les clameurs couvrent la voix du Président.
Le résumé, est terminé à dix heures et demie.
L’accusé Mano est emmené hors de la salle d’audience.
Les jurés entrent dans la salle des délibérations.
Tous les assistants restent à leurs places sans bouger malgré la chaleur accablante. On discute avec animation, les interpellations se croisent, les hypothèses s’échangent des diverses parties de la salle avec une vivacité toute « méridionale ».
Pendant ce temps, Mano fume tranquillement des cigarettes dans une salle voisine.
Il est minuit moins quelques minutes ; la sonnette est agitée ; les magistrats reprennent leurs sièges.
La salle, qui se trouvait dans une quasi obscurité, est éclairée par plusieurs lampes supplémentaires placées sur le bureau. Les jurés sont introduits ; ils ont une attitude grave et solennelle.
Le chef du jury met la main sur le cœur et d’une voix émue prononce le verdict : la réponse est sur toutes les questions : OUI, l’accusé est coupable.
Le verdict est muet sur les circonstances atténuantes.
Un long frémissement parcourt l’auditoire ; mais, au même instant l’accusé est ramené dans la salle d’audience et tous les regards se tournent vers cet homme que la mort attend.
- le greffier lui donne lecture du verdict qui vient d’être prononcé. Mano baisse la tête et murmure: « C’est la mort ! »
C’est là peine capitale, en effet, que M. le Président applique à Mano.
Son nom provient du latin caput, « tête », se référant à la punition pour les infractions graves impliquant la perte de la tête
À ce moment les horloges du palais de justice et la pendule de la salle d’audience tintent le premier coup de minuit. Minuit ! L’heure du crime et l’heure de l’expiation !
Le rapprochement que nous indiquions tout à l’heure se présente à tous les esprits. Plusieurs dames poussent des cris de superstitieuse terreur et s’évanouissent. Mano lui-même est sous le coup d’une émotion telle qu’il n’en avait pas encore éprouvé ; il est pâle comme un mort.
M. le Président est obligé de lui répéter deux fois la question : « Avez-vous quelque chose à dire sur l’application de la peine ? »
Mano relève lentement la tête ; ses yeux hagards se tourment de tous côtés ; il hésite, il tremble ; enfin, faisant sur lui-même un grand effort, il répond d’une voix faible : « On a contenté les témoins, mais on condamne un innocent. »
Mano est entraîné par les gardiens ; il chancelle comme un homme ivre.
Il est réintégré dans la prison, où il est soumis à une surveillance rigoureuse, afin qu’il ne puisse pas tenter de se suicider.
L’arrêt porte que l’exécution de Mano aura lieu sur la place publique du Barp
L’audience est levée à minuit cinq minutes.
L’auditoire, se mêlant à la foule qui stationnait sur la voie publique, reprend à nouveau des discussions bruyantes et passionnées. Jamais les habitants d’Agen n’avaient fait en masse une aussi longue « veillée. »
Cette nuit restera certainement légendaire, sous ce titre : la nuit de Mano.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7533591x/f3.item.r=mano.zoom#
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k591865w/f3.item.r=mano.zoom#
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k591861c/f3.image.r=le%20barp?rk=214593;2
Le condamné Mano
Voici, d’après le Petit Journal, d’intéressants détails sur l’attitude de Mano, après sa condamnation : en retournant à la prison, il chancelle sur ses jambes ; mais il montre encore assez d’empire sur lui-même pour traverser le front haut les rangs pressés des curieux et narguer cette foule qu’une nombreuse escorte de gendarmes a peine à contenir.
En rentrant, le prisonnier soupe… d’un bon appétit.
– Bah! bah! répète-il un peu fiévreusement, ça n’est pas encore définitif Demain, je me pourvoirai en cassation.
Ce pourvoi n’est point signé encore à l’heure où part ce courrier (24 juin 1873).
Ses codétenus s’empressent autour de lui, lorsqu’il se lève ce matin, à cinq heures. En apprenant le jugement qui le frappe, tous commencent à lui faire leurs adieux, supposant qu’on va le séparer des autres pour le placer dans une cellule à part. Mais le gardien-chef déclare à Mano qu’il lui continuerait la détention en commun, tout au moins jusqu’à ce que la Cour suprême se soit prononcée sur son pourvoi.
Nous venons de voir le condamné.
Sa pâleur a disparu ; il a presque bonne mine. Il se nourrit fort bien, d’ailleurs, grâce à des générosités qui lui permettent de s’alimenter de mets extra tirés de la cantine.
Nous avons jeté les yeux sur son compte de cantine du 14 au 18 courant. Dans ce court laps de temps, Johannès Mano a dépensé 22 fr 45 ; dans ce chiffre figure pour 1 fr 80 c de tabac.
Son argent de poche s’épuisait, on le comprend, à ce train de vie effréné. Il s’est renouvelé aujourd’hui, et le premier soin du prisonnier a été de demander :
– Des saucisses ! beaucoup de saucisses !
Dès qu’il a été vêtu, ce matin, il a dit sa prière à genoux. Puis il s’est mis à mordre à belles dents dans un morceau de pain qui lui restait d’hier. Le gardien de sa section, Pons, qui l’a surveillé la nuit, de peur qu’il eût la tentation de se livrer à quelque extrémité désespérée, a simplement constaté le sommeil profond dans lequel Mano est tombé quelques minutes après s’être couché. En le voyant manger de si bon cœur, Pons lui dit :
– Cela va donc encore, l’appétit ?
– Parbleu ! répliqua Mano, croyez-vous que je vais me troubler pour si peu. On me coupera le cou si on veut, mais l’appétit, jamais !
Lorsque nous l’avons vu, il venait de recevoir un excellent paquet de tabac frais et bourrait consciencieusement sa pipe.
– Eh bien ! Mano, il vous faut du courage.
– Oh ! Monsieur, le courage ne me manque pas. Quand on est innocent !
– Êtes-vous donc bien sûr d’être innocent !
– Avez-vous vu des preuves, vous, Monsieur ? Ils n’en ont pas ! et je vais encore les faire casser (sic) parce que je crois que ça réussira à la fin à me faire rendre justice.
– Pensez-vous que ce soit facile ?
– Moi ! Je connais une affaire où la Cour a cassé trois fois le jugement ! Eh bien ! j’ai encore deux fois devant moi !
En le quittant, nous l’avons laissé persuadé que l’arrêt fatal ne sera pas exécuté et plein d’illusions sur le sort que l’avenir lui réserve.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4668218r/f4.item.r=%22johann%C3%A8s%20mano%22cayenne.zoom#
Pourvoi en cassation
Condamné à la peine de mort, l’exécution est prévue au Barp.
Son pourvoi en cassation est rejeté le 17 juillet 1873.
Début août 1873, Le Courrier de la Gironde dit que le Barp est, depuis quelques jours, envahi par une foule de curieux qui viennent assister à l’exécution de Mano. Toutes les nuits, la route agricole de Marcheprime, le chemin de Tournebride, la route de Belin sont sillonnés par des carrioles et des voitures transportant des landais qui viennent, en attendant les premières lueurs du jour, camper sous un hangar ou au milieu des pins.
On ignore le résultat du pourvoi en grâce de l’ex-facteur du Barp. En attendant, il est encore dans la prison d’Agen.
Et voici comment de la réalité, on verse très vite dans la fiction ! Plusieurs individus s’imaginent la scène de la décapitation car, comme le veut le Code pénal « Tout condamné à mort aura la tête tranchée » ; c’est le pic qui est choisi pour « tranche-tête ». Si celui-ci est bien aiguisé (avec le fusil du boucher Duprat) — et le bourreau habile —, la décapitation sera rapide et présumée être une peine de mort indolore, aussi a-t-on recommandé à Johannès de donner une pièce d’or au bourreau pour s’assurer qu’il fera son travail avec application. Mais, quelle que soit l’habileté du bourreau, plusieurs témoignages relatent avoir entendu dire que la tête du condamné peut rester consciente pendant une demi-minute. Dans la tête, séparée du corps par ce supplice, le sentiment, la personnalité, le moi, reste vivant pendant quelques longues minutes, et ressent l’arrière-douleur dont le cou est affecté ; la douleur physique se double en quelque sorte d’une torture mentale : la terreur de se voir séparé de son corps, de se voir mort !
Des expériences neuroscientifiques d’électro-encéphalographie sur le crâne de rats décapités en 2011 montrent que les ondes électriques de « conscience » restent visibles environ quatre secondes après la décapitation, puis disparaissent au bout de 17 secondes (ce qui correspond à un état second de torpeur sans aucune conscience) et, au-delà de 50 secondes, une onde de basse fréquence intense est enregistrée, correspondant à la mort cellulaire définitive.
On sait avec certitude que la pendaison est indolore puisque l’on connaît des personnes revenues à la vie après ce genre de mort et qui ont dépeint un sentiment qu’il est impossible de connaître de la même manière dans le cas de la décapitation.
Comme l’a prononcée le tribunal, la date fatidique serait le 15 août 1873, à proximité des cabarets que Johannès aimait fréquenter. Nombreux sont les curieux venus de Bordeaux ou d’ailleurs pour assister à cette décollation : on doit à la diligence de Jean Tastes, maire, d’avoir prévu des parkings aux différentes entrées du Barp pour les berlines, cabriolets, calèches, carrosses, fiacres ou autres voitures hippomobiles ; seuls les attelages impairs ont le droit de rentrer dans le village ce jour-là. Que Mano ait la tête tranchée, le préfet Pierre Ponce, venu exprès du Pilat (on prononce pilate), déclare “Je suis innocent du sang de ce juste, vous, vous y aviserez” puis s’en lave les mains au gel hydroalcoolique. Marie Dussaud, dite la Couenne, est plébiscitée pour trancher dans le lard. La foule se fait de plus en plus compacte, le pauvre hère côtoyant les notables du coin, ne respectant pas les distanciations sociales.
Alors que la Couenne s’apprête à lever les bras, voilà-t-il pas que le télégraphe des « Trois lagunes » (Cestas), en sommeil depuis maintenant vingt ans, reprend du service et agite ses bras comme un pantin désordonné ; recevant une missive venant de Bordeaux , il se dépêche de la rapporter à son homologue de « Chantier » (Le Barp) : après avoir décodé les signaux, elle révèle que le condamné a été gracié la veille.
Rapporté (en partie) par le journal Le Temps du 4 août 1873
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2254629/f3.image.r=aubergiste%22le%20barp%22?rk=493564;4
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5918681#https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k591869d#
Johannès Mano est gracié
Johannès Mano est gracié le 14 août 1873 ; on nous écrit d’Agen même, le jeudi 21 août : Hier, a onze heures du matin, Mano a été extrait de la maison d’arrêt afin d’entendre la lecture des lettres de grâce qui commuent la peine de mort prononcée contre lui en celle des travaux forcés à perpétuité.
Depuis le rejet de son pourvoi, il ne s’était pas départi un seul instant de cette impassibilité qui avait profondément étonné les nombreux témoins de son procès. Sa seule préoccupation était, dans ces derniers temps, d’élever un moineau que M. Delorme, gardien-chef de la maison d’arrêt, avait mis à sa disposition ; il affectait de ne pas songer à son procès, et dans les entretiens qu’il eut ces jours-ci avec son défenseur, Me de Brezetz, et l’honorable aumônier des prisons, il ne cessait de protester de son innocence (on va finir par le croire !)
Rien n’a pu le faire sortir de son atonie morale, pas même la nouvelle un peu inattendue de sa grâce ; la décision du chef de l’État qui lui laisse la vie, l’a trouvé à peu près indifférent. C’est avec le même sang-froid qu’il est venu s’asseoir sur les bancs de la salle d’audience de la 1ère chambre. Lorsque la Cour est entrée en robes rouges, il s’est levé et a écouté debout, les yeux constamment fixés sur le sol, la lecture faite par le greffier en chef ; puis il a suivi sans mot dire les quatre gendarmes placés autour de lui, et a regagné sa cellule. Ce calme réel ou simulé a fortement impressionné le public dont la curiosité avait été un moment réveillée par la solennité de l’audience où l’on a procédé à l’entérinement des lettres de grâce.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4670861m/f3.item.r=%22Mano%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20extrait%20de%20la%20maison%20d’arr%C3%AAt%20%22.zoom
Johannès Mano arrive au bagne de Toulon le 28 août 1873
(le bagne de Toulon fermera à la fin de cette année-là) ;
il le quitte pour un bagne outre-mer, le 1er octobre de la même année.
Les condamnés partent pour l’exil avec forfanterie et arrogance. Les curieux qui assistent à leur embarquement les ont entendus la veille « faire le bal » : on appelle de ce nom la promenade dans la cour après le repas du soir, promenade accompagnée de ces deux mots, incessamment répétés sur le même rythme par la voix traînante des forçats « une, deux ; une deux ». Puis, tous, le lendemain, revêtus d’un uniforme identique, les cheveux coupés ras et la figure glabre, ils sortent de la prison, le front haut, le regard effronté, la bouche plissée d’un mauvais sourire ; ils montent, l’un après l’autre, sur le bâtiment qui doit les transporter là-bas, outre-mer ; et tandis que les mugissements espacés de la vapeur annoncent l’heure prochaine du départ, des profondeurs de la cale, où sont entassés comme dans l’enfer ces nouveaux damnés, partent des chants cyniques et sauvages qui seront désormais leur seule et impuissante vengeance contre la société.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56155497/f4.image.r=bagne%22%C3%AEle%20de%20Nou%22?rk=85837;2#
Les bagnes coloniaux furent créés par la loi de Napoléon III du 30 mai 1854. Mais les départs pour Cayenne avaient été organisés dès la promulgation du décret du 8 décembre 1851 signé quatre jours après le coup d’État.
Les bagnes, cependant, avaient déjà une longue histoire. Les galères, tout d’abord, servirent comme moyen de punition des condamnés. Puis, avec le progrès de la marine à voile, on utilisa les détenus à différents travaux forcés, tout en continuant à les rassembler dans les ports, principalement Rochefort, Brest et Toulon.
Les transports outre-mer de condamnés, de vagabonds et de prostituées commencent très tôt, dès le XVIe siècle vers le Canada, au XVIIIe siècle vers la Louisiane. Ils ont pour but de peupler les colonies plutôt que de réprimer et punir. Mais ils se soldent le plus souvent par des échecs : rappelons ici pour mémoire la lamentable affaire du peuplement de Kourou en 1764. La Guyane apparut bientôt cependant comme la colonie idéale pour se débarrasser des personnes indésirables en métropole. Elle fut considérée à la Révolution comme « terre de punition », et la Convention thermidorienne, dès 1794, y envoya les premiers déportés politiques.
Les ports restent pourtant, jusqu’au milieu du XIXe siècle, les lieux d’enfermement traditionnels des condamnés. Puis c’est en Algérie que l’on transporte les insurgés de 1851. Mais, dès 1852, la priorité est donnée à Cayenne pour l’enfermement de tous les condamnés politiques ou de droit commun.
L’envoi dans cette terre lointaine présente en effet un double avantage par rapport aux ports : la disparition, sans retour possible, de la population dangereuse, le remplacement, avantageux pour la mise en valeur d’une colonie qui stagne, des esclaves libérés en 1848 par une autre main-d’œuvre aussi peu coûteuse.
Les colonies pénitentiaires de Guyane et de Nouvelle-Calédonie sont administrées par le Ministère de la Marine et des Colonies, puis par le ministère des Colonies institué en 1881, en étroite liaison avec les ministères de la Justice et de l’Intérieur.
Voici ce que nous pouvons lire dans « Le Moniteur du Puy-de-Dôme » dans le numéro des 24 et 25 août 1874 :
« Mano, l’auteur des assassinats de Tastous, est mort à Cayenne des suites d’une fièvre. Il a avoué les cinq assassinats qu’il avait niés devant la cour d’assises de Bordeaux, et deux autres encore dont la justice n’avait pu trouver les auteurs. »
Agence Havas
https://francearchives.fr/findingaid/71350452a2100c631e7593e2f8fb7dc398b48fb8
https://www.bibliotheques-clermontmetropole.eu/overnia//media-dam/CLERCO/lapresse/PDF/Le_Moniteur_1874_08_24.pdf
Trois jours après, il est … ressuscité !
C’est bien à tort
Que nous l’annoncions mort,
Car trois jours après,
Il est … ressuscité !
Plusieurs journaux ont annoncé à diverses reprises la mort de Mano, l’auteur du quintuple assassinat de Tastous, qui fut condamné pour ce crime aux travaux forcés à perpétuité par la Cour d’assises d’Agen.
Mano n’est point mort, ainsi qu’on l’avait annoncé ; il vient d’écrire à son avocat, M. le baron de Brezetz, la lettre suivante, portant le timbre de la Nouvelle-Calédonie en date du 28 août 1874 de l’ile Nou, visée par le commandant du pénitencier et publiée par le Journal de Bordeaux.
Mano
6085
Vu : Le commandant du pénitencier
Monsieur de Brezé,
Selon que vous m’en aviez exprimé le désir, j’ai attendu qu’un certain laps de temps se soit écoulé depuis mon arrivée à la Nouvelle-Calédonie pour vous écrire.
J’ai six mois de séjour ici, je travaille de l’état de charpentier, mais je ne suis pas payé. Ma santé est assez bonne et je tâche de prendre mon mal en patience, certain que grâce à vos efforts, mon innocence sera enfin reconnue. Recherchez toujours les véritables coupables et la vérité se fera enfin jour. Tôt ou tard ils se dévoileront, et je pourrai revoir enfin mon pays et mes parents. Ma dette envers vous, déjà si grande, s’accroît tous les jours, mais croyez monsieur, que ce n’est pas un ingrat que vous avez bien voulu défendre et je vous ai voué depuis longtemps une éternelle reconnaissance.
Recevez, en même temps, les humbles respects de votre humble serviteur
mano.
Voici mon adresse Mano (Jean), transporté, n° 6085.
Source : Journal des débats politiques et littéraires du 2 & 3 novembre 1874 :
L’île Nou comprend le Camp-central, le Camp-est, la Ferme-Nord et l’hôpital du Marais. De 1890 à 1898, la pointe nord accueille également des lépreux.
La Gironde, de son côté, dit avoir reçu de Cestas une lettre signée « Mano père ». Ce dernier déclare avoir reçu de son fils, à la date du 10 août, une lettre qui met en doute dans son esprit la réalité de la mort de son fils.
Le Temps, 1er novembre 1874
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k225920q/texteBrut[r1]
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k459164c/f3.item.r=mano.zoom#
Retour sur image : avec le décodage de la fiche rédigée lors de son passage au bagne de Toulon, vous auriez vu que les journalistes vous menaient en bateau : « Détaché de la chaîne le 30 septembre 1873 et embarqué pour la N. Calédonie sur le transport le Var parti le 1er octobre 1873. »
Johannès Mano ne pouvait donc pas mourir à Cayenne ; sa légende mérite mieux que de se terminer en queue de poisson !
Le Var est un transport-écuries à hélice de type Ardèche construit par les chantiers de Bordeaux, chez Bichon à Lormont, lancé le 12 décembre 1863 et rayé probablement en 1887. Ce type de navire est un trois-mâts barque, spécialement conçu pour le transport des chevaux sur les théâtres d’opération, dessiné par Guesnet selon les plans du Calvados, qui peut recevoir 400 passagers et 360 chevaux ou mulets. Chaque animal dispose de 60 cm de largeur dans un des deux faux-ponts affectés au transport. Les dimensions du bâtiment sont de 80 m 33 x 13 m 00 x 4 m 77, le jaugeage de 3479 tonneaux, pour une vitesse maximum de 9,42 nœuds. La propulsion s’effectue au moyen de 2 machines à vapeur de 230 ou 280 ch Schneider horizontales, soit 980 chevaux nécessitant 200 tonnes de charbon, et une voilure de 3140 m². Il est équipé d’une hélice à deux ailes de 4,10 mètres de diamètre. L’armement, en principe de 4 obusiers de 30, est sur le Var de 2 canons de 14 sur les gaillards, et 3 canons de montagne de 4 pour les embarcations. Enfin l’équipage est de 212 à 215 officiers et hommes d’équipage.
En 1873, le Var effectue un voyage vers la Nouvelle-Calédonie, sous les ordres du capitaine de frégate François Baux.
Le 1er octobre, outre l’équipage, des militaires, des gardiens, des religieuses, le navire emmène 363 transportés hommes et 25 femmes, comme le montre la liste des passagers.
Louis Lemaître fait partie des condamnés ; il sera libéré le 7 décembre 1879 et, le 1er avril 1882, se épousera Olinda Guelpa, veuve de François Canosa, ancienne pensionnaire du couvent de Bourail, libérée de la réclusion. Ils auront cinq enfants. L’administration pénitentiaire ne souhaitant pas les laisser à la seule éducation des parents, à cette fin, a ouvert deux internats ouverts : l’un à Néméara, près de Bourail pour les garçons et l’autre à Fonwhary pour les filles.
L’administration pénitentiaire disposera de 100 000 hectares répartis en plusieurs centres de concessionnaires sur la côte Ouest de la Nouvelle-Calédonie : Bourail, La Foa-Fonwary, le Diahot et Pouembout, auxquels il faut ajouter les domaines de la ferme expérimentale de Koé à Dumbéa et celui de l’exploitation de Prony.
Léopold Godde, matricule 5898, né le 30 juin 1847 à Issou (Seine-et-Oise), marié, trois enfants, cultivateur a été condamné, en 1873, à huit ans de travaux forcés, pour avoir volontairement incendié un bâtiment appartenant à autrui, il est aussi sur le Var (24e convoi). En 1877, il obtiendra une remise de peine de 18 mois et sera libéré le 30 octobre 1879, astreint à résidence. Il décède à Nouméa, le 23 mai 1886. CAOM H477
Louis Jean Rateau, Marchand de bois, Cultivateur, est né le 8 mars1853 à Poitiers et décèdera le 10 août 1927 à Nouméa. Matricules 5964 – 8257 – 4918, il a été condamné le 20 mars 1873 à perpétuité pour vol par plusieurs personnes à l’aide de violences ayant laissées des traces ; il fait aussi partie du convoi. Sa peine sera commuée en 20 ans de travaux forcés. Il épousera le 28 janvier 1885 à Bourail, Pierrette Françoise Granger, née à Villefranche-sur-Saône le 8 mai 1857, décédée le 25 mai 1912 à Pouembout ; 3 enfants vont naître à Pouembout de cette union.
Pierre Fernand Ferdinand Rochet, Percepteur, est né à Avesnes le 19 juillet 1841 et y a fait des boulettes ! Matricule n° 6016, il a été condamné 4 juin 1873 à la peine de 10 ans de travaux forcés pour s’être rendu coupable de 24 détournements de fonds, de 12 faux en écritures authentique et publique, usage de 12 pièces fausses sachant qu’elles était fausses, de trois délits de concessions, de 4 faux en écritures privées, usage de 4 pièces fausses sachant qu’elles étaient fausses, le tout en sa qualité de percepteur des contributions directes. Aurait détourné 17.000 Frs. Libéré en 1884 il s’installe à la Foa où il décèdera le 20 décembre 1917; le 3 mars1886, il épousera à La Foa Marguerite Quinty, née le 20 octobre 1866 à Gelles (63) et décédée le 15 mars 1942 à La Foa. 3 enfants sont nés de cette union.
Marie Rosalie Roze, Domestique, voit le jour le 8 décembre 1853 à Crépol (26). Condamnée, en juillet 1872, en correctionnelle à 3 mois de prison pour vol puis, en avril 1873, en assises à 5 ans de réclusion pour vol qualifié. Matricule 56 – 28, elle a le mal d’amour et presque sitôt mis le pied à terre, épouse en premières noces à l’âge de 20 ans, le 26 mai 1874 à Bourail, Francois André Briand, né le 16 mars 1842 à Trémuson (22), décédé le 31 mai 1902 à Bourail. Elle épousera en secondes noces, le 2 février 1906 à Bernay (27), Camille Auguste Dupendant né le 30 décembre 1852 à Saint-Mards-de-Fresne (27). Sept enfants naîtront à Bourail de son premier amour.
François Rieu[1], natif de Fort de France, a embarqué comme passager civil ; sa mère Élisabeth Lacouture est  décédée à Bordeaux le 20 octobre 1870 à 50 ans et c’est l’oncle de François Joseph Lacouture[2], 65 ans, qui a été greffier au Fort Royal, qui témoigne du décès ; il se dit copropriétaire à Macau. Il semble donc que cette famille ait quitté la Martinique avant 1870.
décédée à Bordeaux le 20 octobre 1870 à 50 ans et c’est l’oncle de François Joseph Lacouture[2], 65 ans, qui a été greffier au Fort Royal, qui témoigne du décès ; il se dit copropriétaire à Macau. Il semble donc que cette famille ait quitté la Martinique avant 1870.
François Rieu est né le 26 août 1842 à Fort de France – Martinique (son père Alexandre Benoît Rieu, né à Serres Hautes-Alpes, est huissier au tribunal de première Instance de Fort Royal), décédé le 15 août 1912 à Nouméa. Employé de commerce. Marié le 19 septembre 1887 à Nouméa avec Marie-Anne Kimmenau 1850-1936 née le 24 juillet 1850 à Ottersthal – Bas-Rhin, décédée le 31 mai 1936 à Nouméa ; ils sont tous les deux inhumés au Cimetière du 4e Km – Nouméa
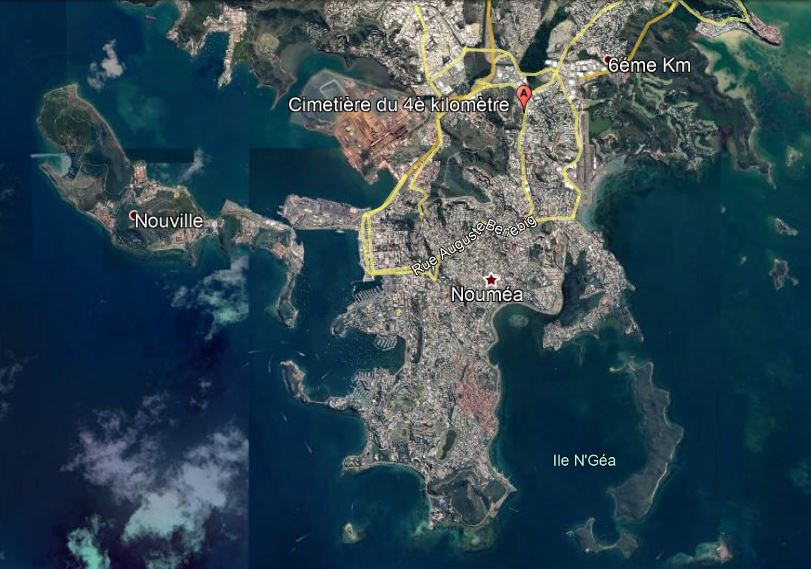
Geneanet indique Joseph Marie Lacouture né le 9 novembre 1805 – 1 Rue Saint Pierre – Bordeaux, décédé le 25 juin 1876 – Domaine de Fellonneau – Macau, Propriétaire – Huissier de juge de paix, marié le 12 novembre 1838, Fort-de-France, avec sa nièce Jeanne Adélaïde Dite Rosilla Lacouture 1821-1876 ; Joseph Marie 32 ans épouse sa nièce de 17 ans avec dispense du Gouverneur.
Piquée par le virus de l’écriture, passionnée d’histoire et de généalogie, France Blanc a écrit le livre « Macau Autrefois ». On y apprend que Macau en gascon voulait dire « fosse, marais ou encore mauvais lieu » et qu’un bateau, qui reliait les deux rives, portait ce nom de « Maqu’au ».
Au fil des pages d’une lecture facile, on rencontre de nombreux personnages illustres qui ont marqué la commune comme Jean Lacouture qui a passé son enfance au château Fellonneau ; Frédéric Blanc un organiste de renommée internationale ; le docteur Joseph Ignace Guillotin, médecin, homme politique et humaniste qui a réalisé les premiers croquis de la célèbre guillotine « pour humaniser la mise à mort » ; le faïencier Jules Vieillard qui habitait les châteaux Larrieu-Terrefort et Rose la Biche… Mais aussi le maréchal-ferrant Jean Joyeux ; un fabricant de bougies présent entre les deux guerres, de nombreux commerces de bouche d’alors… Bref, toute une histoire locale à redécouvrir.
Né à Bordeaux en 1837, fils de Théodore Bridon, “armateur et propriétaire du château de Taste à Sainte-Croix du Mont”, Édouard Bridon compte aussi au nombre des passagers. Laissant sa famille en France, il est vient seul tenter sa chance dans la colonie, avec quelques fonds certainement puisqu’il figurera comme “commerçant de marchandises de toutes catégories” au tableau des patentables de 1875. Cette même année il quitte Nouméa pour exploiter la mine Ghio – dénommée L’Inattendue –, à Nakéty ; le filon de stibine – le minerai d’antimoine – est suffisamment prometteur avec des teneurs moyennes de 25-35%, voire 50%, dont il possède 22/500, en association avec Alcide Desmazures, Maurice et Imbault (on trouve par ailleurs qu’il possèderait 70 % de la mine, Joseph Henochsberg, négociant à Nouméa, pour le 30% restants). En pleine débâcle du nickel en 1877-1878, Édouard Bridon refuse de céder sa mine de Nakéty. Les travaux exécutés en 1878 consistèrent en deux puits foncés sur la ligne limite des concessions « La Paix » et « L’Inattendue », à une profondeur de 18 à 20 mètres. MM. Bridon et l’ancien forçat Bouteiller s’acharnant après ce point dont ils s’étaient disputés la possession avant la délimitation, foncèrent deux puits jumeaux séparés par une paroi centrale de 40 centimètres à peine, qui était leur limite. La chronique locale rapporte que les propriétaires de ces claims, animés l’un contre l’autre de sentiments hostiles, assistaient à l’exécution de leurs travaux, armés tous deux d’un revolver. Bridon ne renoncera en mars 1880 qu’une fois tombé gravement malade d’épuisement, puis se reconvertira dans le journalisme : fin 1887, ses articles sont favorables à la venue d’un homme providentiel, Boulanger, ou hostile au bagne et aux “grandes compagnies”.
M. Y. Mollier montrera par ailleurs que la transportation a « contribué à accumuler le capital primitif des sociétés minières qui dominent la Grande Terre après 1880 » en prêtant ses détenus aux grandes compagnies minières.
Des centaines de bagnards font ainsi l’objet de tractations commerciales entre l’administration et des entrepreneurs privés, en toute légalité. Des convois de deux cents à trois cents hommes sont échangés contre des domaines fonciers et cédés pour une durée de dix à douze ans.
https://books.google.fr/books?id=vtGgDwAAQBAJ&pg=PA147&lpg=PA147&dq=30+janvier+1874+ile+de+nou&source=bl&ots=wSU54hjSC4&sig=ACfU3U38XiOkbY6qiZj9sTO-gKXjWcqVyw&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjB6a2orP3sAhWPDWMBHTPeCcQ4HhDoATADegQIARAC#v=onepage&q=30%20janvier%201874%20ile%20de%20nou&f=false
https://www.le-bagne-dans-lile-la-plus-proche-du-paradis.fr/fs/Root/ejh8y-Q-R-hommes-Detail.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mines_d%27antimoine_de_Nakety
https://www.noumea.nc/sites/default/files/150_ans_de_memoire_collective_caledonienne_catalogue_complet.pdf
https://www.bibliotheques-clermontmetropole.eu/overnia//media-dam/CLERCO/lapresse/PDF/Le_Moniteur_1874_08_24.pdf
Nouméa
Le Var aborde Nouméa le 30 janvier 1874.
En 1925, le voyage de M. Guyon pour se rendre en Nouvelle Calédonie, par Suez, Ceylan et l’Australie nous vaut, dans des vers de sa composition, une poétique description des divers aspects de l’Océan Indien et de l’Océan Pacifique et des approches de Nouméa où des cocotiers bordent des falaises rouges couronnées de forêts sur lesquelles se détachent les bâtiments des exploitations.
Nouméa est fondée en 1854, sous le nom de « Port de France » par Tardy de Montravel ; le nom de Port de France est abandonné en 1866 remplacé par celui de Nouméa.
Tardy de Montravel pense en marin : après avoir exploré la Baie Saint Vincent une trentaine de kilomètres au nord, il choisit ce site, une presqu’île vers l’extrémité sud de la Nouvelle-Calédonie (Grande Terre), pour la qualité de sa rade d’eau profonde bien abritée. Il est séduit par les qualités de la rade de Nouméa, mais il n’y a pas d’eau douce dans cette presqu’île. Il faut récolter l’eau à partir des toitures et plus tard l’amener de la petite rivière Yahoué au pied du pic Malawi (ou Chapeau de Gendarme). L’eau sera un problème récurrent pour cette ville aujourd’hui alimentée par le barrage sur la rivière Dumbéa à plus de 20 km et récemment, car les besoins de Nouméa dépassent cette ressource, par la rivière Tontouta à 50 km.
L’île de Nou
L’île forme la limite du port du côté de la mer. Elle a un peu la figure d’une jambe ployée dont la semelle est tournée vers la ville et fait, avec les quais, une ligne presque parallèle. Le pied de l’île met le port à l’abri des lames du large déjà brisées, du reste, par la ligne de récifs qui enceignent la grande terre presque complètement. La partie qui représente assez fidèlement l’articulation du jarret limite la grande rade de Nouméa, au nord de laquelle est placée la presqu’île Ducos.
La superficie de Nou est peu considérable. Dans sa plus grande longueur elle mesure à peine 6 kilomètres ½ ; sa plus grande largeur est de 3 kilomètres. On y compte environ 484 hectares de terrain, dont un quart à peine paraît cultivable. Une petite propriété de 25 à 30 hectares, expropriée depuis, et sur laquelle ont été établies les principales cultures du pénitencier, avait été concédée à M. Paddon, qui commerçait à la Nouvelle-Calédonie vingt ans avant qu’elle ne fût française, et qui, sous le gouvernement de M. l’amiral Saisset, avait traversé les 360 lieues de mer qui séparent cette colonie de Sidney, sur un petit bateau non ponté. Il est douteux qu’on puisse trouver dans toute l’île un espace plat plus considérable. On le comprendra aisément, lorsqu’on saura que cette petite terre compte six montagnes dont l’altitude est de 120 m pour le mont Mabou, 127 m pour le mont Uo, aux pieds desquels sont placés les établissements du pénitencier, et le mont Tereba, qui en compte 137. C’est sur ce terrain tourmenté et en partie boisé que fut placé l’établissement-dépôt de la transportation.
Le premier occupant est en fait l’anglais James Paddon, un remarquable marin marchand. Il achète une partie de l’île Nou en 1845 au chef Kuindo, que les trafiquants anglais surnomment « Jack » ; c’est le chef le plus important du pays, héritier direct des grands-chefs Houassios.
Kuindo fut satisfait de son troc. Une ancienne légende raconte que les âmes des morts y séjournaient avant de se rendre à Tsiabiloun – paradis des canaques – retrouver le dieu Doïbat, et qu’il y a longtemps, longtemps, un combat fratricide avait eu lieu sur ce site ; alors la parole de Doïbat s’était fait entendre, proscrivant à tous l’accès de « Nu », avertissant que ceux qui violeraient l’interdit seraient chassés, atteints de maladies horribles, subiraient d’effroyables châtiments, perdraient la tête ou sombreraient dans la folie ; et cela jusqu’à ce que la parole revienne de Tsiabiloun, loin, loin, là-haut dans le ciel, signe que Doïbat aurait levé le tabou.
L’île dispose d’une aiguade, et c’est en partie la raison pour laquelle Paddon l’achète aux indigènes, comme il l’affirme dans une lettre à R. Towns du 18 avril 1854. James Paddon y implante un comptoir d’exploitation du santal, du trépan, de la nacre, de l’huile de coco, ainsi qu’un élevage. Peu à peu le comptoir Paddon se transforme en un véritable village avec des habitations, des entrepôts, une scierie, des ateliers de construction navale, des forges, des parcs à bestiaux, des fours à chaux, des boucheries… Paddon traite ensuite avec les Français lors de leur arrivée en 1854. En 1857 (ou 1858), l’administration des Domaine lui rachète (expropriation) sa propriété.
Deux des 4 canons de la batterie Desnouel se trouvent à l’entrée du camp.
Le camp de l’île Nou est bâti en amphithéâtre dans l’anse Paddon, qui dans la figure de l’île en marque le jarret et qui s’ouvre sur la grande rade. À droite et à gauche, deux montagnes aux sommets arrondis s’élèvent à une hauteur de deux cents mètres environ et surplombent les deux extrémités du camp.
Entre ces montagnes, se trouve un col d’où l’on domine à l’est, le camp, et la presqu’île Ducos, à l’ouest l’hôpital du Marais et la grande mer. En 1876 c’est un vaste établissement comprenant 2 casernes de gardes, les logements de surveillants, la prison, 17 grands bâtiments (dont 12 dortoirs et 5 cellules). De là partaient chaque matin les corvées désignées pour aller travailler en ville sur les chantiers ou chez les particuliers comme « garçon de famille ».
C’est sur ce plateau élevé, qui sépare l’Anse Paddon de l’Anse de l’hôpital, qu’est choisi l’emplacement de la petite chapelle, où l’on célébrait la messe il y a encore quelques années, érigée en 1880 sur caves ; les vérandas et les huisseries de cette robuste construction ont aujourd’hui disparu.
La campagne, très accidentée, mais sans montagnes très élevées, rappelle, sauf la différence de la végétation, les aspects de la Haute-Auvergne. Les hauteurs sont couvertes de niaoulis, arbres qui donnent le goménol. Plus bas, des cocotiers, des flamboyants, des goyaviers, des orangers, alternent avec des plantations de caféiers dont les fleurs blanches rappellent le jasmin, des champs de cotonniers et de cannes à sucre, des pâturages pour les bœufs et les chevaux, des villages enfin entourés de cultures vivrières où les légumes et fruits d’Europe voisinent avec les produits tropicaux et qui rappellent nos villages de France. Car ils ont été créés par la population libre qui s’est bien accrue par l’immigration depuis la suppression de la transportation en 1897.
Les terres de Nou produisent tous les végétaux de la Grande-Terre. Le climat en est parfaitement salubre, et les relations avec Nouméa sont toujours praticables par mer. De cette ville à l’anse Paddon, il y a quatre kilomètres, et cette distance est vite parcourue. Il faut remplir certaines formalités pour se rendre à Nou, et les défenses les plus expresses sont faites à tous les caboteurs d’aborder sur ce terrain, réservé à une œuvre particulière : la régénération des forçats par le travail. On sait que cette prétendue régénération du forçat par le travail n’a rien produit de satisfaisant ; toutefois, en l’honneur du principe, des expériences continuent : il y a en ce moment près de 300 forçats employés chez les colons, qui en obtiennent les meilleurs services, grâce aux précautions de toutes sortes prises.
En débarquant, le voyageur trouve à sa droite la batterie et le mât des signaux ; puis, d’un côté, les bâtiments du pénitencier proprement dit ; de l’autre, les ateliers de charpentage, de menuiserie, d’ébénisterie, de saboterie, de sculpture, de forge, les magasins pour le matériel et, les vivres, enfin les boulangeries. Au fond, derrière la chapelle qui fait face à l’aiguade, les logements des employés, le presbytère et l’hôpital. Derrière l’hôpital, à vingt minutes environ du débarcadère, les cultures et le jardin, qui mesure environ deux hectares. Tout auprès est le jardin anglais, le Pré-Catelan de la Nouvelle-Calédonie, disait l’ancien gouverneur dans son langage imagé et qui mérite quelque peu cette qualification, puisqu’il est ombragé par deux admirables figuiers banians, à l’immense envergure, que le bois de Boulogne peut envier. Les cultures comptent déjà un assez grand nombre de caféiers et de cotonniers en pleine récolte, et qui donnent la preuve qu’à Nou on peut encore obtenir d’importantes récoltes. Nou est très fertile, mais elle présente d’autres avantages. Ses terres sont toutes semblables à celles de la presqu’île Ducos. Elles sont composées de congloméras, de poudingues, de brèches et de calcaires au milieu desquels apparaissent assez souvent des soulèvements trachytiques. Les ressources géologiques de Nou ont été utilisées sous deux formes. La première comme extraction de pierres à bâtir. Une carrière a en effet été ouverte près du pénitencier, auquel elle est reliée par une route de service ; et le calcaire donne de la chaux excellente pour les mêmes constructions. Cette chaux, d’une cuisson aisée, a d’excellentes qualités hydrauliques, et la pierre est d’une extraction toujours facile. La même qualité de calcaire est fréquente dans le reste de la colonie.
Pénitencier
Sur ce point d’entrée dans la colonie qu’est Nouméa, les condamnés sont triés en fonction de leurs dossiers et leurs compétences et répartis sur l’ensemble du territoire dans des camps fixes ou mobiles, chez des particuliers ou encore dans des entreprises.
L’administration pénitentiaire est très puissante, autonome en 1875 elle devient une sorte d’État dans l’État. Elle gère de nombreux établissements pénitenciers ; Île Nou, Ducos, Dumbéa, Île des Pins, Ouégoa, Téremba, etc.
Les « Transportés » (selon la loi du 30 mai 1854 sur les bagnes coloniaux) de loin les plus nombreux, aussi appelés « forçats » car condamnés à des peines de travaux forcés (de 8 ans à perpétuité) pour des crimes de droit commun (allant de la simple voie de fait, attentat à la pudeur ou au meurtre), sont pour la plupart placés au pénitencier de l’île Nou et servent à l’édification des routes et bâtiments de la colonie, en premier lieu la construction du pénitencier-dépôt de l’île, juste en face du chef-lieu rebaptisé Nouméa, la Nouvelle-Calédonie devenant un théâtre d’expérimentation de la théorie sociale du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, Charles Guillain, plus saint-simonien que fouriériste qui veut réhabiliter le bagnard par le travail et lui donner une seconde vie après sa peine en lui offrant des concessions de terre.
Les 250 premiers « ouvriers de la Transportation » arrivent à Port-de-France le 9 mai 1864 à bord de L’Iphigénie. Après avoir été occupés à la construction du pénitencier de l’île Nou, les condamnés de l’Iphigénie participent à l’ouverture de la ferme modèle de Yahoué
et à la fondation du centre agricole de Bourail.
Entre 1864 et 1897, 75 convois amènent environ 21 630 immatriculés au bagne. Parmi les descendants de Transportés on peut citer les Bouteille, Bouteiller, Chatenay, Colomina, Delathière, Gervolino, Komornicki, Lafleur, Lucas, Mariotti, Pagès, Papon, Péré et Robelin.
Bourail, est le centre-type de la colonisation pénale. Le Bourail-ville, le Bourail-campagne offrent cette particularité, que je crois unique, d’être exclusivement peuplés de criminels. Citadins et suburbains, commerçants et cultivateurs, sont des bagnards en activité ou honoraires. C’est là qu’on fait, dans de bonnes conditions, l’essai loyal, sur certains condamnés, de l’influence familiale et de la liberté surveillée.
L’objectif de colonisation pénale est « officiellement » de peupler la colonie de la Nouvelle-Calédonie et de “régénérer” les condamnés. La loi de 1854 fait aux transportés condamnés à des peines de plus de 8 ans, interdiction absolue de retourner en Métropole à l’expiration de leur peine ; les condamnés à moins de 8 ans sont soumis au “doublage” qui est une obligation de résidence de même durée que leur peine. La Métropole peut ainsi se débarrasser définitivement de ses délinquants et criminels condamnés au bagne.
En réalité, le bagne a pour objectif premier de débarrasser le sol métropolitain de ses indésirables. Il traduit la férocité répressive du XIXe siècle.
Les “transportés” sont des délinquants et criminels et la justice de cette époque balaie large devant sa porte (vols 51%, meurtres ou tentatives 29%, mœurs 9%, incendies ruraux 5%, escroqueries et fraudes 4%).
Les “relégués” envoyés à partir de 1886 sont des petits délinquants récidivistes. La loi de 1885 institue leur déportation sans retour à la fin de leur peine. Leur présence sur le territoire métropolitain gêne la rigueur morale de la IIIe République des notables. Les relégués sont surtout issus du prolétariat citadin (ouvriers pauvres, petits métiers, mendiants, clochards) et dans une moindre mesure, paysan (journaliers).

Ceux qui sont dirigés vers l’île Nou, comme Mano, logent dans de grands dortoirs appelés « cases-dortoirs ».
Ils travaillent dans les ateliers (seront seulement construits à partir de 1878) le fer ou le bois ou dans des bureaux pour ceux qui savent lire et écrire. D’autres s’occupent du ravitaillement en eau et en bois, ou encore déchargent les marchandises arrivés par le quai de la grue. Certains s’activent à la boulangerie pour produire le pain, aliment de base des condamnés.
L’encadrement est effectué par un personnel pénitentiaire important, jusqu’à 660 personnes, secondé par la police indigène. L’encadrement – des surveillants militaires – logent dans la caserne qui surplombe le camp. Les femmes et enfants des surveillants sont présents sur le site. Une école est mise en place pour l’instruction de leurs enfants. Le dimanche, la chapelle du pénitencier célèbre, en plus de l’office habituel, les mariages, les naissances, les baptêmes et les communions.
Le bagne se transforme, de fait, en entreprise sous-traitante de main-d’œuvre aux administrations (chantiers publics), puis aux sociétés privées (SLN, etc.). La recette de la location (après une phase de prêt) est affectée au budget général, dont le tiers est perçu par le Trésor Public, en cas de bénéfices.
En 1925, seule, l’ile de Nou, qui a reçu jusqu’à 11 000 condamnés, rappelle l’ancien bagne dont les grandes constructions sont devenues un hospice abritant encore les derniers jours d’une centaine de vieux forçats.
Il y a maintenant dans les villages des familles très nombreuses comptant jusqu’à 10 et 15 enfants.
Le camp central est fermé en 1927 après le transfert des derniers condamnés vers le Camp Est. Les bâtiments du camp sont réaffectés et servent de logements pour des fonctionnaires. L’objectif est d’effacer les traces de cette période du bagne devenue honteuse : en 1928, l’île Nou prend le nom de « Nouville » ; en 1939, les dortoirs et le quartier cellulaire sont délibérément détruits.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, le site devient une base américaine. Après-guerre, les bâtiments sont affectés à différentes institutions de formation ou à vocation culturelle.
Depuis 1973, les principaux bâtiments du bagne sont classés comme monuments présentant un intérêt historique. Aujourd’hui, le visiteur peut apprécier l’architecture typique du bagne au travers de nombreux bâtiments : l’hôtel du commandant, le château d’eau, la chapelle, le presbytère, le logement du surveillant principal, la caserne des surveillants mariés, les ateliers du bagne, la boulangerie, le débarcadère, les anciens quais.
Le site historique peut se découvrir en autonomie grâce aux panneaux informatifs du parcours « Itinéraires du bagne » mis en place par la Province sud ou au cours de visites guidées ou de manifestations organisées par l’association Témoignage d’un Passé, partenaire du CREIPAC. En 2020, un centre d’interprétation dévolue au bagne en Nouvelle-Calédonie est ouvert au public dans l’ancienne boulangerie
En 1866, le gouverneur Guillain crée les “assignés”, condamnés distingués par leur bonne conduite et qui sont autorisés à travailler chez les particuliers. À partir de 1869, l’administration institue des concessionnaires pénaux auxquels elle attribue des terrains de 4 à 5 hectares qu’ils doivent mettre en valeur pour en obtenir à terme la pleine jouissance. Ils doivent ainsi se réhabiliter par le travail, l’objectif étant de créer, vallée après vallée, des colonies de paysans. C’est là le grand dessein du gouverneur Guillain. Les concessions sont attribuées à l’origine aux meilleurs sujets à la fin de leur peine ; très gourmande en terres, la pénitentiaire se délimite une réserve qui atteindra 110 000 hectares : celle-ci ne fut que très partiellement utilisée mais elle contribua gravement aux spoliations des mélanésiens, origine des insurrections de 1878 et 1917 et des revendications foncières du mouvement indépendantiste kanak. Un peu plus de 60% de la population de transportés a été libérée ; à partir 1878, l’accès aux concessions est étendu aux condamnés en cours de peine. Très peu de libérés ont accès aux concessions, l’administration leur préférant des hommes en cours de peine qu’elle peut plus facilement contrôler.
Dans leur immense majorité, les libérés sont donc “jetés sur les chemins de la colonie avec (…) pour seule perspective la recherche désespérée d’un moyen de subsistance” (Isabelle Merle). La loi de 1854 et les décrets qui suivirent, ont hypocritement occulté le problème des libérés. Ils sont déclarés indésirables à Nouméa et dans les centres de brousse. Sans argent, sans terre pour les nourrir, ils vivent une existence misérable et nomade, errant sur les routes à la recherche d’un travail chez les colons ou les mineurs. Ils sont souvent contraints aux larcins. Ils font des petits métiers mais l’administration moralisatrice leur en proscrit certains (cabaretiers, brocanteurs). Beaucoup s’adonnent à l’éthylisme. Ces hommes restent entre eux, mais que peuvent-ils faire d’autre ? Ils sont craints de la population qui néanmoins profite aussi de cette main d’œuvre et parfois l’exploite. On tente de leur interdire l’accès aux tribus où ils contribuent à l’alcoolisme des hommes et des femmes. On cherche, sans résultat, à limiter administrativement leurs déplacements. On les accuse de tous les maux. Tout concoure à les marginaliser, les nomadiser et à ne pas leur offrir la moindre de chance de se réhabiliter.
À partir de 1882, sous l’impulsion du gouverneur Pallu de la Barrière qui veut vider le bagne, le rythme d’octroi des concessions augmente tellement que les colons libres, exaspérés, obtiennent à partir de 1886 une plus grande rigueur. Il s’en suit une décrue.
En 1897, à la fin de la transportation au bagne, il y avait 1 700 colons pénaux en Nouvelle-Calédonie. En rapprochant ce chiffre des 22 000 condamnés envoyés en Nouvelle-Calédonie on mesure l’échec de la colonisation pénale.
L’île garde encore aujourd’hui une fonction pénitentiaire, même si elle n’a plus rien à voir avec le bagne, à travers le Centre du Camp-Est, lui-même installé dans d’anciens bâtiments datant de la transportation et dont le caractère vétuste, le sur engorgement, les qualités d’hygiène et les évasions à répétition est régulièrement pointé du doigt par le personnel pénitentiaire, des associations de défense des droits des détenus voire des instances nationales ou internationales de veille des conditions de détention.
Le service pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie a été transféré à l’État par la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 relative à la Nouvelle-Calédonie, compétence que l’État a conservée depuis. Cette mesure, à contre-courant de l’évolution statutaire de ce territoire, répond à la volonté de mener une politique judiciaire globale, en intégrant l’administration pénitentiaire aux compétences qui reviennent à l’État en matière de droit pénal et de procédure pénale.
Le centre pénitentiaire de Nouméa, d’une capacité globale de 208 places, regroupe l’ensemble des régimes de détention.
file:///C:/Users/rapha/Downloads/lecaledolien0111.pdf
http://les-chapeaux-de-paille.over-blog.com/article-3107927.html
https://books.openedition.org/sdo/576?lang=fr
https://www.croixdusud.info/hist/nou_sit.php
https://www.bernard-guinard.com/arcticles%20divers/Convois%20de%20deportes/Var/le_Var.html
https://gnc.jimdofree.com/biographies/bridon-e/
https://archive.org/stream/p2revuebleuepoli47pari/p2revuebleuepoli47pari_djvu.txt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bagne_de_Nouvelle-Cal%C3%A9donie#Les_colons_p%C3%A9naux
http://next.owlapps.net/owlapps_apps/articles?search=paris,tiktok
https://www.noumea.nc/sites/default/files/150_ans_de_memoire_collective_caledonienne_catalogue_complet.pdf
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4778706s/f3.item.r=mano%22ile%20de%20nou%22.zoom#
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k122084g/f18.item.r=bagne%22%C3%AEle%20de%20Nou%22#
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3339898d/f6.item.r=bagne%20de%20l’%C3%AEle%20de%20Nou.zoom
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5448376q/f391.image.r=bagne%22%C3%AEle%20de%20Nou%22?rk=300430;4#
https://excerpts.numilog.com/books/9782402232609.pdf
https://www.creipac.nc/le-site-historique/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bagne_de_Nouvelle-Cal%C3%A9donie#Les_colons_p%C3%A9naux
http://next.owlapps.net/owlapps_apps/articles?search=paris,tiktok
https://www.noumea.nc/sites/default/files/150_ans_de_memoire_collective_caledonienne_catalogue_complet.pdf
Lire « Nouméa », Georges Bastian, Les Cahiers d’Outre-Mer, Année 1951.
https://www.persee.fr/doc/caoum_0373-5834_1951_num_4_16_1761
L’esprit de famille !
La transportation pour les condamnés qui nous occupe en ce moment, devient dès cette époque une transformation bien plus qu’une modification de leur peine. La chaîne, l’accouplement, le costume, qui sont, pour ainsi dire, les insignes de l’infamie du régime habituel, ne subsistent que comme un moyen d’intimidation et de discipline.
Si le pouvoir de contenir et de punir la révolte n’est pas affaibli, à côté de lui vient prendre place un pouvoir nouveau, celui d’arracher au mal, de retirer de l’abîme les hommes de bonne volonté, de séparer le scélérat qui brave la loi du malheureux qui la subit. La société métropolitaine, purgée d’éléments dangereux et menaçants, le repentir du coupable encouragé et récompensé, tels sont les effets qui sont déjà sortis de la transportation, telles sont les réformes qu’elle porte avec elle.
La vie en commun dans les prisons favorise les mauvaises passions et détruit les bons instincts ; d’un autre côté, l’isolement effraie les esprits faibles et paralyse les bonnes résolutions.
Entre les deux dangers de la communauté et de l’isolement, le salut est, pour lui, dans la famille. C’est à la fois une aide, un soutien, un encouragement, une consolation. Une famille qui l’entoure, une terre qui lui promet la récompense de ses efforts, peuvent lui faire oublier la patrie perdue. L’homme n’est pas fait pour vivre seul, surtout l’homme qui travaille à la terre. Cette vérité est comprise dès le premier jour par le gouvernement.
Le principe de réhabilitation par la famille est écrit dans la loi, et l’administration le pratique plus que jamais par une politique de transportation de femmes qui manquent car la colonie en a peu qui puissent accepter de se marier avec des libérés.
Guillain réclame la venue de familles libres de transportés tout en envisageant avec réticence l’envoi d’épouses ou de femmes elles-mêmes condamnées. Dans un rapport du 1er août 1865, il développe ses vues en matière de « colonisation pénitentiaire » et expose les principes d’un système de concessions sur la côte Ouest de l’île, puis il écrit que « Dès l’entrée en exécution de ce système, on ferait venir les familles de condamnés auxquelles il serait appliqué, et l’on pourvoirait les célibataires soit par des introductions de femmes condamnées, soit en encourageant les alliances avec des femmes indigènes qui, plus capables de fécondité et beaucoup moins viciées que la plus part des précédentes, offriraient certainement à leurs conjoints de meilleures conditions pour un amendement de plus en plus sérieux. »
Il faut néanmoins citer la famille Ève, transporté de l’Iphigénie, dont l’épouse et le fils arrivent à Nouméa, par la Sibylle le 27 mai 1870, avec six autres membres de sa famille. Gaultier de la Richerie se plaint de la famille Ève « qui est arrivée en Nouvelle-Calédonie avec le nommé Baptiste leur gendre, son frère et deux enfants plus l’oncle du nommé Baptiste. Le condamné Ève, concessionnaire, est un excellent travailleur mais sa femme et la femme Baptiste se livrent à la prostitution. »
À cela s’ajoutent les lenteurs administratives devenues proverbiales : il arrive souvent que, lorsque le condamné, après avoir subi un long temps d’épreuve, est en mesure de recevoir sa femme, celle-ci a trouvé d’autres occupations et a renoncé à s’expatrier. « Il n’est pas rare de voir les demandes couronnées de succès au bout de quatre ou cinq ans ! Souvent les requérantes, leurs premières démarches étant restées infructueuses, disparaissent ou changent de projets. La faim les a poussées à quelque liaison irrégulière, et elles s’y tiennent. »
Le gouvernement favorise l’émigration des femmes qui subissent des peines diverses dans les prisons centrales et qui en font la demande pour aller contracter mariage avec les forçats ou les libérés ; l’autorité pénitentiaire fait le tour des prisons centrales métropolitaines pour susciter des volontariats. Dès le principe, il y eut de l’hésitation chez ces dernières, certains rapports parvenus, on ne sait comment, jusque dans les prisons, avaient, en exagérant quelques accidents inévitables, semé cette hésitation, qui a aujourd’hui entièrement disparu, grâce aux mesures prises dans la colonie pour procurer une bonne hygiène aux femmes transportées pour hâter la conclusion des mariages – l’amour est dans le pré – et assurer aux ménages nouveaux une active protection.
Aujourd’hui, la plus grande confiance a changé la disposition des esprits, car les femmes réclusionnaires, et même celles qui ne sont condamnées qu’à l’emprisonnement, sollicitent la transportation comme une faveur ; le sentiment de leur avenir perdu les pousse sans doute à quitter un pays où la misère les attend au sortir de la prison.
Le premier convoi de transportation de femmes condamnées débarque de l’Isis le 23 janvier 1870. Parmi les 25 condamnées arrivées en même temps que Mano en janvier 1874, par le 24e convoi, la dénommée Sauron décèdera au mois d’avril suivant.
Beaucoup sont célibataires et condamnées à des travaux forcés pour infanticides puis, en nombre insuffisant (192 de 1870 à 1887), des femmes condamnées à la réclusion (80) ou à de la prison pour simples délits (250).
Le ministère donne pour instructions de confier les femmes aux Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, au couvent de Bourail, « en attendant qu’on puisse les marier » avec un libéré titulaire de terre ou un condamné ; leurs rencontres sont organisées dans le célèbre kiosque vert du « couvent », sous l’œil vigilant des religieuses !

Le regroupement des familles est largement préféré à l’envoi de célibataires condamnées, pourtant ces dernières sont bien plus nombreuses que les épouses ayant rejoint un mari transporté. Confronté à la durée du pénitencier calédonien, il faut constater que la préférence donnée au regroupement familial a bien du mal à s’appliquer et qu’elle est même contredite par la pratique, une pratique que seul le directeur de la Pénitentiaire, Armand de La Loyère, ose justifier en affirmant que « La femme et les enfants venus de France auront presque toujours… une éducation à refaire et de vieilles habitudes à vaincre. Voilà pourquoi, tout en reconnaissant la nécessité de faciliter largement l’exode de familles de condamnés, j’ai beaucoup plus confiance dans les mariages conclus à l’aide du kioske octogone que dans la réunion d’époux séparés depuis de longues années. »
Le « Petit Journal » du 18 juin 1873 raconte que le gouvernement favorise en ce moment un grand courant d’émigration de familles des condamnés transportés à l’île de Nouméa et qui appartiennent aux catégories suivantes condamnés aux travaux forcés à perpétuité ou à temps réclusionnaires coloniaux de race asiatique ou africaine, repris de justice en rupture de ban, affiliés à des sociétés secrètes.
Le 10 août 1873, Louise Michel embarque sur le Virginie qui l’emmène en Nouvelle-Calédonie pour une traversée longue de 4 mois. Un de ses compagnons de route est le célèbre Henri Rochefort, déporté comme elle pour leur implication dans la Commune de Paris. Entre le 10 décembre 1873 et le 11 juillet 1880, Louise Michel purge sa peine, d’abord à la presqu’île Ducos, dans le camp de Numbo, une enceinte fortifiée pour les prisonniers politiques qui, comme elle, ont été les instigateurs de la Commune de Paris. Louise, comme les dix-sept femmes qui l’accompagnent, doit en réalité purger sa peine sur l’île de Bourail, plus accueillante et confortable que Ducos, mais par solidarité avec les autres prisonniers masculins, elle demande pour elle et ses compagnes d’être traitées comme les hommes. S’illustrant par une force de caractère bien trempé, les gardes finissent par lui donner raison. Elle est ensuite transférée à la baie de l’Ouest, pour finir à Nouméa où elle vit libre.

Dans cet exil forcé long de sept ans, Louise Michel se comporte une fois encore d’une façon « originale ». Comme ethnologue d’abord. Seule contre la majorité de ses co-détenus et de l’administration pénitentiaire, elle sympathise avec les autochtones et recueille leurs chansons, leurs langues et leurs coutumes. Ce travail se traduit par la publication en 1885 à son retour en France de « Légendes et chansons de gestes canaques » : avec dessins et vocabulaires en collaboration avec Charles Malato, jeune déporté de 17 ans arrivé au bagne avec ses parents. Elle est également l’une des rares personnalités européennes à prendre la défense des Kanaks lors des révoltes de 1878, perçus le plus souvent comme une population de sauvages incontrôlables (Le Gaulois, 30 septembre 1878). Son idéal révolutionnaire ne supporte pas la souffrance de ce peuple auquel on subtilise sa terre et ses droits ancestraux. Ensuite comme botaniste. Passionnée par le vivant, Louise Michel élève et recueille toute sorte d’animaux tout en ne se lassant pas de décrire et de dessiner une nature luxuriante. Puis comme institutrice, l’éducation étant, selon elle, le seul moyen d’armer les populations pour combattre toute forme d’asservissement.
Le 16 octobre 1879, elle refuse une remise de peine par solidarité pour ses compagnons aussi déportés. Il faut que cette « amnistie soit totale ou [elle] ne sera pas ». Le 11 juillet 1880, une amnistie générale pour tous « les individus condamnés pour avoir pris part aux évènements insurrectionnels de 1870-1871 » est signée. Louise Michel rentre triomphalement à Paris le 9 novembre 1880 (La Justice, 11 novembre 1880) où une foule de vingt-mille personnes l’attend à la Gare St-Lazare ! Ironie du sort pour celle qui fût si souvent critiquée pendant la Commune de Paris : voici qu’on la nomme « Louise la bien-aimée » (Le Figaro, 10 novembre 1880). Mais Louise, peu soucieuse de ce triomphe, s’empresse d’aller voir sa mère souffrante…
déportés. Il faut que cette « amnistie soit totale ou [elle] ne sera pas ». Le 11 juillet 1880, une amnistie générale pour tous « les individus condamnés pour avoir pris part aux évènements insurrectionnels de 1870-1871 » est signée. Louise Michel rentre triomphalement à Paris le 9 novembre 1880 (La Justice, 11 novembre 1880) où une foule de vingt-mille personnes l’attend à la Gare St-Lazare ! Ironie du sort pour celle qui fût si souvent critiquée pendant la Commune de Paris : voici qu’on la nomme « Louise la bien-aimée » (Le Figaro, 10 novembre 1880). Mais Louise, peu soucieuse de ce triomphe, s’empresse d’aller voir sa mère souffrante…
Et Mano, dans tout cela ? L’avenir nous le dira… peut-être !
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bagne_de_Nouvelle-Cal%C3%A9donie
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k591862r/f2.item.r=mano.zoom
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5918668/f3.image.r=mano
Femmes déportées au bagne de Nouvelle-Calédonie :
https://www.geneanet.org/cartes-postales/search/?go=1&page=4&size=20&sourcename=trigalleau
Lire « L’Archipel des forçats », Louis-José Barbançon, 2003 ; retrace l’histoire de la Transportation sur cette terre kanake devenue terre de bagne, de répression et de réhabilitation pour ces femmes et ces hommes de rien dont l’auteur est lui-même originaire :
https://books.openedition.org/septentrion/54826?lang=fr
Voir http://www.christianlegac.com/2019/10/genealogie-ils-sont-partis-de-france-pour-la-nouvelle-caledonie.html
Plan de Bourail :
http://www.mairie-bourail.nc/attachments/article/115/plan_musee.pdf
En attendant Godot !
Mano coule des jours paisibles au bagne de l’île de Nou.
Il a pour surveillant Oscar Gustave « Charles » Anatole Hernu, né le 28 janvier 1855 à Saint-Pol-sur-Ternoise, dans le Pas-de-Calais. Charles a opté pour la carrière militaire : en 1873, il s’est engagé dans l’artillerie et y reste pendant une dizaine d’années, traversant parfois de bien mauvaises passes : en 1875, il est dégradé et, de brigadier, redevient soldat de deuxième classe pour « mauvaise conduite persistante ». En 1878, il semble s’assagir. En effet, on le retrouve commis ouvrier, une fonction qui implique de bonnes connaissances et un réel savoir-faire sur le plan technique. Nommé surveillant militaire aux établissements pénitentiaires de la Nouvelle-Calédonie, il embarque le 8 février 1881 à Rochefort, à bord du Tage qui rejoint la colonie le 25 mai 1881.
L’année 1885, pour Charles Hernu, est celle du changement : le 7 février, il démissionne de l’armée ; le 28 février, à l’île Nou, il épouse Virginie Marie Tessier, celle que tout le monde ici appelle Eugénie ; elle est originaire de Campbon, un petit village de la Loire-Atlantique où elle est née en 1857.
Le père d’Eugénie, Jean-Marie Tessier 1831-1884, a été condamné à Vannes le 17 mars 1860 pour avoir commis la nuit un vol en réunion sur un chemin public … Bénéficiant de circonstances atténuantes, il est condamné à la peine de travaux forcés pour 10 ans ; son pouvoir en cassation est rejeté le 19 avril 1860. Par décision du 11 novembre 1865, Sa Majesté l’Empereur daigne lui faire une remise de peine de 2 ans à l’occasion du dévouement dont il a fait preuve pendant l’épidémie de choléra qui a sévi à Toulon et ses environs. Détaché de la chaine le 20 janvier 1866, il embarque pour la Nouvelle Calédonie sur la frégate La Sibylle, partie le même jour. Cultivateur à Bourail, il y décède le 16 novembre 1884. Son épouse, Julienne Marie Hervoche avec leur fils Pierre, et leurs deux filles Marie et Eugénie, arrivent à Nouméa le 21 juillet 1867 à bord de l’Iphigénie et partent pour Bourail sur la goélette La Pourvoyeuse le 17 aout 1867. Julienne décède à Bourail le 18 mai 1879.
C’est au pénitencier de l’île Nou que Charles fait la connaissance d’Eugénie. Elle y approvisionne alors la cantine du bagne, parallèlement à d’autres affaires. Elle est veuve d’un premier mari, Albert Blum, et mère de six enfants qu’elle élève à la baguette… Elle donne d’ailleurs l’exemple : debout dès quatre heures du matin, elle selle son cheval après avoir mis tout son petit monde au travail. Charles s’installe à Bourail et, avec Eugénie, ils y ouvrent un commerce, situé là où l’on trouve aujourd’hui « Les Délices des Îles » (un magasin tenu par Lison Guillemard que tout le monde, à Bourail, appelle Nononne) ; ils y vendent un peu de tout : de la quincaillerie, de la mercerie, de la lingerie… et ils ont même une boulangerie
 la mort de Charles, il n’a que 34 ans, Eugénie part en Australie. La raison de ce départ précipité surprend ! Deux jours après le décès de Charles, Eugénie a un rendez-vous avec le Gouverneur : elle est enceinte jusqu’aux dents et craint une réaction de sa belle-famille ; ces bourgeois du Pas-de-Calais ignorent que leur fils, l’unique descendant, a épousé la fille d’un bagnard, mère de six enfants. Fort de ses relations et de ses compétences notariales, le père de Charles pourrait fort bien essayer de récupérer l’enfant à naître, a fortiori s’il s’agit d’un fils. Le Gouverneur Noël Pardon comprend la situation. Eugénie part accoucher en Australie où elle se trouve à l’abri de toute poursuite tandis qu’un acte de décès est transmis à la mairie de Saint-Pol-sur-Ternoise, selon lequel Charles, à sa mort, est célibataire et n’a plus, pour biens, que ses hardes. À son retour en Calédonie, Eugénie reprend ses affaires. Le 7 janvier 1891, à Bourail, elle épouse un ancien gendarme, Louis Blanchard : le commerce s’appelle alors « Magasin Blanchard » ; les contacts qu’Eugénie a conservé en Australie se révèlent utiles ; ses différents commerces vont bon train. On dit qu’elle possède tout Bourail ou presque : le 3 mars 1903, elle fait même l’acquisition de la mine de nickel, la mine Medona. Trois semaines plus tard, le 27 mars, Eugénie meurt des suites d’un accident de cheval (comme son second mari Charles Hernu). (Extrait de la Généalogie Robert Zoller)
Je regrette d’être maintenant obligé de venir révéler certains faits qui vont vous paraître monstrueux, mais je crois de mon devoir de le faire. Il faut qu’on sache qu’aujourd’hui, dans notre siècle, on voit encore appliquer, très légalement je le reconnais, des peines horribles, et qui sont d’un autre âge.
La première de ces peines, celle qui est le plus fréquemment appliquée, c’est la peine de la correction. Cette peine s’applique chaque semaine ; fréquemment, vous le voyez, contrairement à ce que laisserait penser la déposition de l’honorable M. Michaux, sous-directeur des colonies, faite devant la commission d’enquête parlementaire sur le régime des établissements pénitentiaires ; voici ce qu’il dit le 14 juin 1872 : « On applique rarement la bastonnade qui, dans les climats chauds, est très dangereuse, à cause des plaies qu’elle peut produire. » Cette peine est, en effet, très dangereuse et elle est plus que dangereuse, elle est dégradante pour la dignité humaine.
La peine de la correction, messieurs (et mesdames), consiste à attacher un homme, ployé en deux, sur un banc de bois ; puis (mesdames, fermez les yeux) on abaisse le pantalon, on relève la chemise, et on frappe vingt-cinq coups, avec une corde d’un centimètre et demi de diamètre, une espèce de garcette et si on ne frappe que vingt-cinq coups, c’est que le patient ne peut en supporter davantage.
À l’île Nou, cette peine que M. Michaux dit n’être que rarement utilisée, est appliquée à huit ou dix individus, chaque mardi à dix heures du matin.
M. Le Prévost, ex-médecin de la marine, demeurant à Paris, 18, rue de l’Arrivée, certifie que : « Ayant été détaché pendant quatre mois (janvier, février, mars et avril 1874) au service médical du pénitencier de l’ile Nou et chargé successivement de la visite journalière à l’infirmerie du camp pendant un mois environ, à l’hôpital du Marais* pendant les autres trois mois, j’ai vu la « correction » ou « bastonnade » administrée à un certain nombre de condamnés, régulièrement, à jour fixe (le mardi de chaque semaine, à dix heures du matin).
* Les bagnards l’avaient surnommé le Paradou ! Car l’Hôpital du Marais était un “paradis” comparé à l’enfer du quotidien du bagne sur l’Ile Nou. Devenu Centre Hospitalier Spécialisé de Nouville, ce lieu et ces bâtiments ont survécu à la terrible épopée pénitentiaire.
Je certifie, en outre que, à chaque séance, le condamné reçoit vingt-cinq coups de corde, appliqués de telle sorte que chaque coup déchire la peau, fait jaillir le sang, traverse le tissu cellulaire sous-cutané, et souvent attaque la couche musculaire superficielle ; Qu’un même condamné peut avoir jusqu’à cent coups de corde à recevoir, et que, après chaque bastonnade de vingt-cinq coups, il est réintégré dans une cellule puante, mal aérée ; Qu’il y est soumis à un régime débilitant (500 grammes de pain par jour, et, une ration de bouillon trois fois par semaine seulement) ; Que, sous l’influence de ce régime et de ce milieu, les tissus déchirés, mâchés, pour ainsi dire, par les torons du fouet du correcteur, sont impuissants à reproduire les bourgeons charnus de la cicatrisation ; Que les plaies deviennent et restent sanieuses (En médecine, qui contient de la sanie, matière fétide et sanguinolente qui s’écoule des plaies et des ulcères non soignés.) ; Qu’elles s’éternisent, à moins que ne survienne une complication (scorbut ou dysenterie) qui mette fin à ce déplorable état de choses, ou qui permette au moins au médecin de réclamer d’urgence, pour son malade en cellule, les vivres d’hôpital. »
Il y a encore la peine de la double chaîne qui consiste dans l’accouplement de deux condamnés, peine suffisamment odieuse, attendu qu’elle met les hommes dans une promiscuité que nous ne pouvons admettre.
Il y a aussi la peine des poucettes, petit instrument en forme de U ; dans la rainure des deux branches glisse une tige transversale accrochée à une tige médiane qui passe dans la courbure de l’U ; au bas se trouvent une vis et un écrou. On place les pouces dans les branches de l’U, et l’on serre l’écrou. M. Josson, ancien commis de marine de première classe, qui est alors en Calédonie, déclare dans une lettre que voici : « En 1868, vers la fin de l’année, un vol fut commis chez le surveillant Blandin ; deux forçats furent accusés, les nommés Sibut et Jouanni. Au cours de l’instruction les poucettes leur furent appliquées ; cette exécution eut lieu dans la chambre servant à l’interrogatoire en présence du nommé Lauzanne, surveillant en chef. Des poucettes furent mêmes construites dans les ateliers à fer du pénitencier sous la direction du garde d’artillerie Lescut, d’après un modèle présenté par ledit surveillant Lauzanne. Voici la façon dont on procède : on interroge l’accusé, et, si ses réponses ne satisfont pas, l’on serre d’un cran. »
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6575588z/f346.image.r=bagne%22%C3%AEle%20de%20Nou%22?rk=193134;0#
Fonctionnement à haute fréquence de la « Veuve »
Les exécutions capitales au bagne sont si rares, grâce à la clémence bien connue de M. Grévy, surnommé le « Papa la grâce », qu’elles prennent l’importance d’un véritable événement quand il faut y recourir.
Les exécutions capitales, sauf en ce qui concerne le dénouement, ne s’accomplissent pas de la même façon à l’île Nou qu’en France. À part quelques fonctionnaires privilégiés, elles n’ont ici pour spectateurs que des condamnés. L’exécution a lieu dans un camp retranché : au milieu du vaste espace qui s’étend au-dessous des bâtiments de la 3e classe, celle des incorrigibles, l’échafaud est dressé, allongeant ses bras dans la nuit. En face, et regardant les condamnés de la 5e classe, au nombre de 550, massés en rangs serrés, attendent l’heure fatale sans un murmure. On eût dit autant de victimes pour le supplice. De l’autre côté de l’échafaud, 80 hommes d’infanterie de marine sont alignés, l’arme au pied, sous les ordres d’un lieutenant.
À droite et à gauche de la guillotine, et formant les deux petits côtés du rectangle, deux pelotons de dix surveillants militaires, sous les ordres d’un surveillant chef ; tout autour de l’instrument de supplice, des surveillants, l’arme au poing, et des Canaques de la police indigène armés jusqu’aux dents de casse-têtes et de sagaies ; enfin, près de la porte du camp, un obusier de campagne chargé à mitraille, la gueule tournée vers les condamnés. Pendant qu’on procède à ces lugubres préparatifs, le commandant accompagné de l’aumônier, le père David, vient annoncer à Veschi et à Mosca, les deux condamnés, la fatale nouvelle.
La guillotine qui vient d’être déballée ne semble pas très récente. Guillain, dans un courrier du 22 avril 1867, notait même : « L’instrument a été monté et essayé hier, la lenteur avec laquelle le couteau tombe et la manière irrégulière dont il glisse donne des craintes sur le résultat de l’opération […] »
Veschi est un Corse condamné en 1870 à vingt ans de travaux forcés, par la Cour de Bastia, pour homicide volontaire au moyen de deux coups d’arme à feu. Le 6 novembre 1877, le 1er conseil de guerre permanent de la Nouvelle-Calédonie le condamne de nouveau à vingt ans pour attentat à la pudeur. Enfin le 29 décembre dernier, le 2e conseil prononce contre lui la peine de mort pour assassinat et tentative d’assassinat. Il a tué son engagiste, à la Dumbéa, deux de ses codétenus et a blessé le troisième. Ces détails suffisent…
Luigi Mosca n’a pas d’antécédents beaucoup meilleurs. Il n’a que 26 ans, et déjà récidiviste de l’assassinat ! D’origine italienne, il est condamné le 28 mai 1884 aux travaux forcés à perpétuité pour double meurtre. Arrivé en Calédonie en 1885, il continue la série de ses hauts faits ; au mois de décembre de la même année, il est condamné à la peine de mort pour tentative de vol et meurtre sur la personne d’un concessionnaire, condamné arabe de Bourail. On voit que son séjour sur les rivages océaniens est écourté.
En attendant le rejet de leur pourvoi, les deux condamnés ont des attitudes très différentes. Autant Mosca se montre abattu, impressionné, autant Veschi conserve son calme habituel ; il continue même à mâchonner un bout de tabac.
Au moment où ils arrivent au pied de l’échafaud, la voix d’un surveillant chef retentit au milieu du silence : « Condamnés, à genoux ! » Et les condamnés de la 1ère classe se prosternent avec un grand bruit de chaînes, la tête découverte, la face pâlie par la terreur. Pas un de ces misérables n’ose regarder la mort en face.
Les greffiers lisent la sentence aux condamnés ; cela dure bien dix longues minutes, dix siècles ; les condamnés d’ailleurs ne paraissent pas entendre ; leur énergie diminue au milieu de ces lenteurs.
Mosca, qui a jusque-là refusé les secours de la religion, plutôt par abattement que par conviction, donne un dernier baiser au crucifix, et embrasse plusieurs fois le P. David ; il semble qu’il veuille retarder le dénouement. Enfin, l’exécuteur le saisit. Le misérable demande à dire quelques mots ; des sons inarticulés sortent de sa bouche. Un roulement de tambour couvre ses bégaiements, la planche bascule, l’exécuteur fixe le cou dans la lunette, un bruit sourd retentit, et la tête, détachée du tronc, roule dans le panier.
Veschi, pendant le supplice de son camarade, a conservé tout son sang-froid. Il dit un mot au Père David, l’embrasse, puis, s’avançant au pied de la guillotine, il prononce d’une voix haute et ferme les paroles suivantes : « Messieurs, j’ai pêché et je vous demande pardon de toutes les fautes que j’ai commises. Je mérite mon châtiment. Et vous, condamnés, que mon supplice vous serve d’exemple : en avant ! » Et il marche de lui-même à l’échafaud, encore inondé du sang de Mosca. Quelques secondes après, la justice des hommes est satisfaite. Dans le panier, la tête de Veschi grimace encore ; sa bouche s’ouvre et se referme automatiquement : il mâchonne toujours sa chique !
Charles Gramont, 25 ans, tonnelier, transporté n°9798-15278, condamné le 29 décembre 1883 par le 2e Conseil de guerre de la Guadeloupe pour destruction de biens de l’armée et vol d’armes et d’un bateau à huit ans de travaux forcés. Puis, tentative d’assassinat d’un autre détenu, Rouyer, qu’il frappe de deux coups de couteau pour se venger d’une punition dont il l’estime responsable, est exécuté le 29 mai 1889 à 6h15 : Il regarde les trois cents condamnés réunis, puis la guillotine, impassible, et embrasse sans conviction le crucifix tendu par le père David. Il demande et obtient du directeur le droit de s’adresser aux co-détenus : “Camarades, je vais mourir, ne me plaignez pas, j’ai mérité mon châtiment. D’ailleurs, je ne regrette pas de m’en aller, car mes souffrances sont terminées, tandis que vous n’êtes pas au bout des vôtres. Mais laissez-moi, avant de monter sur l’échafaud, vous donner un conseil, ne vous laissez jamais mener par les autres, ne faites jamais rien à l’instigation de vos camarades, ne subissez pas les excitations auxquelles on veut vous pousser. Moi-même, je paie aujourd’hui pour d’autres, que je ne veux pas nommer, et qui m’ont poussé au crime. Quand un co-détenu vous y invitera, répondez-lui : fais, agis toi-même, cela ne me regarde pas. Camarades, adieu une dernière fois, je pardonne à tous ceux qui m’ont fait du mal…” Gramont embrasse l’aumônier, et dit : “Il faut beaucoup de courage, mais j’en ai. Allons !” Sur la bascule, il regarde Macé et s’écrie : “Dépêchez-vous !” Commentaire de l’exécuteur en essuyant le couperet : “À qui le tour ?”
À partir de 1882, le bourreau Macé, alias « Monsieur Nou », une des personnalités du bagne, expédie une centaine de ses compagnons, avant de mourir lui-même dans un lit à l’hôpital ; il touche, pour ses bons offices, une boîte de sardines, seize francs et il a droit au reste du café préparé pour son “client”.
Charles, Jean-Louis Macé, dit Monsieur de Nou est condamné aux travaux forcés à perpétuité en 1871, pour le meurtre de sa femme. Très bien noté par l’administration, sa peine est réduite à vingt ans de travaux forcés, deux ans seulement après sa condamnation.
Le journaliste Jacques Dhur (Félix Le Heno), fait publier en 1925 le récit d’un séjour qu’il a effectué bien avant la guerre de 14-18, en Nouvelle-Calédonie, et ayant pour sujet le monde du bagne. Au cours de son séjour il rencontre l’exécuteur : c’est en sortant de déjeuner que, visitant l’île, on me présenta au bourreau du bagne, — Monsieur de Nou. Il habite une proprette petite maison, entourée de champs qu’il cultive, vivotant du maigre revenu de ces terres qui lui ont été octroyées en matière de salaire. Dans le cottage isolé qu’il occupe au milieu des champs de l’île Nou, Macé cultive la concession qu’on lui a octroyé et se déclare heureux ; mais il y a des jours où il ne se tient pas de joie : ce sont ceux qui précèdent une exécution capitale. Lorsque la chose traîne en longueur, il va quotidiennement s’informer si c’est pour le lendemain. À la chute de M. Grévy, il eut un soupir de soulagement — « J’espère, dit-il au commandant, que le nouveau Président de la République ne va pas imiter ce père-la-grâce ! » Depuis cette époque, le chef de l’état, pour éviter d’interminables lenteurs, s’est dessaisi du droit de grâce vis-à-vis des condamnés à mort dans les deux bagnes d’outre-mer. C’est le gouverneur qui l’exerce, assisté du Conseil privé de la colonie. Les choses vont ainsi plus vite, et les exécutions sont un peu plus fréquentes. Pas assez fréquentes, cependant, aux yeux de Macé, qui touche dix francs, deux bouteilles de vin et une boîte de sardines pour chaque vacation.
M. de Nou, quand il opère, est en redingote noire. Dans sa propriété, il porte un simple costume de toile bise, fort ressemblant à celui qu’il portait quand il purgeait sa peine.
— « J’ai soixante-six ans, me dit-il. Voyez, j’ai perdu l’index de la main droite dans le dernier cyclone. Il me fut coupé net par un morceau de tôle enlevé d’un toit. La main droite, c’était la bonne… J’ai eu peur. Néanmoins, elle reste sûre, et je vous jure qu’elle ne tremble pas. On parle de M. Deibler, on dit qu’il lui arrive de gâcher de l’ouvrage : à moi, jamais ! Quand il voudra, je ferai un match avec lui. Du reste, ma machine fonctionne divinement. »
C’est un vieux forçat libéré, du nom de Macé (mort en 1905). Un poivrot, sorte de brute à la lèvre baveuse et aux yeux éteints, les cheveux et la barbe sale, en désordre, et à qui un effroyable nez, un pif vineux et bourgeonnant dessinant un énorme crochet sur sa face cuite, fait une trogne bouffie de polichinelle de cauchemar, aux enluminures de sang.
Si nous devions le décrire plus avant, nous dirions que « sa peau, ou plutôt son parchemin, est d’un rouge de sang, caillé sur places, — telles des taches sèches sur d’autres qui ont séché. Ses yeux, souvent rendus vagues par ses habitudes d’ivrognerie, lancent quand il a toute sa raison des couleurs de l’éclair de l’acier de sa guillotine. Il ne lui manque que la cagoule rouge pour représenter, dans un mélodrame du moyen-âge, sans avoir besoin de se grimer, le coupe-teste idéal. »
Macé commence sa fonction de bourreau en 1877, succédant à Petit (suicidé) et à Ambarreck (assassiné), jusqu’en 1904, année où il est réhabilité judiciairement ; de son propre aveu, il a accepté de devenir bourreau pour pouvoir satisfaire ses instincts de tueur, sans danger pour sa personne, sans démêlés avec la justice. Malgré une libération en 1890, il continue sa charge d’« exécuteur des hautes-œuvres », devenu le bourreau le plus sinistre et le plus terrible de l’histoire du bagne calédonien. Il est crédité de 73 exécutions avec « sa fille ».
Naturellement, c’est lui-même qui a sollicité le poste de bourreau lorsqu’il est devenu vacant. Du reste, Macé a de qui tenir dans sa famille, et l’on va voir que celle-ci ne s’est point mésalliée. Mlle Macé, sa sœur, condamnée pour meurtre aux travaux forcés, se maria en Nouvelle-Calédonie avec un régénéré concessionnaire qui, à l’occasion d’un coup de canif dans le contrat, débarrassa l’épouse infidèle, du doigt porteur de l’alliance, ensuite de la tête.
Échoué au bagne pour assassinats, Macé trouve dans l’exercice de son nouveau métier la satisfaction de ses sanguinaires instincts de tuerie.
C’est un artiste amoureux de son art. Il en parle avec des expressions tendres qui mettent comme des lumières bleues dans les ténèbres de l’argot. Il éprouve, déclare-t-il, « un plaisir de prince » à « trancher les cabèches », ricane-t-il, et une flamme mauvaise allume son regard.
Celui-là, certes, a la vocation. On sent en lui la férocité d’un tigre. Et il peut s’en donner à cœur joie de faire couler le sang, sans avoir à redouter, désormais, les foudres de la justice. Il tue maintenant avec la loi pour lui.
— Comme ça…on peut « travailler » tranquille…faire de la belle ouvrage…
Et il rit, la lèvre relevé d’un pli féroce et gai.
Un tic étrange, pourtant, fait que, quand il marche, tous les trois pas, brusquement, il tourne la tête et regarde, anxieux, derrière lui, comme s’il craignait un coup de couteau. C’est que les bagnards ne l’ont pas précisément « à la bonne », comme il dit lui-même. Mais il est sur d’œil, et d’attaque !…
— « Les salauds… ils peuvent venir ! » les défie-t-il, d’un accent qui donne comme une morsure aux mots.
Et puis, il y a les bénéficiaires accessoires, tel que le « pâté du diable » que demande toujours le condamné et qu’il finit, lui, le bourreau fin gourmet…
— C’est la « mouise », gémit-il.
Et comme je le regarde, tout crasseux, dépenaillé, dans son vieux costume à vieux carreaux, passé de couleur, souillé, troué par places, il devine ma pensée.
— « Oh! non… monsieur… non… quand je « travaille » c’est pas avec ça… avec ces sales frusques… »
En deux enjambées rapides, Macé va à une armoire qu’il ouvre toute large. Et le voici, une redingote, un gilet, un pantalon noir, en mains… Précautionneusement, il les déploie devant moi. Puis : — « Regardez… Deibler n’a pas mieux ! » s’enorgueillit-il…
Sa seule distraction est de monter et de démonter sa guillotine que, sans se lasser, il astique, il fourbit, et qu’il veut coquette et belle, comme une femme aimée… Son plus grand bonheur était naguère, lorsqu’il exécutait un condamné, d’avoir autour de lui des personnages de marque.
Aujourd’hui, il en est réduit pour faire admirer sa maitrise à dresser ses bois de justice et à guillotiner… « une botte de paille » ; il y a quelque temps, à un archiduc autrichien, il donne cette représentation. Et comme ce haut personnage le complimente, modeste, il avoue : — « Non, ce n’est plus ça… je me rouille, Altesse. »
Visions de bagne, Jacques Dhur, 1925, Paris.
https://guillotine.1fr1.net/t429-mace-l-executeur-de-l-ile-nou-et-sa-veuve
Eugène “Varin” Pivet, 32 ans, sans profession, transporté n°15529, condamné le 21 juin 1884 par la cour d’assises de la Manche pour assassinat et vol commis à Gonneville le 28 décembre 1883 aux travaux forcés à perpétuité. Ivre de vernis de menuiserie, tente d’assassiner son co-détenu Emile Abadie, avec lequel il s’était querellé l’avant-veille, d’un coup de poinçon entre les omoplates.
Antoine Boiron, 38 ans, cordonnier, transporté n°504-6525, condamné le 26 janvier 1874 par la cour d’assises de la Drôme pour voies de fait sur un gardien de prison à quinze ans de travaux forcés. Evadé onze fois, condamné à dix reprises par le conseil de guerre de Nouméa durant son séjour pour évasions, vols et recel, cumulant au total une peine à purger de 275 années supplémentaires de travaux forcés ! Tente d’assassiner un Kanak, Bevaya, qui l’avait reconnu comme bagnard évadé et s’apprêtait à le livrer aux gendarmes.
Sont tous les deux exécutés le 18 avril 1890 à 5h50 & 5h51. Au réveil, Pivet s’exclame : “Ah ! Enfin ! Ce n’est pas trop tôt !” puis dit au commandant du pénitencier : “On n’a pas le temps de s’embêter ici ! C’est pire qu’à la foire au pain d’épices, à chaque courrier, il y a des nouvelles maintenant.” Accepte l’aumônier en ces termes : “Ma foi, je suis si mal avec les hommes qu’il faut que je me mette bien avec les autres.”
Boiron, atteint de surdité, se réveille uniquement quand le commandant rentre dans sa cellule et s’il n’entend pas ce qu’on lui, il comprend tout de même et répond : “Oui, je m’en doutais.”
Après la confession, Pivet réclame une tasse de café au lait pour soigner “sa bronchite”, puis commente, en mangeant du poulet et des confitures : “Voilà une cuisse que Macé n’aura pas. Et cette aile non plus ! Tu ne manges pas, Boiron ?” “Ca ne passe pas très bien.” “Mange, tout de même ! Il ne faut rien laisser pour ce cochon d’exécuteur !” La dernière bouchée avalée, Pivet dit : “Voilà un petit déjeuner que je recommencerais bien demain matin. Allons, mon vieux Boiron, les voyageurs pour le train de Saint-Cloud, en voiture !” Devant la guillotine, demande à parler : “Mes amis, j’ai appris dernièrement qu’on voulait donner des suites à mon exécution. N’en faites rien et restez tranquilles. Qu’il ne soit plus question de rien. Au moment de ma mort, je pardonne. De votre côté, oubliez ! Adieu, camarades, et bon courage !” Il se place lui-même sur la bascule.
Boiron ne fit, en quittant la salle où ils s’étaient restaurés, qu’une seule demande : “Qu’on m’expédie au plus vite.”
Arthur Louis Joseph Thaise, 40 ans, journalier, transporté n°8527-14128, condamné le 4 août 1882 par la cour d’assises du Nord pour vols qualifiés à huit ans de travaux forcés. Condamné par le Tribunal maritime spécial de Nouméa à 30 ans cumulés de travaux forcés pour évasions et vols. Auteur d’une série de vols, arrêté à Dumbéa en possession d’une arme à feu, le 21 novembre 1901 à Koé, il s’évade lors de son transfert en prison en poignardant mortellement le garde Canaque Saoulo qui l’escorte jusqu’à la gendarmerie. Il est rattrapé très rapidement. Est exécuté le 26 février 1902 : au réveil, à 4h35, il refuse les secours de la religion, dit avoir faim, mange de bon appétit des sardines, du poulet froid, qu’il arrose de vin et de rhum. Pendant qu’on le toilette, il s’adresse au bourreau Macé et lui dit : “C’est pas parce que ton boulot, c’est de couper des têtes, que tu ne peux pas trinquer avec moi !” Macé accepte l’invitation. Devant la machine, Thaise avoue son crime, mais réfute la préméditation. Après que sa tête soit tombée, Macé saisit la tête et lui demande s’il l’entend. Deux ou trois crispations de mâchoire sont remarquées. Première exécution avec la guillotine Berger livrée quelques semaines plus tôt.
Le 6 décembre 1905, suite à la mort du bourreau Macé, Rieusset, son successeur trop nerveux, fait une boucherie de l’exécution de Khenatra Miloud ould Ali bou Guedraune : libérant le couteau trop tôt, il décapite le condamné au niveau du front. En essayant de hisser le mouton, la corde lâche et il faut se munir de l’échelle pour fixer un câble à la corde, remonter le couteau et finalement la décapitation soit effective.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4723459z/f1.item.r=bagne%22%C3%AEle%20de%20Nou%22.zoom
https://laveuveguillotine.pagesperso-orange.fr/PalmaresPacifique.html
La Foa
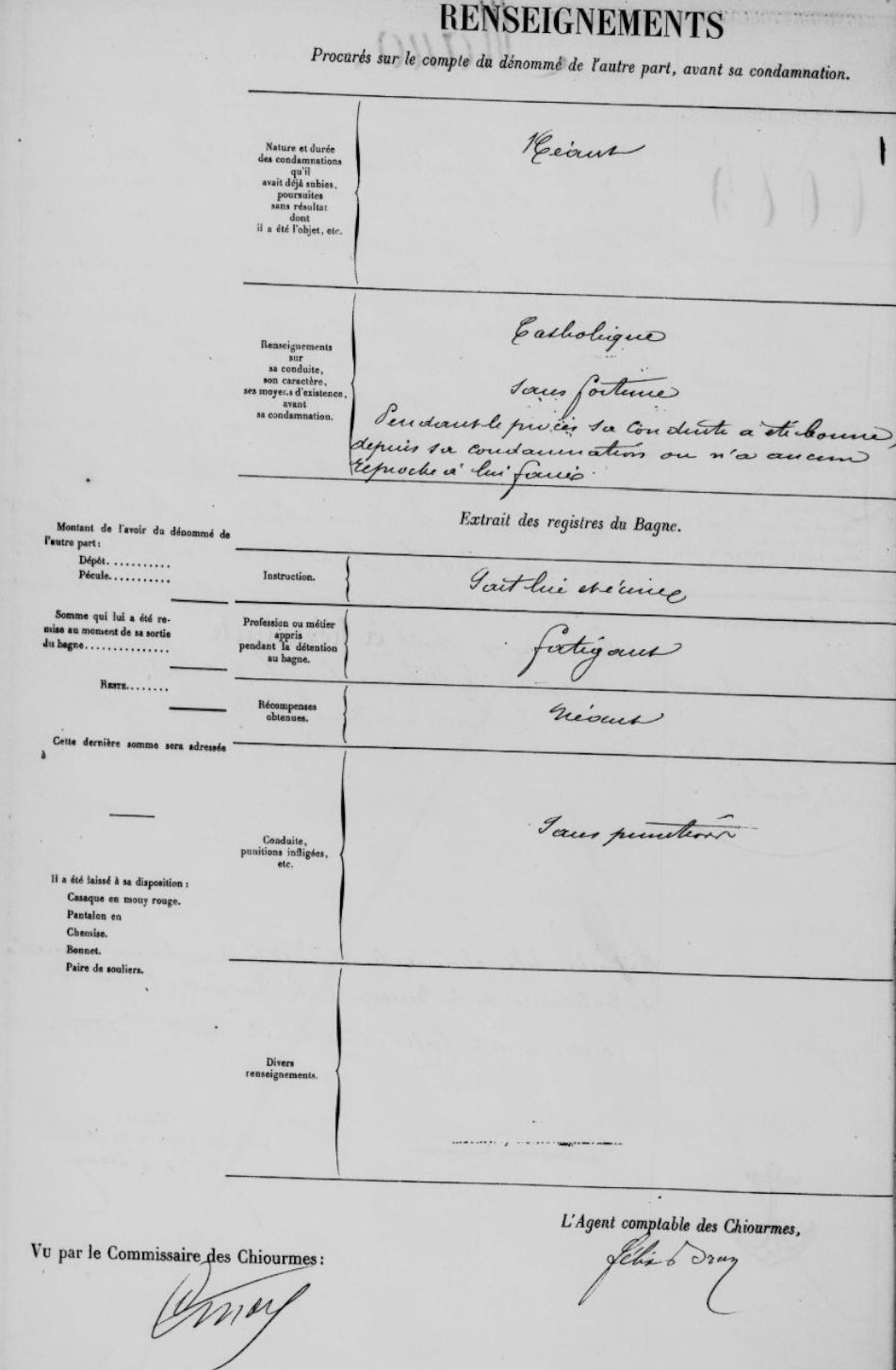
Catholique. Sans fortune. Pendant le procès sa conduite a été bonne ; depuis sa condamnation, on n’a aucun reproche à lui faire. Sait lire et écrire. Métier fatigant appris pendant sa détention. Sans punition.
Un recours est rejeté le 9 septembre 1887. Proposé pour une commutation en 20 ans le 9 septembre 1889, celle-ci est acceptée.
L’administration, la “Tentiaire” comme on l’appelle ici, lui accorde une concession à la Foa le 6 mai 1896. Après quelques semaines occupées aux travaux d’intérêt général, Johannès commence à défricher sa concession. À l’issue de vingt mois d’installation, il doit avoir construit sa case selon les plans définis par l’administration. Pendant cette période, il reçoit une ration de vivres, des indemnités d’installation, un trousseau de vêtements, des outils aratoires, et les soins hospitaliers sont gratuits.
 Officiellement dénommée « Uaraï », la contrée fait partie de l’aire coutumière Xaracuu. Elle est explorée, sur ordre du gouverneur Gaultier de la Richerie, au début de l’année 1871. Après Bourail, le gouvernement veut faire de cette région le deuxième pôle de colonisation pénale de Nouvelle-Calédonie. Un poste militaire est établi à Téremba, bientôt doublé d’un pénitencier agricole à l’exemple de Bourail, mais par deux dépêches ministérielles des 19 novembre et 27 décembre 1872 le département fait savoir que la colonie doit se tenir prête à recevoir des convois nombreux et réguliers d’émigrants, des alsaciens-lorrains principalement. Le pénitencier sera transformé en internat de jeunes filles en 1892. Face à l’aridité des lieux, le mouvement de colonisation s’orientera vers le sud-ouest, en direction des riches vallées alluvionnaires des rivières Fonwhary et La Foa. Dès 1873, un pénitencier agricole est implanté dans la petite vallée de Fo Gacheu, située à quelques kilomètres au sud de Téremba. Les premiers concessionnaires pénaux sont installés à partir de 1875 sur les rives de la rivière Fonwhary. À cette date, on commence à construire un pénitencier agricole à La Foa avec, dans les vallées environnantes (Méaré, Pierrat, Thia, Nily), la délimitation de sections de concessions pénales. La section La Foa urbain (l’actuel village) est également délimitée à cette date.
Officiellement dénommée « Uaraï », la contrée fait partie de l’aire coutumière Xaracuu. Elle est explorée, sur ordre du gouverneur Gaultier de la Richerie, au début de l’année 1871. Après Bourail, le gouvernement veut faire de cette région le deuxième pôle de colonisation pénale de Nouvelle-Calédonie. Un poste militaire est établi à Téremba, bientôt doublé d’un pénitencier agricole à l’exemple de Bourail, mais par deux dépêches ministérielles des 19 novembre et 27 décembre 1872 le département fait savoir que la colonie doit se tenir prête à recevoir des convois nombreux et réguliers d’émigrants, des alsaciens-lorrains principalement. Le pénitencier sera transformé en internat de jeunes filles en 1892. Face à l’aridité des lieux, le mouvement de colonisation s’orientera vers le sud-ouest, en direction des riches vallées alluvionnaires des rivières Fonwhary et La Foa. Dès 1873, un pénitencier agricole est implanté dans la petite vallée de Fo Gacheu, située à quelques kilomètres au sud de Téremba. Les premiers concessionnaires pénaux sont installés à partir de 1875 sur les rives de la rivière Fonwhary. À cette date, on commence à construire un pénitencier agricole à La Foa avec, dans les vallées environnantes (Méaré, Pierrat, Thia, Nily), la délimitation de sections de concessions pénales. La section La Foa urbain (l’actuel village) est également délimitée à cette date.
Particularité de la région : le gouvernement veut y créer le premier pôle de « colonisation mixte » de la colonie en favorisant l’installation de colons libres aux côtés de concessionnaires pénaux : à partir de 1895, sous l’impulsion du gouverneur Feillet, plusieurs familles de colons libres s’installent dans la région pour planter du café. Ces colons développent des activités économiques assez conséquentes, investissent la commission municipale. Malgré la présence dans la colonie de plusieurs centaines de libérés du bagne, ces colons Feillet se heurtent à un important manque de main-d’œuvre.
Nous avions annoncé, d’après plusieurs journaux du Midi, la mort de Jean dit “Johannes” Mano, l’ancien facteur du Barp, qui fut condamné à la peine capitale comme coupable d’un quintuple assassinat, puis, après appel, aux travaux forcés à perpétuité.
Mano avait, disait-on, avoué tous ses crimes avant de mourir.
Oh, mères, écoutez-moi
Ne laissez jamais vos garçons
Seuls la nuit traîner dans les rues
Ils iront tout droit en prison
[…]
Et les portes du pénitencier
Bientôt vont se fermer
Et c’est là que je finirai ma vie
Comme d’autres gars l’ont finie
Johannes” Mano décède à l’île Nou le 30 septembre 1902.
À la fin du XIXe siècle, l’administration avait décidé « de fermer le robinet d’eau sale ». Un dernier convoi de bagnards débarque à l’île Nou en 1897, les mises en concession de condamnés font l’objet d’une législation plus restrictive et, en 1908, les pénitenciers de La Foa, Bourail, Pouembout et Diahot sont supprimés pour être transférés à l’administration générale de la colonisation libre.
Cependant, l’impact de la colonisation pénale en Nouvelle-Calédonie a été considérable. Les transportés ont constitué jusqu’au début du XXe siècle l’essentiel du peuplement européen dans l’île.
La transportation a « contribué à accumuler le capital primitif des sociétés minières qui dominent la Grande Terre après 1880 » en prêtant ses détenus aux grandes compagnies minières.
Des centaines de bagnards font ainsi l’objet de tractations commerciales entre l’administration et des entrepreneurs privés, en toute légalité. Des convois de deux cents à trois cents hommes sont échangés contre des domaines fonciers et cédés pour une durée de dix à douze ans.
http://www.lafoa.nc/presentation-de-la-foa/presentationdelafoa_lhistoiredelacommune/
https://www.noumea.nc/sites/default/files/150_ans_de_memoire_collective_caledonienne_catalogue_complet.pdf
http://www.clocherobecourt.com/Robecourt/NC/Images/LaFoa/LaFoa%20Hangar%20Quai%201863-1.jpg
https://laveuveguillotine.pagesperso-orange.fr/PalmaresPacifique.html
« Les chiens ne font pas des chats ! »
Le 16 janvier 1889, le tribunal correctionnel Bordeaux juge le jeune Mano, dont nous avons annoncé l’arrestation. Le fils du sinistre facteur du Barp, âgé de vingt-deux ans seulement, a déjà subi sept condamnations pour des délits divers. Il n a à répondre cette fois que d’un délit de grivèlerie.
Le tribunal bienveillant lui octroie un mois de prison. Mano est en passe, on le voit, d’acquérir un casier judiciaire qui sera un nouvel argument pour ceux qui croient à l’hérédité criminelle.
La Lanterne : journal politique quotidien du 20 janvier 1889
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7513062x/f3.item.r=barp.zoom#
Quoique, un Mano en cache un autre !
Le jeune Mano, demeurant à la Dune Pontac, a trouvé sur la voie publique une montre en argent. Il s’est empressé de la rapporter chez ses parents qui la tiennent à la disposition de son propriétaire. Nous ne saurions trop louer cet acte de probité.
L’Avenir d’Arcachon du 12 juin 1881.
M. le Maire lit une lettre de M. le Préfet transmettant une demande formulée par le sieur Mano, habitant de la commune, et adressée au Ministre de la Guerre, pour l’obtention d’une bourse avec trousseau, en faveur de son fils, candidat à l’École Polytechnique en 1881.
M. le Préfet désire connaitre l’avis du Conseil à ce sujet.
Le Conseil : Considérant que le jeune Mano, déjà boursier au lycée de Bordeaux, n’a jamais cessé de justifier par son travail soutenu, la faveur dont il jouit ; Considérant la position feu fortunée de son père qui a la charge d’une très nombreuse famille ; le Conseil appuie de tout son pouvoir la demande du sieur Mano, ancien sous-officier des douanes en retraite.
L’Avenir d’Arcachon du 7 juillet 1881.
Complainte de Mano
Air de Fualdès
Les complaintes sont utilisées pour couvrir principalement des affaires juridiques : de nombreux assassinats, affaires financières, politiques, etc. et l’affaire Fualdès est tellement tonitruante, marque tant les esprits que le “tube” devient un “super méga tube”.
L’Air de Fualdès est l’air de toutes les complaintes, il est utilisé pour en accompagner des dizaines et des dizaines. L’air est connu de tous et le support est redoutablement efficace pour colporter l’information dans ses moindres détails.
A écouter sur http://oceno.canalblog.com/archives/2019/11/15/37759164.html
Habitants de la Gironde,
Habitants du Barp aussi,
Venez promptement ici ;
Accourez vite à la ronde.
Je vais raconter à tous
Le massacre de Tastous :
Autour d’une humble chaumière,
Dans le canton de Belin,
L’an passé, de bon matin,
On trouva couchés par terre :
Arnaud Mano, sa moitié,
Manorine à leur côté.
Mon Dieu, quel coup d’œil horrible !
On voyait des morts partout.
Hélas ! ce n’était pas tout ;
Car on vit — chose terrible ! —
Mortes dedans leur berceau,
Les demoiselles Mano.
Oh! quel crime abominable !
Quel était donc l’assassin,
Qui, ne craignant pas le chien,
—Qu’on dit n’être pas aimable —
Dans la ferme avait, sans bruit,
Pu pénétrer dans la nuit ?
On soupçonnait une bande
De sinistres gitanos,
Portant, depuis Biganos
Leur misère en contrebande ;
Mais on a bien su depuis
Combien étaient faux ces bruits.
Mano — beau-père — et, son gendre
S’expliquaient souvent, dit-on ;
Johannès, dans sa maison,
N’était pas d’humeur trop tendre.
C’était un événement
Quand il donnait de l’argent.
Il était joueur, ivrogne,
Mangeait ses appointements.
Dans les établissements
Passait les nuits, sans vergogne.
Chez lui revenant en train,
Il faisait toujours du train.
Enfin, quand sa pauvre femme,
Dans sa désolation,
Pleine d’irritation,
L’appelait : « Sans cœur, infâme ! »
Johannès la menaçait,
Souvent même il la frappait.
Il faisait partout des dettes,
Semblable aux gens comme il faut.
Ce détestable défaut
Fait faire maintes boulettes,
Le chanteur de ce couplet
Sait fort bien ce qu’il en est.
Mais ce qui pour la justice
L’a rudement compromis,
C’est qu’il disait aux amis,
Dans ses accès de malice :
« Mes gens m’embêtent beaucoup ;
Je vais les régler d’un coup ! »
De façon que son langage
Fut connu par le Parquet :
En raison de son caquet,
Mano fut conduit en cage.
Mais il a toujours nié
Qu’il avait assassiné.
Pendant onze mois de suite,
Le juge d’instruction,
Plein de bonne intention,
Reçut l’aimable visite
De ce nouveau Dumollard,
Qui rentrait toujours trop tard!
Aussi muet qu’une taupe,
Mano se tient toujours coi ;
Il ne comprend pas pourquoi
On l’accuse d’être escarpe ;
Car il soutient qu’un joueur
Doit souvent avoir du cœur.
Arrive enfin l’audience
Où le facteur comparait,
Aucun témoin ne parait
Digne de sa confiance ;
Et dans ses calmes fureurs
Il les traite de menteurs.
Un garçon mélancolique
Vient déclarer à son tour,
Que chez son maitre, un beau jour,
Et dessous une barrique,
Il reconnut à l’odeur
Les chaussettes du facteur.
Ignorant la politesse,
Qui pourtant jamais ne nuit,
Mano, qui n’est pas instruit,
Avec sang-froid se redresse,
Puis il dit au président :
Ça m’étonne b…igrement ! »
Voilà que sur sa culotte
Les témoins ont déposé !…
Le public, indisposé,
De tous les côtés chuchote :
« Voilà Mano le félon
Blousé par son pantalon. »
Mais lui, sans gêne et sans honte,
Demande son pantalon
Bleu, pour voir s’il est trop long,
— C’est Odetti qui le conte —
II veut montrer à la cour
Qu’au contraire il est trop court.
On parle de ses conquêtes
Sur le sexe féminin :
Avez-vous vu sa mine, hein ?
— Ces rimes sont-elles bêtes! —
Et pour charmer de beaux yeux,
On pourrait trouver bien mieux.
Mais, hélas! l’amour, aveugle,
Ne connaît pas le dessin,
Et, malgré son noir dessein,
Mano, dont la passion beugle,
A pu trouver un accent
Pour charmer un cœur sur cent.
Le petit Bernardin jase ;
Il vient conter des horreurs !
Il ne commet pas d’erreurs ;
On frémit à chaque phrase :
Ah! si Bernardin est cru,
Cuit sera le prévenu.
Je ne puis sur chaque charge
Faire un développement.
Je finis donc promptement,
Craignant de manquer de marge :
Jean Mano fut condamné
À vivre à perpétuité.
Tous ceux que la guillotine
A sans pitié raccourcis,
Sont par cet arrêt saisis :
Jaques Latour se mutine ;
J’entends dire à Troppmann « Oh !
L’on ménage trop Mano ! »
Aussitôt, la Providence
À Troppmann donna raison,
Lors, Mano dans sa prison
Se pourvoit, criant : « Vengeance !
Je suis honnête ou vaurien ;
Je demande tout ou rien! »
La cour du Lot-et-Garonne
De par la cassation
A dit son opinion ;
Mano, ta cause est peu bonne
On te condamne à la mort…
Ah! mon Dieu quel triste sort !
MORALE.
À l’homme au cœur malhonnête,
Qui joue et boit sans raison,
Je vais dire sans façon :
« Toi, qui as le vice en tête,
Avant d’entrer en courroux
Tâte ta tête à Tastous !… »
https://complaintes.criminocorpus.org/media/img/2019/03/19/CC0903.jpg
autres complaintes
https://complaintes.criminocorpus.org/media/img/2019/04/12/CC1035.jpg
https://complaintes.criminocorpus.org/media/img/2019/04/12/CC1033.jpg
Complainte de Fualdès
Pour l’écouter, cliquer sur https://www.youtube.com/watch?v=3Pek1m9Y8KY
En 1817, c’est l’assassinat du magistrat Fualdès à Rodez et le très grand retentissement de cette affaire qui servent de facteurs déclenchant. Deux complaintes sont composées à cette occasion. L’une devient rapidement emblématique : elle se compose de quarante-huit strophes. La tripartition du scénario est encore apparente, mais dans un nouvel équilibre cependant. Une très large place est donnée en effet à la narration des faits, ou du moins à ce que l’on croit en savoir. La rumeur est ici constamment sollicitée, ainsi que toutes sortes d’archétypes et d’imaginaires qui, en définitive, permettent de cerner le type de société auquel elle s’adresse, société qui s’unifie en quelque sorte au travers de la répulsion que provoque cet acte criminel.
L’anecdote est alors devenue « exemplaire », selon l’expression de Michel-Louis Rouquette, « par tout ce qu’elle condense et permet de dévoiler ».
C’est Bastide, le gigantesque, l’Hercule, le géant épouvantable et impassible qui endosse déjà l’habit du monstre froid, avant même d’être un criminel.
C’est Jausion l’insidieux, l’avaricieux, le sanguinaire, prêt à égorger le pauvre Fualdès sur une table de cuisine : monstre lui aussi, mais d’une autre nature.
C’est la femme Bancal la tigresse, qui – inversion particulièrement sordide –, reçoit le sang de Fualdès dans un baquet pour nourrir son cochon.
Ce sont les joueurs de vielle qui, par le jeu assourdissant de leur instrument, étouffent les cris du supplicié et deviennent, à dessein semble-t-il, complices de ce tableau criminel. Curieuse mise en abyme, inversée elle aussi, de la fonction du vielleux, l’habituel chanteur des complaintes.
C’est Fualdès l’ami, le confident, le très prudent, le vieillard à l’air aimable, victime innocente suppliant qu’on le laisse mourir en paix avec Dieu : demande refusée par Bastide.
Ce sont des lieux également : l’infâme repaire de la maison Bancal, lieu de bacchanale et de prostitution, l’asile du crime.
C’est enfin l’impénitence de deux condamnés (sur trois), et donc la vision d’horreur d’un châtiment éternel, sans rémission possible.
Même s’ils ont pu confier peut-être à Desaugiers, Berryer et Catalan le soin de composer cette complainte, « l’aimable président » du tribunal, représentant de la clémence royale ou le « digne confesseur » constituent autant de commanditaires possibles de cette tragédie mise en musique.
L’horreur qu’elle inspire rassemble dans une même indignation femmes et hommes de tous milieux. Dans de telles circonstances en effet, ainsi que le remarque Frédéric Chauvaud : « Le pouvoir trouve là une occasion privilégiée de renforcer l’idéologie qui le sert et dont il s’inspire : nier les disparités sociales et les oppositions politiques, réaffirmer l’universalité de la nature humaine, le primat de la morale et l’éternel combat du bien et du mal. »
Cette complainte semble à bien des égards inaugurer une ère nouvelle qui, parallèlement au succès du canard et au développement du journalisme, délaisse la confession au profit du compte-rendu d’audience et de la rumeur. Il s’en faut de beaucoup qu’elle ait vocation à être lue par le plus grand nombre. Pour quatre-vingt pour cent de la population française, elle ne peut qu’être écoutée, souvent regardée et parfois mémorisée pour partie.
Chanteurs de rue et complaintes judiciaires. Quelques remarques à propos des complaintes françaises, Joseph Le Floc’h, Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », Hors-série, 2001
https://journals.openedition.org/rhei/421?file=1
















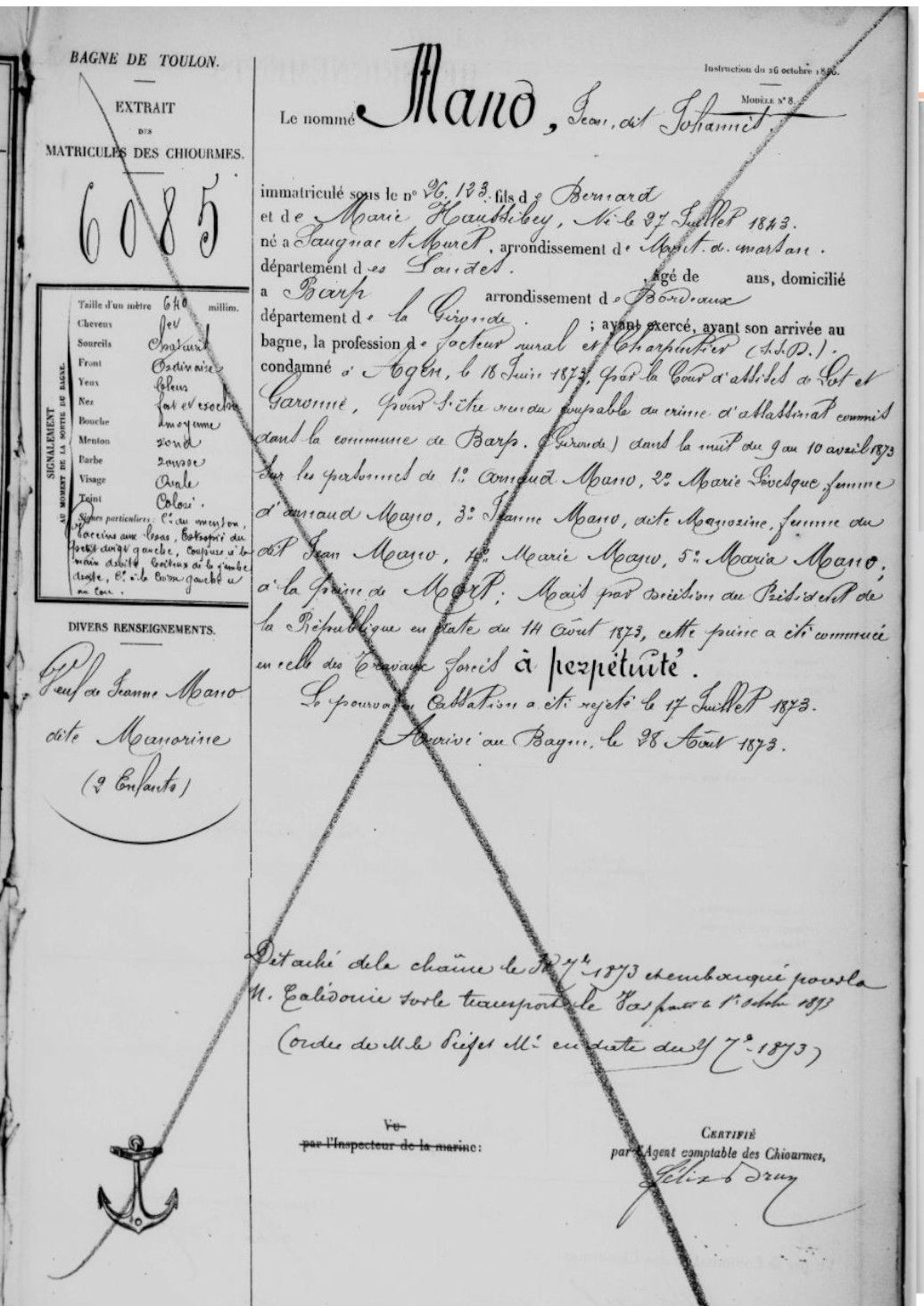


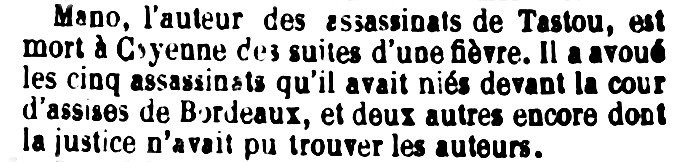
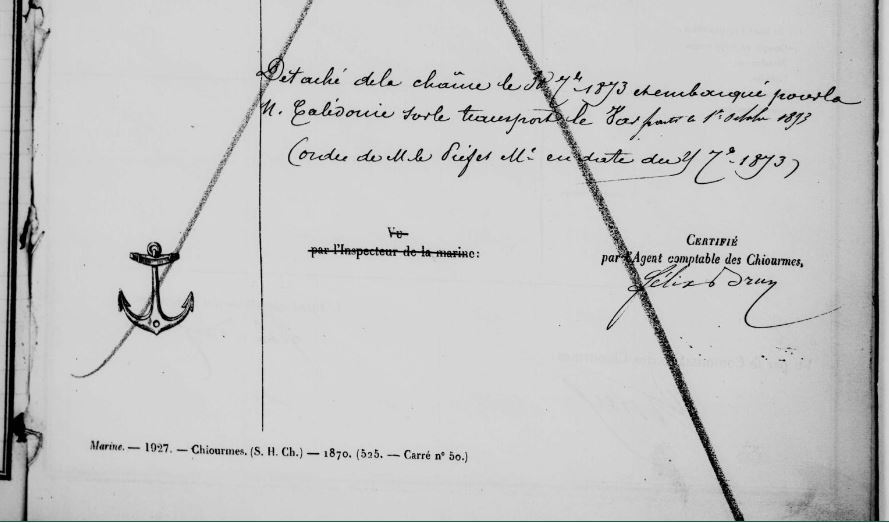
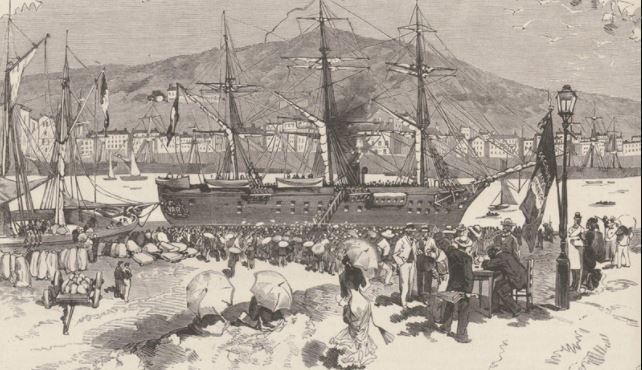

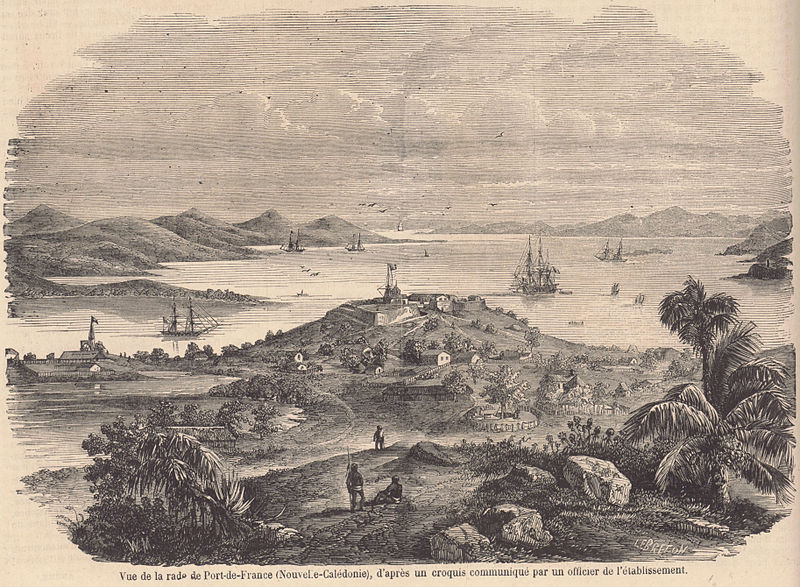
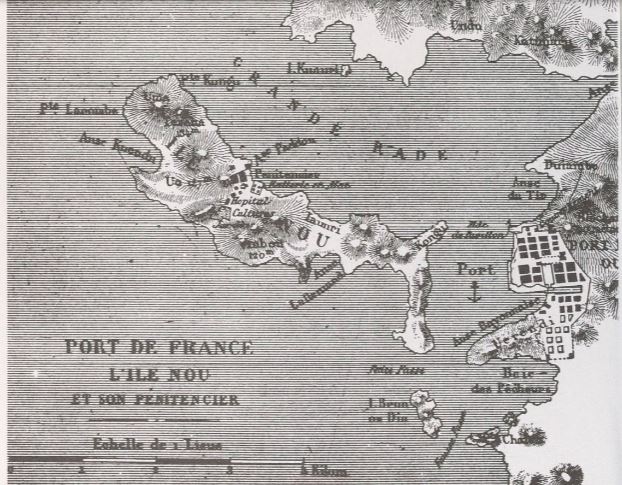
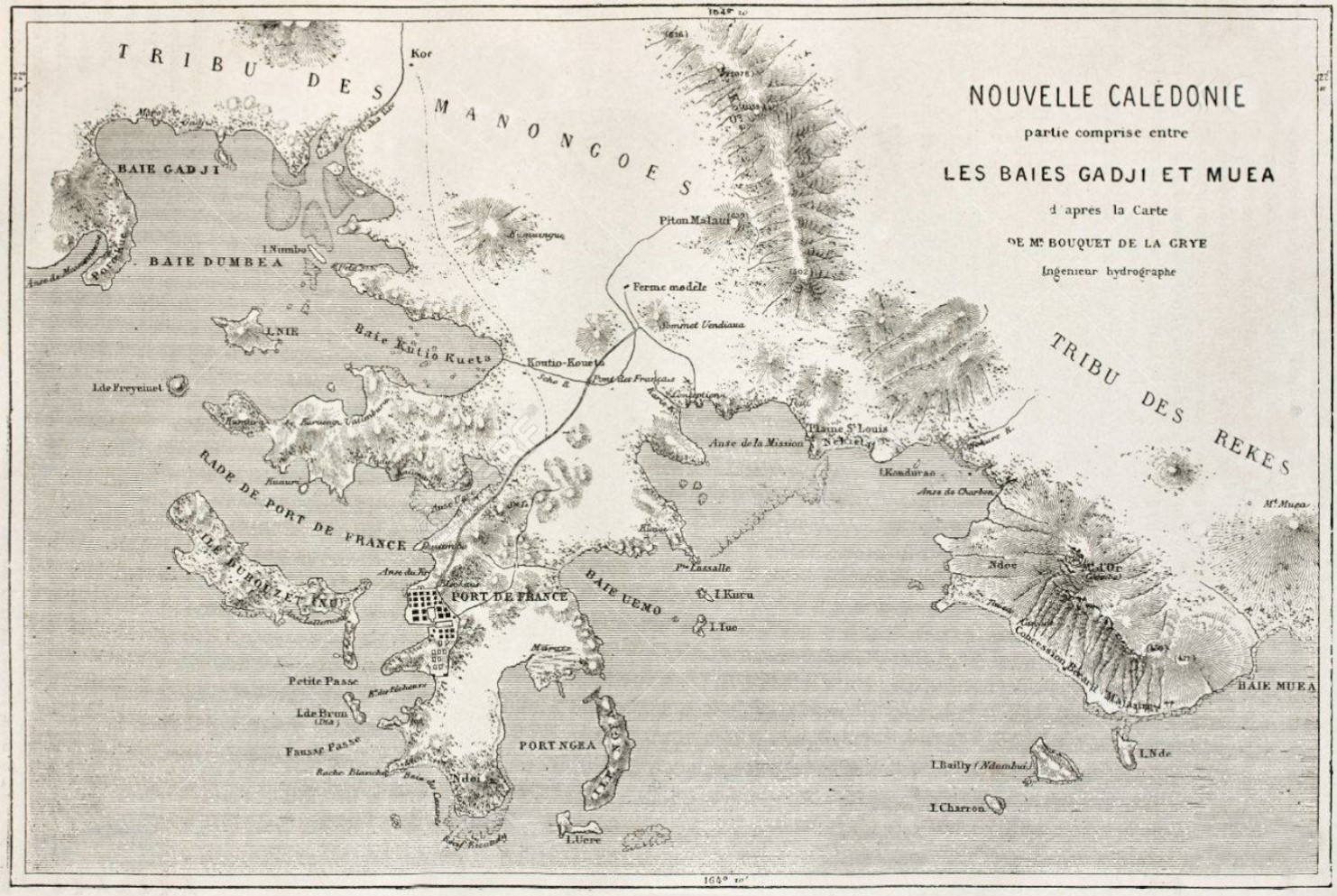
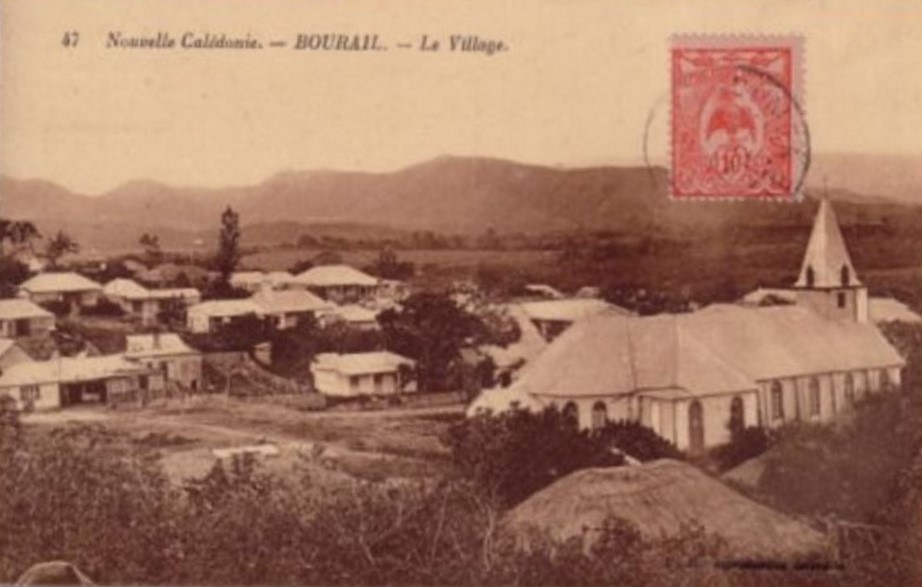




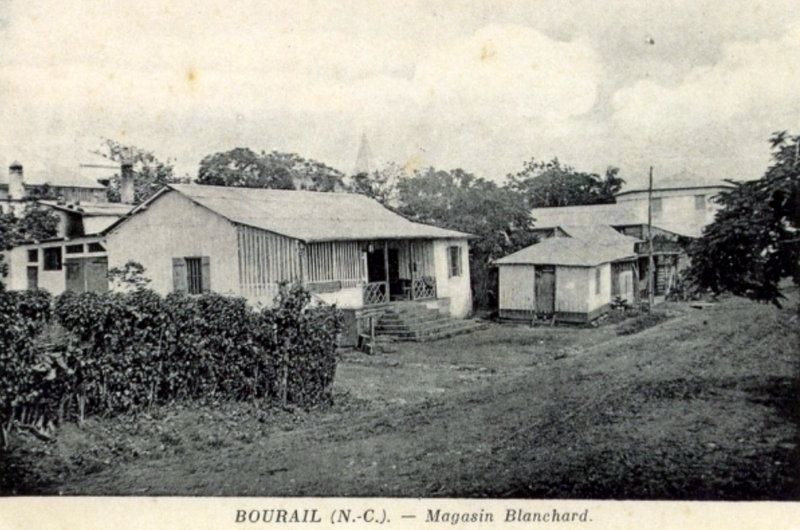



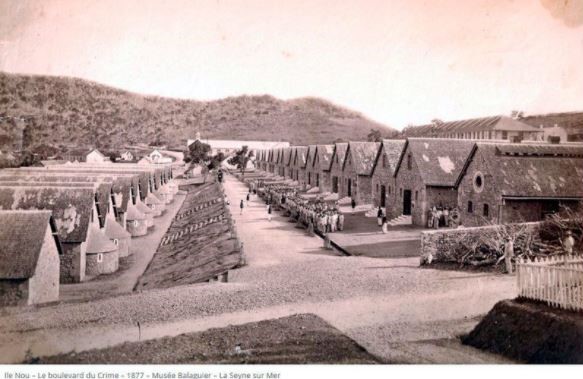

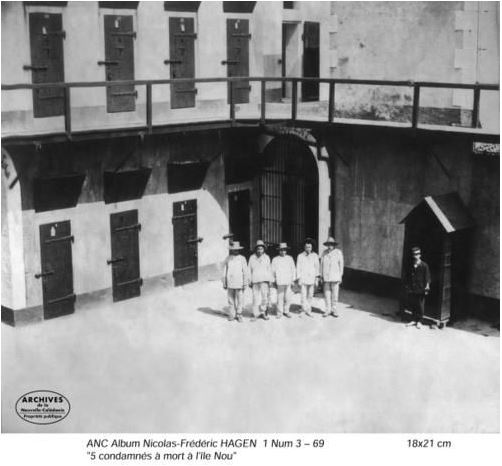
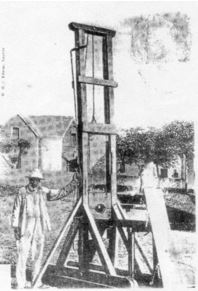
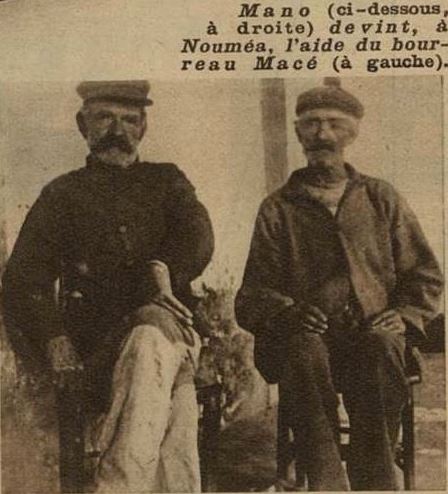
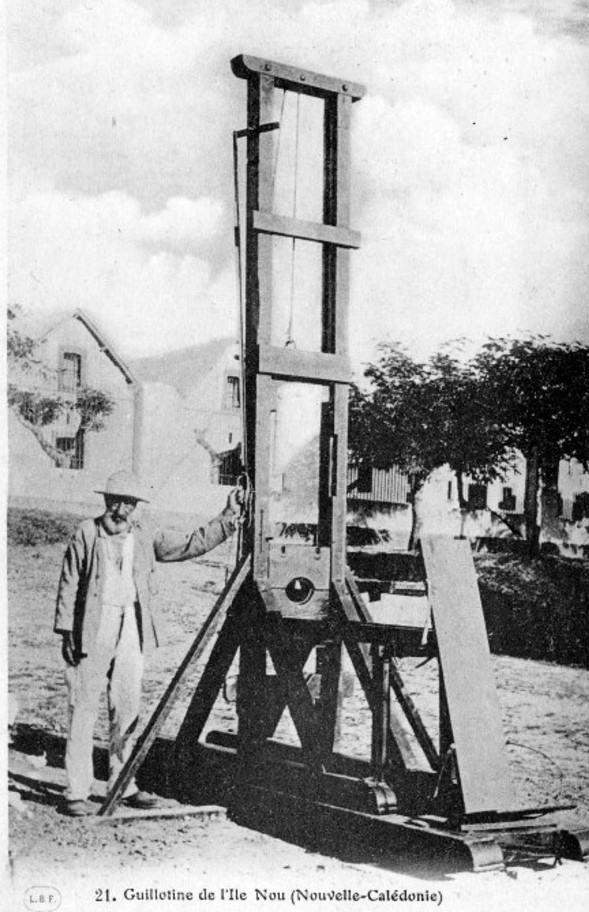
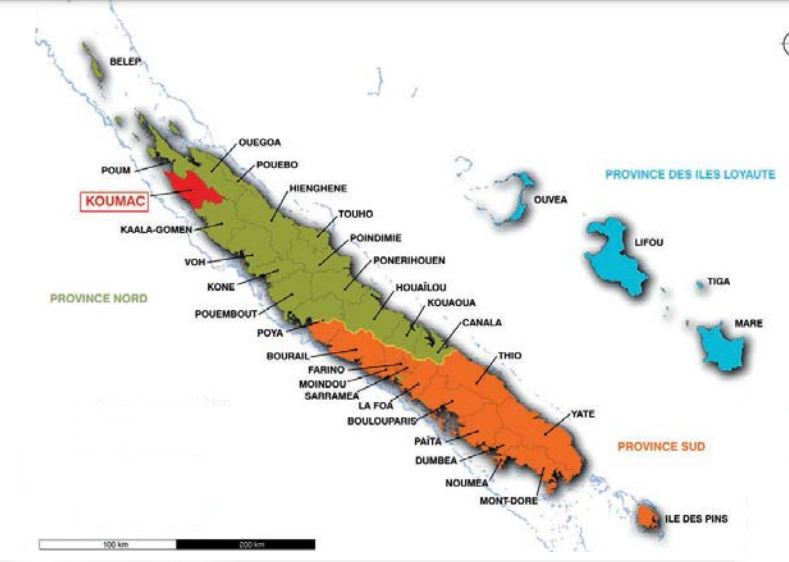

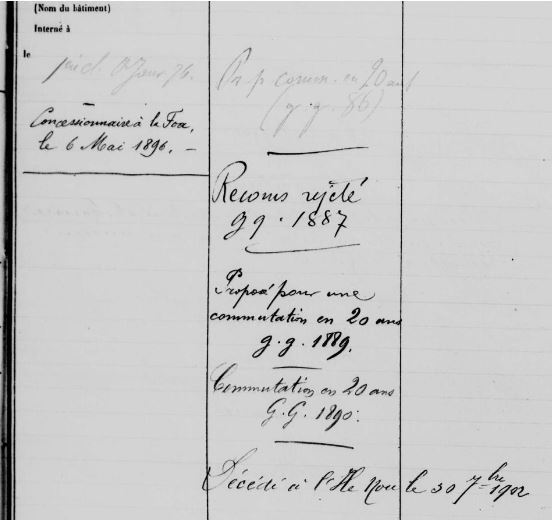

Bonjour,
C’est bien tardivement que je poste ce message.
Je vous félicite pour la qualité de cet article qui témoigne d’une recherche de documentation très poussée. Bravo aussi pour la présentation et l’ajout d’illustrations très pertinentes.
Au cours de mes propres recherches (dans le cadre de l’exposition “C’était dans le journal” que vous citez en début d’article) j’avais retrouvé dans mes archives une photo de deux personnages avec la légende “Mano (ci-dessous, à droite) devint, à Nouméa, l’aide du bourreau Macé (à gauche)”… Elle était titrée “Détective” mais, malgré mes recherches, je n’est pas retrouvé le document original d’où elle était extraite. En savez-vous plus ?
Si vous le souhaitez, je peux vous envoyer une copie du document par mail si vous me communiquez une adresse.
Salutations très cordiales.
B.C.