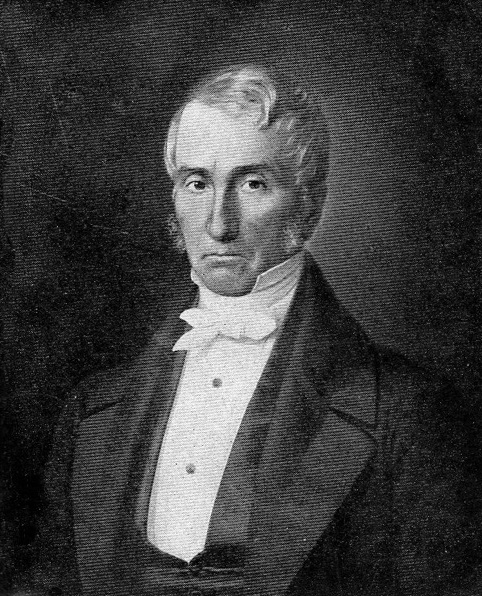Mémoire sur une maladie de la peau (peu connue) observée dans les environs de La Teste, par M. Hameau.
Une maladie de la peau, que je crois peu connue et qui est des plus graves, menace d’attaquer toute la population du pays que j’habite. Je n’ai eu l’occasion de la bien observer que depuis quelque temps, et elle m’a semblé contagieuse. Je ne puis dans ce moment en donner l’histoire complète ; je veux seulement en exposer les principaux symptômes pour savoir si elle aurait été observée par quelque autre médecin, et par ce moyen me mettre mieux à même de porter des secours efficaces à ceux qui ont le malheur d’en être atteints. Dans la suite, je tâcherai d’en donner une histoire plus détaillée, et même de présenter quelques malades à la Société.
Cette maladie attaque les individus de tout sexe et de tout âge ; mais je ne l’ai encore observée que sur des personnes pauvres, malpropres, et se nourrissant d’aliments grossiers. Elle dure plusieurs années, et elle est d’autant plus perfide, qu’elle est peu de chose dès son commencement. Dans ce premier temps, elle ne se montre que pendant les chaleurs de l’été, à peu près depuis le mois de juin jusqu’à la fin de septembre, et elle disparait l’hiver ; mais après deux ou trois de ces apparitions elle ne cesse plus, et les ravages qu’elle produit se continuent toujours d’une manière effrayante jusqu’à la mort.
Il y a peu de temps que j’eus l’honneur de présenter à la Société de médecine de Bordeaux l’exposé des principaux symptômes d’une maladie de la peau qui fut jugée être peu connue ; maintenant je vais offrir quelques observations sur cette maladie, afin de jeter les premières bases de son histoire, et parvenir, s’il est possible, à son entière connaissance.
Quoique je sois bien persuadé qu’elle règne dans toutes les grandes landes, je n’ai encore pu l’observer que sur les bords du bassin d’Arcachon. Je commencerai par une petite digression sur la topographie des communes qui sont sur ce littoral. Les lieux où cette maladie exerce ses ravages nous étant mieux connus, nous pourrons peut-être mieux parvenir à en connaitre la nature et le remède, ou les moyens de la prévenir.
Aperçu topographique sur les bords du bassin d’Arcachon.
Tout ce littoral est sablonneux, et c’est un des points les plus bas des Landes ; cependant il n’y a de marais qu’au confluent de l’Eyre avec le bassin, et même sont-ils peu considérables. La nature du sol et les agitations fréquentes et subites de l’air de la mer, font que l’atmosphère y est beaucoup plus saine qu’on ne pourrait le croire au premier aspect.
L’eau y est en général mauvaise, parce qu’on la prend dans des puits mal faits et mal entretenus. Je l’ai analysée sur presque tous les points de la contrée elle contient, en plus ou moins grande quantité, des muriates et des sulfates de chaux et de soude, et, dans certains lieux, quelque peu de fer. Rien ne serait plus facile que de l’avoir très bonne partout, en construisant les puits avec certaines précautions, et en utilisant, plus qu’on ne le fait, les sources vives qui sont çà et là. Ce pays est en général assez découvert ; seulement on y rencontre, à d’assez grandes distances, des bois de pins et de chêne, qui ne peuvent guère gêner la circulation de l’air.
Il y a huit communes, formant ensemble une population de 9 000 âmes, savoir la Teste, Gujan, le Teich, Biganos, Audenge, Lanton, Andernos et Lège. C’est entre le Teich et Biganos que l’Eyre se rend dans le bassin.
Comme je n’ai pas vu la maladie dans La Teste, je ne parlerai pas de cette commune dans ce qui va suivre, et je ferai un article particulier pour celle du Teich. Les habitants des autres communes sont agriculteurs, bergers, marins ou résiniers ; seulement chacune d’elles a, comme on pense bien, quelques ouvriers de première nécessité, tels que maçons, charpentiers, forgerons, etc. Les agriculteurs ou laboureurs sont les plus nombreux. La mauvaise nourriture dont ils font usage, leurs durs travaux et la malpropreté, presque inséparable de leur état, les disposent à bien des maladies. Ils se nourrissent ordinairement de viandes et de poissons salés, de coquillages, de cruchade (sorte de pâte non fermentée qu’on fait avec la farine de panis, de millet ou de maïs), de haricots, de pommes de terre, de pain de seigle, et ne boivent guère que de l’eau (mon œil !).
La culture du chanvre et celle du lin n’étant pas en usage dans ces communes, le linge y est en petite quantité : par conséquent les personnes pauvres, et c’est le plus grand nombre, ne peuvent pas changer souvent de vêtements. Leurs lits, ou plutôt leurs hamacs, sont garnis de peaux de brebis non tannées, et souvent aussi ils se servent de ces peaux pour se couvrir.
Ordinairement chaque famille a un troupeau et par conséquent un berger. On connait la vie paisible, mais monotone, de ces bergers : ils se nourrissent de pain de seigle, de cruchade, de lard, de sardines de Galice, et ne boivent que de l’eau. Leurs vêtements sont faits presque en entier de peaux de brebis non tannées. S’ils veulent se reposer dans leurs huttes ou dans leurs cases, ils n’ont que de ces peaux pour appuyer leur tête, et pour se préserver de l’humidité de la terre. On ne peut imaginer jusqu’à quel point la malpropreté est portée chez tous ces malheureux.
Les marins sont plus propres que les laboureurs et les bergers, se nourrissent beaucoup mieux, et ne travaillent pas autant ; aussi sont-ils infiniment plus robustes. Ils vivent principalement de pain de seigle, de viandes et de poissons frais, de coquillages, et boivent beaucoup de vin (ils ont horreur de l’eau !).
Les résiniers mènent la vie la plus rustique dont on puisse se faire l’idée. Ils sont logés dans de mauvaises cabanes, et couverts de haillons ; ils boivent une eau souvent corrompue, travaillent à l’excès, couchent ordinairement sur des planches vont nu-pieds dans les forêts, et se nourrissent encore plus mal que les laboureurs.
La commune du Teich contient à peu près 1 000 habitants ; elle est purement agricole. On n’y compte que trois ou quatre résiniers et pas un seul marin. On n’y cultive guère que du seigle, très peu de froment et peu de vignes. Les trois seules exploitationsde vignes sont celles de Victor Lavie, à Jean-Gard : la vigne, d’une étendue de 70 ares ; en 1892, elle est âgée de 9 ans. Elle a été plantée en joualles doubles après labour profond à la charrue ; les pieds sont à 0 m 80 sur les lignes et à 0 m 90 entre les deux lignes. Le pignon, le malbeck, le jurançon rouge entrent pour les trois quarts dans l’encépagement, la folle blanche forme le reste. L’alios est à 0 m 40 de profondeur, rarement moins. La végétation, favorisée par une bonne culture, est satisfaisante, mais la gelée vient six fois au moins en dix ans compromettre la récolte au point qu’elle n’a été jusqu’ici, en moyenne, que de 5 hectolitres à l’hectare. Le vin est consommé sur place ; il trouve facilement preneur à 35 fr. l’hectolitre.
M. Flouch, à la Verrerie dont le vignoble occupait jusqu’à l’an dernier quatre hectares. Il vient d’être réduit à deux et demi, par suite de la mortalité occasionnée par la gelée et le broussin. La vigne, plantée après défoncement à la charrue à 0 m 30 de profondeur, est âgée de 8 ans ; les pieds sont espacés à 1 m 66 en tous sens ; ce sont des merlots et cabernets conduits et taillés à la médocaine. Leur végétation, comme toujours, ne laisse rien à désirer et les récoltes seraient a l’avenant si la gelée presque annuelle (8 fois sur 10), ne venait tout compromettre. Les cinq récoltes faites depuis la plantation ont donné un total de 56 hectolitres, ce qui ne représente pas 3 hectolitres par hectare et par an. Le sol brûle en été et gèle en hiver, suivant l’expression du vigneron qui nous accompagnait dans la visite.
Mme Grangeneuve, à Nèzer, est le gros vignoble de la commune, 10 hectares âgés de 15 ans. On est ici en forêt, loin de toute communication facile ; le sol est de sable à sous-sol d’alios assez profond. La plantation a été faite avec soin, sur bon défoncement à la charrue avec fumure. Les plants, malbeck, merlot, cabernet, sont conduits en cordons et espacés à 2 mètres sur 1 m 20 et à 0 m 70 au-dessus du sol. Leur peu de rendement a fait penser, à tort selon nous, qu’une modification au système actuel de conduite et de taille donnerait de meilleurs résultats ; on se propose en conséquence de rabattre les souches et de les mettre à la médocaine. Dans le même but on vient d’essayer les cépages américains et notamment le clinton et le viala dont on ne dit que du bien). La gelée, aggravée paille broussin, a pour conséquence de réduire la récolte à 3 hectolitres par hectare.
Chaque proprieté est entourée de haies, de grands chênes, de pins ou d’autres arbres, ce qui rend cette commune plus humide que les autres et ce qui empêche l’air d’y circuler aussi librement. L’usage veut, plus qu’ailleurs, de déposer du fumier devant les habitations, de sorte qu’on n’y voit pas une seule maison qui n’ait près d’elle un tas de fumier. Les marais qui sont au confluent de l’Eyre et du bassin ajoutent encore à l’insalubrité de l’air.
Ses habitants n’ont guère d’autres ressources pour subvenir aux divers besoins de la vie, que le produit de quelques charrois et le superflu des grains qu’ils peuvent vendre. Lorsque la récolte manque, ce qui arrive trop souvent, ou lorsque le grain est à un bas prix, ils sont misérables, et toujours ils sont réduits à vivre dans la plus pénible médiocrité.
Je pourrais dire beaucoup d’autres choses sur la topographie de ces communes, m’étant autrefois occupé de cet objet ; mais je crois en avoir dit assez pour servir à ce qui va suivre.
Première observation.
Je fus appelé, au mois d’août 1818, dans la commune du Teich pour donner mes soins à Marie Bosmorin, veuve Dutruch, âgée de cinquante ans, dont l’occupation principale avait toujours été les travaux des champs. Cette femme avait trois filles très-robustes, adonnées aux mêmes travaux, savoir Marguerite Dutruch, âgée de vingt-quatre ans, autre Marguerite, âgée de vingt et un ans, et Jeanne, âgée de quatorze ans, non nubile cette dernière avait toujours couché, et couchait encore avec sa mère. Voici l’état dans lequel je trouvai la malade, enflure considérable des jambes et des cuisses, ventre un peu tendu, le reste du corps très amaigri ; diarrhée séreuse, fréquente ; urines rares et rouges ; langue gercée et douloureuse ; petite fièvre continue ; rougeur sur les deux carpes ; gerçures dans l’intérieur des mains ; idiotisme bien prononcé ; impossibilité absolue de marcher, parce que, lorsqu’elle se levait, elle éprouvait des tournoiements de tête qui la faisaient tomber ; poitrine en bon état (ouf !). Pendant qu’elle était dans son bon sens, elle s’était plainte d’un feu tout le long de l’œsophage et d’un resserrement de la gorge ; elle avait eu parfois des vomissements.
Voyant un tel désordre physique et moral, je jugeai que l’art ne pouvait que peu de chose pour le soulagement de la malade, et rien pour sa guérison. Pensant que cette maladie dépendait de quelque obstruction dans le bas-ventre, je palpai cette cavité, mais je n’en pus point découvrir ; seulement je distinguai un léger épanchement.
La malade étant épuisée par une mauvaise nourriture et surtout par la diarrhée, je prescrivis du bouillon de volaille, de la viande bouillie et du poisson frais. Voulant diminuer le trouble du colon, j’ordonnai des lavements émollients et une tisane adoucissante. Je revis la malade six jours après ; la diarrhée avait presque cessé, la digestion se faisait bien, mais l’ascite (épanchement de liquide) faisait des progrès. L’oximel scillitique fut mis en usage. Elle mourut peu de jours après.
Deuxième observation.
Au mois d’août 1819, je fus appelé pour Jeanne Dutruch, la plus jeune de ses trois filles. Elle avait aux mains et aux pieds une rougeur, sans tuméfaction apparente, mais aussi vive que puisse être l’auréole d’une vaccine. Jamais depuis je n’ai pu voir sur aucun sujet cette rougeur des pieds aussi prononcée ; elle se terminait d’une manière tranchée, à deux travers de doigt au-dessus des malléoles ; et aux mains, qui étaient gercées, elle finissait aussi à deux doigts au-dessus du poignet. Au premier aspect de cette malade, je me rappelai la rougeur que j’avais vue sur les mains de sa mère, rougeur qui, comme on pense bien, n’avait pas beaucoup fixé mon attention, la voyant alors pour la première fois. Je commençai dès ce moment à croire qu’il pouvait y avoir de l’analogie entre ces deux maladies. D’après cette idée, je me livrai à un examen scrupuleux et très détaillé de la malade. Elle avait quinze ans ; elle était réglée depuis six mois, et aussi forte qu’on puisse étre à cet âge. Elle me dit qu’elle avait eu cette rougeur pendant les deux derniers étés, mais aux mains seulement, sans avoir été dérangée et que ce qui l’avait décidée à m’appeler c’était une diarrhée qui lui venait par intervalle, et qui la fatiguait beaucoup. « J’ai aussi, me dit-elle, la langue douloureuse ; mais cela ne serait rien si je n’avais pas le cours de ventre. » Ce sont ses expressions traduites. Je vis ses évacuations qui me parurent telles qu’elles sont dans les indigestions le plus communément ; la langue était fendillée en long et en travers ; l’intérieur de la bouche, quoiqu’elle ne s’en plaignit pas, était plus rouge qu’il n’est ordinairement : elle crachait souvent une salive claire et muqueuse. L’urine coulait peu pendant la diarrhée, mais après elle était assez abondante ;celle que je vis était rougeâtre, et avait déposé un sédiment de même couleur. Le pouls était régulier, mais un peu faible. Elle ne souffrait point de l’estomac ni du bas ventre, si ce n’est qu’elle avait parfois quelques petites tranchées lorsqu’elle allait à la garde-robe. L’action musculaire, les fonctions mentales et la poitrine étaient en bon état. J’ordonnai des lavements avec une décoction de son et de graine de lin, à laquelle on ajoutait de l’huile ; je prescrivis aussi une tisane d’orge sucrée, et, autant que possible, la diète lactée. Je fis faire d’abord des lotions sur les mains et les pieds avec une décoction de guimauve, et, dans la suite, je fis frotter ces parties avec du cérat.
Tous les accidents diminuèrent peu à peu jusqu’à la fin d’octobre qu’ils cessèrent entièrement, si ce n’est que les pieds et les mains restaient rugueux, et que la langue était encore quelque peu gercée. Pendant l’hiver suivant cette jeune fille reprit, à peu de chose près, son embonpoint primitif. Elle se crut guérie, et je le crus aussi. Il est bon de dire que ses sœurs n’avaient aucun mal.
Au mois de juin de l’année suivante (1820), cette fille réclama encore mes secours. Il y avait un mois qu’elle était malade. Voici quel était son état : la rougeur des mains était revenue, mais non celle des pieds ; seulement j’y aperçus quelques petites taches rosées, et le reste de l’épiderme était comme écailleux. On y voyait çà et là de petits boutons semblables à ceux du prurigo. La malade se plaignait d’un feu particulier sur ces parties et d’une légère démangeaison. Du reste, tous les accidents de l’année précédente s’étaient fortement reproduits, et de plus, il y avait une légère fièvre continue qui augmentait vers le soir. Je prescrivis les mêmes moyens que ci-dessus.
Comme cette maladie piquait vivement ma curiosité, j’avais soin, malgré la distance qui me séparait de la malade, d’aller la voir le plus souvent qu’il m’était possible.
Considérant cette affection comme herpétique, j’ordonnai, pendant tout le mois de juillet, deux bains tièdes par semaine, et, pour les mains, une pommade ainsi composée d’onguent citrin, ramolli avec l’huile d’olive, 1 gramme ; fleur de soufre, un drachme. J’ordonnai aussi une tisane avec la douce-amère et la scabieuse.
Dans le mois d’août, je fis prendre des bains avec le sulfure de potasse, et la malade usa des poudres suivantes : muriate doux de mercure, 1 drachme ; fleur de soufre, 2 drachmes ; sucre, 31 grammes ; partagés en soixante-douze paquets. Elle en prit d’abord deux par jour, et ensuite quatre, buvant une verrée de tisane immédiatement après. Ces poudres étaient gardées dans la bouche aussi longtemps que possible, et je n’aperçus point qu’elles augmentassent la salivation. Pendant ce mois d’août, la diarrhée cessa plusieurs fois, mais elle revenait par intervalles de trois ou quatre jours. L’éruption des mains avait disparu, mais l’épiderme était luisant comme sur les cicatrices des brûlures. Pendant le mois de septembre, tout fut en s’améliorant, et le mois d’octobre la malade se trouva assez bien ; seulement la langue restait douloureuse et gercée. Je fis continuer l’usage du lait, de la tisane, et, par intervalles, celui des poudres. La malade reprit assez de fraicheur jusqu’au printemps suivant, et elle était toujours régulièrement menstruée.
Le 24 juillet 1821, je fus encore appelé pour cette même fille, qu’on me dit être devenue folle. Je trouvai qu’elle était taciturne, qu’elle ralliait difficilement ses idées et qu’elle déraisonnait, mais elle n’avait point de vrais accès de folie. Ses sœurs me dirent qu’il y avait déjà plus d’un mois qu’elles s’étaient aperçues qu’elle variait et qu’elle chancelait sur ses jambes. La malade était très changée, mais elle n’était pas très maigre. Ses mains étaient rugueuses et gercées, mais point rouges, ni les pieds non plus ; la langue était enflammée et très douloureuse ; la fièvre lente était revenue, et la diarrhée était très forte.
J’avoue que ce triste état de la malade m’affligea et m’embarrassa d’abord extrêmement, ne sachant guère comment le juger, ni par conséquent comment y remédier. Toutefois, après avoir mûrement réfléchi, je pensai que la cause herpétique, quelle qu’elle fût, agissait sur la moelle épinière et sur le cerveau ; que l’indication la plus rationnelle était de la rappeler au-dehors ; en conséquence, j’ordonnai des bains de pieds et de mains sinapisés, qui furent faits pendant quelques jours, et des frictions avec la pommade épispastique vis-à-vis la colonne vertébrale, jusqu’à produire une forte rubéfaction. Les mains et les pieds se tuméfièrent et devinrent rouges ; il s’établit aussi une suppuration assez abondante entre les épaules ; mais tout cela ne diminua en rien les accidents. Dès ce moment, la malade n’ayant pas sa raison, il ne fut plus possible de l’astreindre à suivre un régime, ni à prendre des remèdes intérieurs. Il fallait lui donner à manger ce qu’elle voulait ; aussi la diarrhée lui revenait fréquemment et était très-forte. Ses sœurs, forcées de suivre journellement les travaux des champs, ne pouvaient lui donner des soins assidus ; elles la laissaient seule dans leur maison ou chez quelque voisin ; aussi, lorsque j’allais la voir, je la trouvais souvent couchée sur les carreaux ou sur la terre devant sa maison, où elle s’était trainée. C’était un spectacle bien attendrissant de voir cette jeune personne, qui avait été très intéressante, réduite à un si affreux état, et contre lequel je ne pouvais rien. Bientôt elle ne put guère plus sortir de son lit, et elle était tellement hébétée qu’elle ne comprenait presque rien et qu’elle ne faisait que balbutier quelques mots qu’on avait de la peine à comprendre. Elle mangeait peu, mais ce qu’elle prenait, elle l’avalait avec avidité. Pendant qu’elle était dans cet état, elle fut atteinte d’une ménorragie, qui n’était pas bien considérable, mais qui dura plus de six mois, quoique précédemment elle eût toujours été bien réglée. Enfin, pour achever ce pitoyable tableau et pour ne pas répéter toujours les mêmes choses, je dirai que cette pauvre fille vécut ainsi encore plus de deux ans ; qu’elle eut quelques moments lucides, c’est-à-dire que, par intervalles, elle comprenait et parlait mieux (c’était pendant les temps froids) ; que la diarrhée s’arrêtait même pour un temps assez long ; qu’on l’a vue parfois se lever et marcher sans soutien ; et qu’elle mourut en février 1824 dans un marasme complet. J’avais demandé qu’on m’avertît lorsqu’elle mourrait, parce que je voulais en faire l’ouverture ; mais, comme elle restait à deux lieues de chez moi, je ne sus sa mort qu’après son inhumation.
Cette maladie avait beaucoup occupé ma pensée, et me fit faire bien des réflexions. Je ne pouvais pas la classer, ne connaissant aucune affection dans les auteurs qui y eût du rapport ; mais je lui voyais les plus grands traits de ressemblance avec celle dont la mère était morte ; tels que la rougeur des mains, la langue gercée, la diarrhée, la faiblesse musculaire et la démence. Je crus donc que ces deux maladies étaient de la même nature, et je dus aussi croire que la fille devait l’avoir prise à la mère, puisqu’elles avaient couché longtemps ensemble. Mais si, depuis lors, je n’avais vu d’autres cas semblables, j’aurais sans doute considéré ceux-ci seulement comme deux affections anormales, dépendantes de l’idiosyncrasie de ces deux personnes.
D’autres exemples vinrent bientôt s’offrir à mon observation.
Troisième observation.
Le 10 mai 1824, je fus demandé au village de Camps, commune du Teich, pour la femme Degraves, atteinte d’une fièvre intermittente. Je trouvai là, le père de la malade, âgé de soixante-cinq ans, et assez fortement constitué. Ayant par hasard regardé ses mains, j’y vis dessus de fortes rougeurs, et, à l’intérieur, des gerçures multipliées. Alors je lui adressai une suite de questions, auxquelles il répondit avec précision, et dont voici le résultat : il y avait plusieurs années que, tous les étés, ce mal lui venait aux mains et dans la bouche, sans qu’il en connût la cause qu’il avait de temps en temps la diarrhée ; que s’il prenait du vin, du vinaigre, de l’ail ou quelqu’autre chose forte, il sentait un grand feu dans la bouche jusqu’à l’estomac, mais qu’il ne souffrait point du ventre ; que du reste il se sentait beaucoup affaibli et qu’il ne pouvait guère plus conduire ses bœufs ni travailler aux champs.
Cet homme, qui avait beaucoup de bon sens, me voyant occupé de sa maladie, me dit que sa femme avait aussi du mal aux mains et dans la bouche depuis longtemps, mais que ce mal était peu de chose, en comparaison d’une autre maladie dont elle était atteinte.
- Qu’a-t-elle donc? lui dis-je.
- Elle ne peut pas marcher, et elle a perdu la tête.
Ayant demandé de la voir, il me conduisit chez lui. Je trouvai cette femme dans son lit ; après l’avoir bien examinée, elle me parut être au dernier terme de la maladie, et, en effet, elle mourut peu de jours après, dans le même état qu’était la veuve Dutruch au moment de sa mort. J’aurais bien désiré suivre les progrès de la maladie de ce brave paysan (ainsi que son gendre, il se nommait Degraves) mais il ne réclama jamais mes secours. Cependant je m’informais souvent de son état à sa fille ; chaque fois, j’apprenais que la maladie faisait des progrès, et il mourut l’année suivante avec tous les symptômes de la maladie ; seulement il conserva assez son bon sens jusqu’à son dernier moment. Je laisse à juger quel fut mon étonnement lorsque je vis encore cette maladie sur ce couple infortuné ! Dès ce moment, je pensai qu’il était très possible qu’elle fût plus répandue et qu’elle fût due à un virus particulier. D’après cela, chaque fois que, depuis lors, j’allais visiter des malades dans cette commune, ou même dans les autres, j’avais soin de regarder les mains des diverses personnes que je voyais, et il m’est arrivé plusieurs fois de la découvrir.
Avant de passer outre, je dois noter que la femme Degraves, citée plus haut, m’a assuré depuis peu qu’une de ses cousines, nommée Jeanne Degraves, était morte de cette maladie à l’hôpital Saint-André de Bordeaux, en 1822 ou 1823. « Je ne puis pas bien m’a-t-elle dit, préciser l’époque de sa mort ; mais je suis bien certaine qu’elle avait la même maladie que ma mère. » On pourrait peut-être vérifier cela sur les registres de l’hôpital.
Quatrième observation.
Dans le mois de juin 1824, la dame Condon, sage-femme au village de Mestras, commune de Gujan, me fit appeler pour la traiter d’une sciatique. J’aperçus la rougeur en question sur les mains d’une nièce qu’elle avait mariée dans sa maison, et qui l’aidait dans les soins qu’elle devait donner aux nouvelles accouchées, principalement dans la commune du Teich, où elle était fréquemment appelée. Cette nièce, nommée Marguerite Deycard, épouse Duret, était âgée de vingt-cinq ans, très-bien constituée, et avait une petite fille de trois ans. Je lui dis qu’elle avait un mal qui méritait beaucoup d’attention, et j’eus soin d’exposer, en particulier, à sa tante, tout le danger dont elle était menacée. Cette jeune femme avait une répugnance invincible pour les remèdes ; aussi, jamais, malgré toutes les instances de sa tante et d’autres parents, il ne fut possible de la soumettre à un traitement, pas même après lui avoir fait part de ce que j’avais dit sur le danger qui la menaçait. Cependant, elle voulut bien prendre quelques bains domestiques, et se frotter avec la pommade citrine et sulfurée dont j’ai parlé ; mais elle ne voulut s’astreindre à aucun régime. Elle vivait séparée de son mari ; sa fille n’avait point encore couché avec elle, et je défendis qu’on l’y fit coucher.
Après une quinzaine de jours, sa tante étant guérie de la sciatique, je ne la vis plus que comme en passant cependant, dans une de ces visites, j’appris qu’elle avait la diarrhée. C’était dans le mois d’août. Je lui dis alors qu’elle devait se rappeler que je lui avais prédit que la diarrhée lui viendrait, et que, par conséquent, elle devait commencer à comprendre qu’il était temps de penser plus sérieusement à sa maladie. Elle me répondit qu’elle avait eu ce mal deux autres étés ; qu’il s’en était toujours allé de lui-même, et qu’elle espérait bien que celui-ci en ferait autant. « Les médecins, me dit-elle, ne nous parlent jamais que de remèdes, mais eux n’en prennent pas souvent. » Elle me gratifiait quelquefois de saillies de cette nature, mais cela ne m’empêchait point d’aller chez elle de temps en temps, pour savoir où en était la maladie.
On m’envoya chercher le 26 septembre, me faisant dire qu’elle avait une perte utérine, et qu’elle ne pouvait pas se tenir sur ses jambes. Je la trouvai au lit. Voici quel était son état : figure pâle et triste ; tournoiement de tête lorsqu’elle se soulevait ; pouls plein, mais lent ; diarrhée ; ménorragie assez forte, qui durait depuis deux jours ; quelques tranchées dans l’hypogastre ; lenteur des perceptions mentales ; couleur vermeille du sang évacué ; menstrues passées depuis vingt jours, et qui avaient été ordinaires ; bouche un peu enflammée ; langue douloureuse ; salivation muqueuse et limpide. Je la saignai de suite du bras ; j’ordonnai une légère limonade, des lavements mucilagineux et la diète lactée.
La perte s’arrêta presque sur-le-champ, et le lendemain la diarrhée fut peu de chose.
Le 28, ayant voulu se lever, elle tomba sur les carreaux sans pourtant se faire aucune blessure. Arrivé près d’elle, le même jour, je trouvai qu’elle déraisonnait complétement ; le pouls était plein et lent. Je dus reconnaitre, par l’expérience, que la maladie agissait sur la moelle épinière et sur le cerveau. Je dois dire que je craignis que la saignée du bras, qui était bien indiquée contre la ménorragie, n’eût pu nuire en arrêtant trop tôt cette évacuation. D’après cela, j’ordonnai huit sangsues à l’anus, et, lorsqu’elles seraient tombées, qu’on mit la malade dans un demi-bain. Les piqûres donnèrent abondamment, sans produire aucun soulagement de la tête. La perte reparut et dura huit jours, sans aucun bon effet. La diarrhée persistait ; il y avait ordinairement trois ou quatre selles par vingt-quatre heures, et c’était principalement le matin qu’elles avaient lieu. Dès ce moment, elle garda toujours le lit, ne pouvant se tenir debout ; la fièvre s’établit ; la diarrhée fut presque continuelle ; la perte revint souvent, et la démence ne cessa plus.
Comme ce qui me resterait à dire sur cette infortunée serait presque en tout conforme à ce que j’ai exposé relativement à la fille Dutruch, je vais, pour ne pas être trop prolixe, noter seulement les différences que ce cas-ci peut offrir.
La femme Duret avait toujours été bien nourrie, tenue proprement, et ne s’était point occupée des travaux de la terre. Elle était d’une belle taille et d’une belle carnation ; elle n’avait eu aucune maladie de la peau, ni n’avait presque jamais été malade. Malgré ces heureuses circonstances, elle contracta la maladie. Tout ne donne-t-il pas la certitude qu’elle l’a prise en soignant quelque accouchée du Teich, chez lesquelles elle couchait très-souvent ? Quoi qu’il en soit, on doit remarquer que la maladie parcourut ses périodes avec une grande rapidité. La fille Dutruch vécut près de trois ans, à compter du commencement de la démence ; celle-ci ne vécut pas un an, car elle mourut en juin 1825. Dans les deux mois qui précédèrent sa mort, elle eut une sueur générale assez grande pour qu’on dût la changer de linges trois ou quatre fois par vingt-quatre heures. C’est la seule fois que j’ai vu ce symptôme. J’espérai, mais inutilement, que cette diaphorèse produirait quelque effet salutaire ; il n’y eut que la diarrhée qui fut notablement diminuée, mais qui ne cessa même pas entièrement.
Cinquième et sixième observations.
Pendant que je soignais cette malade, j’eus occasion de voir d’autres personnes atteintes de la maladie au dernier degré. Je citerai entre autres, le nommé François Raymond, dit Mounéon, berger du quartier d’Arès, commune d’Andernos (il est mort le 2 juillet 1827) ; un autre berger, qui était à Lège, dont je ne puis donner le nom ; Jean Cire, aussi berger, au quartier de Pelle, commune du Teich.
Le premier de ces bergers, que j’ai vu deux fois par occasion, avait été très robuste, et avait le mal des mains extrêmement fort. Il ne pouvait ni fermer les mains, ni mouvoir les doigts, tant la peau était gercée en dehors et en dedans. Aucun malade ne m’a présenté le mal de ces parties à un si haut degré. Du reste, il était en proie à tous les symptômes de la maladie, surtout à ce feu qui, de l’estomac, remonte au pharynx, dont j’ai parlé dans ma note.
Jean Cire était âgé de trente-huit ans, et d’un tempérament pituiteux (relatif à la sécrétion du nez). Il avait eu plusieurs fois la gale, et avait toujours été maladif. Il était enflé des membres inférieurs, très bouffi et d’une stupidité remarquable. Il mourut un mois après ma première visite. Pendant qu’il fut soumis à mon observation, j’aperçus sur sa tête une chose fort singulière, que je crois étrangère à la maladie, mais qu’il me paraît utile de noter. Cet homme avait les cheveux très lisses, et couleur de lin. Je remarquai qu’ils étaient par mèches d’inégales longueurs, comme si on les eût gaspillés exprès avec des ciseaux. Je demandai à sa femme pourquoi on les avait ainsi coupés. Elle me répondit qu’on ne les avait point coupés, mais qu’ils se rompaient ainsi d’eux-mêmes. Pour m’assurer du fait, j’en saisis une mèche, et il m’en resta une grande quantité entre les doigts, la plupart rompus à diverses hauteurs, et quelques-uns déracinés. Je répétai plusieurs fois l’expérience, qui eut le même résultat. Comme ces gens-là étaient très pauvres et très sales, je jugeai que c’était dû à la malpropreté, et que peut-être quelque insecte causait ce phénomène. J’examinai la tête au grand jour, mais je ne vis rien, pas même des poux. Je fus exprès voir le malade le lendemain. Je regardai attentivement toute sa tête avec une loupe sans pouvoir rien distinguer. Je restai donc incertain sur la nature de celle maladie. Mais voici ce qui me paraît la rendre bien remarquable : huit jours s’étaient à peine écoulés depuis ma dernière visite, que je sentis au menton du côté gauche, une douleur qui me venait une douzaine de fois par jour, comme si avec des pinces on m’eût chaque fois arraché une barbe. Lorsque cela me prit, j’avais une cravate de soie, et je crus que les barbes se prenaient à la soie. Je quittai la cravate et je me rasai. Le lendemain, je sentis la même douleur, et jusqu’au troisième jour que je me rasai de nouveau. Alors j’aperçus que le lieu de la douleur, grand comme une pièce de dix sous, était entièrement dépilé et d’un blanc de lait. Je me rappelai de suite que j’avais négligé de me laver les mains la première fois que j’avais touché les cheveux de cet homme, et je pensai, avec toute la vraisemblance possible, que j’avais pris sa maladie des cheveux. J’avoue que cela me causa d’abord quelque inquiétude, ne sachant trop quel remède lui opposer. Cependant, toujours pénétré de l’idée que quelque insecte imperceptible causait celle maladie, je pensai que l’onguent mercuriel pourrait produire un bon effet je m’en frottai deux fois ; il me guérit complétement.
Je n’ajouterai aucune réflexion à ce fait ; je me borne à l’exposer tel qu’il m’est arrivé. Je ne présenterai point ici d’autres observations, parce que celles qui me restent sont incomplètes, les individus étant encore vivants. J’ai, dans ce moment, six de ces malades dans la commune de Gujan, tous cultivateurs.
Le nombre de personnes infectées sur tout le littoral ne m’est pas bien connu, mais je suis très certain qu’il est considérable, dans le Teich surtout. Aujourd’hui même, 26 juin, une fille de cette commune est venue me consulter pour elle, et me disant que sa mère aussi avait cette maladie. Je lui ai conseillé d’aller à l’hôpital de Bordeaux, ainsi que sa mère. Comme ce sont des personnes très pauvres, j’espère qu’elles se décideront à y aller. Si elles prennent cette détermination, cette fille viendra me trouver sous peu de jours, parce que je lui ai promis une lettre de recommandation.
Pour ce qui est des autres malades, plusieurs m’ont promis de se rendre à Bordeaux, pourvu que je voulusse les présenter moi-même à la Société. Des occupations impérieuses m’ont empêché jusqu’ici de faire ce voyage, mais j’espère le faire bientôt.
Maintenant je ne vois rien de plus convenable, pour éclairer la matière, que de disserter un peu, ou de faire quelques réflexions sur cette maladie. Sa durée n’est pas fixe elle est relative à l’âge, au tempérament des sujets, et peut-être à certaines causes que je n’ai pu apprécier, Je crois qu’elle a une marche plus rapide chez les jeunes personnes, et chez celles qui sont d’un tempérament sanguin. L’éruption m’a paru pouvoir se montrer sur toutes les parties du corps soumises à l’ardeur du soleil. Je l’ai vue au cou. Les seuls symptômes que j’ai vus constamment sont l’éruption des mains, la diarrhée et le défaut d’équilibre dans l’action musculaire. La démence ni la douleur de l’œsophage ne sont pas constantes.
Sa cause est-elle interne ? Si elle l’était, quelques individus au moins, de ceux qui en sont atteints, auraient été malades avant l’apparition de cette maladie, qui ne serait que secondaire ; cependant tous sont très bien portants lorsqu’elle se développe, et même le plus grand nombre n’ont jamais eu de dérangements qui méritent le nom de maladie. Cette cause interne serait certainement l’altération d’un ou plusieurs organes ; comment croire que cette altération n’aurait offert aucun signe de son existence, chez aucun sujet, antérieurement à l’éruption des mains ? Mais je suppose, ainsi que l’a pensé mon honorable confrère, M. Bonnet, que cette cause fût une gastro-entérite chronique, dont les effets pussent toujours être assez latents, assez voilés, pour ne jamais se montrer que par les premiers signes de la maladie. Dans ce cas, nous devons voir cette maladie surgir principalement chez les individus qui, par leur alimentation, par leurs excès et par leur genre de vie, s’exposent le plus aux gastroentérites chroniques. Les marins, par exemple, qui boivent beaucoup de vin, qui mangent beaucoup de poisson, d’ail, d’oignons et de coquillages, qui font souvent des orgies en tout genre, nous offriraient au moins quelques exemples de la maladie, car ils sont dans toutes les conditions propres à cela. Eh bien, non aucun marin n’a la maladie. Mais au moins les résiniers qui travaillent à l’excès, qui sont toujours exposés à toutes les intempéries de l’air, qui se nourrissent des aliments les plus grossiers et les plus malsains, nous en offriraient quelques exemples. Pas davantage aucun résinier n’a la maladie.
Si, dans ces sortes de recherches, on doit établir son opinion sur les résultats d’une sévère analyse, plutôt que sur des probabilités, ne pourrait-on pas, jusqu’à preuve contraire, commencer à croire que cette cause n’est pas interne ? Je sais, comme tout médecin doit le savoir, que plusieurs maladies de la peau doivent leur naissance à des affections chroniques des organes intérieurs ; mais ces cas sont isolés, et on ne les rencontre pas en masse, pour ainsi dire, comme on rencontre ici cette maladie.
Sa cause est-elle externe ? Ici le champ est vaste, puisqu’il embrasse en quelque sorte toute la nature. Aurai-je besoin de la compulser en entier pour y découvrir cette cause ? je ne le crois pas. Il suffira, je pense, de jeter un coup d’œil sur les différences topographiques des communes où règne la maladie, et de celles où elle ne règne pas ; puis d’examiner avec attention quelle différence essentielle se trouve entre les cultivateurs qui sont atteints de la maladie, et d’autres qui n’en sont pas atteints. Pour procéder avec ordre dans cette recherche, il faut préalablement rappeler deux choses essentielles, que voici : 1° – il n’y a que des bergers, des cultivateurs, et quelques autres personnes qui ont des rapports intimes avec eux, qui aient la maladie ; 2° – que les cultivateurs de La Teste, qui sont en assez grand nombre, n’en offrent aucun exemple, tandis que dans toutes les autres communes du littoral elle y est très répandue parmi les individus des professions que je viens de signaler.
J’ai dit que la seule commune du Teich différait des autres, parce qu’elle était purement agricole, plus boisée, et qu’elle contenait quelques marais ; que les habitants étaient plus pauvres et plus malpropres. Si la maladie devait sa naissance à toutes ces causes réunies, on ne la verrait qu’accidentellement dans les autres communes, sur quelques individus de toutes sortes de professions, et situés çà et là, lesquels, ainsi que la nièce Condon, l’auraient prise dans le Teich ; mais elle est déjà très-répandue dans Gujan et seulement parmi des cultivateurs. Dans Gujan ! une des plus belles communes du département, des mieux aérées, qui réunit le double avantage de la pêche et de l’agriculture, qu’on prendrait pour un beau jardin, tant elle est bien cultivée, et dont les habitants semblent respirer l’aisance et le bonheur ! En vérité, il me serait bien difficile de voir cette cause dans la manière d’être du Teich, lorsqu’une autre paroisse, qui est dans une situation tout à fait opposée, m’offre en abondance des exemples de la maladie.
L’eau qui sert à la boisson pourrait-elle la produire ? Mais j’ai dit qu’elle était la même partout, et que, s’il y avait quelque différence, elle était au désavantage de La Teste où la maladie ne règne pas.
Serait-ce l’alimentation qui la produirait ?
Quoi qu’il en soit, M. Jolly, dans son rapport, fait en 1836, sur l’état sanitaire des landes, au conseil de salubrité qu’institua près d’elle la compagnie de canalisation et de colonisation des landes de Bordeaux s’exprime en ces termes « La nourriture du landais se compose de pain de seigle en général grossièrement manipulé, mal fermenté et mal cuit, de bouillie faite avec la farine de maïs, de l’eau et du sel, connue sous le nom de cruchade, de soupe préparée avec le pain, de l’oignon, de la graisse et du vinaigre, de lard fort souvent rance et de jambon frit qu’on nomme mousset, de sardines salées, vulgairement dites de Galice, et de harengs saures. La boisson ordinaire est de l’eau d’assez mauvaise qualité. Les landais sont en général mal vêtus et mal logés. La plupart de leurs habitations sont obscures, humides, sans carrelage, ni plafond, ni croisées, de telle sorte que l’air et la lumière n’y pénètrent que par la toiture ou la porte d’entrée qui, au lieu de vitrage, offre une simple toile de canevas ». Ce tableau bien fidèle du landais s’applique parfaitement aux individus de nos localités qui sont atteints de la pellagre. Or, comme il s’accorde parfaitement aussi, mais à la vérité sur un moindre modèle, avec celui que les auteurs, pris en masse, ont donné comme cause de la pellagre en Italie, il faut en conclure que cette affection, soit qu’on l’examine au-delà des Alpes, soit qu’on l’envisage parmi nous, dépend de l’ensemble de ces causes et non de leur individualité.
Je ne dois pas aller plus loin sans faire observer que la maladie est d’autant plus répandue et d’autant plus prononcée dans ses effets et dans sa marche, que les conditions hygiéniques sont plus ou moins vicieuses. Cette remarque porte à la fois sur les localités et sur les individus. Dans les villages où règne la pellagre, la maladie est plus commune et plus forte au milieu de ceux où l’hygiène est la moins bonne ; il en est ainsi des individus ils sont d’autant plus pellagreux que leur hygiène est plus défectueuse. En général ce n’est pas dans la population agglomérée en village, autour de son clocher, qu’il faut aller chercher la maladie qui nous occupe, c’est dans les maisons détachées, éloignées, isolées des autres, qu’elle exerce son plus fort empire. Alors, plus les infractions aux règles de l’hygiène sont larges, plus les sévices de la maladie sont généraux.
À Mios, par exemple, où l’on a la funeste habitude de joindre au régime le plus vicieux, aux habitations les plus mal disposées, à l’usage le plus large du maïs, à la malpropreté la moins supportable, la coutume de creuser en godet un espace de terrain aussi grand et souvent plus grand que la maison et ses dépendances, pour y déposer des matières végétales destinées à y pourrir pour faire du fumier, la pellagre est plus répandue que n’importe en quel village de nos environs. À Audenge, où les constructions rurales les plus anciennes sont dégoûtantes à voir, et où les colons qui les habitent sont très indigents, la pellagre est assez répandue. Biganos, Le Teich, Gujan, Sanguinet, Biscarosse, etc., offrent les mêmes particularités. Notez cependant toujours que ce sont les gens les plus misérables, les plus sales, les plus mal nourris, etc., qui sont toujours les seuls affectés. Ainsi ce ne sera point chez les individus aisés que vous rencontrerez la pellagre; ce ne sera pas non plus dans les localités où l’argent circule que vous la verrez. Voyez La Teste, la petite Athènes des landes, tout y respire l’aisance, la propreté, je dirai même le luxe ; eh bien, à La Teste il n’y a pas un seul pellagreux. Voyez encore le joli village de Gujan si remarquable par sa position, ses maisons propres et bien distribuées ; il n’y a de pellagreux que dans les quartiers qui ne sont pas en harmonie avec le bourg. Allez à Biganos, où la verrerie de M. Olivier répand tant d’aisance et de propreté, la pellagre ne s’y rencontre que dans les chétives demeures où un propriétaire, avec son journal de terrain, cultive et récolte le pain de sa famille à la sueur de son front, sans que sa production trop modique ne lui permette jamais d’échanger son revenu contre les objets d’un bien-être usuel. Oh ! là là, vous trouverez la pellagre dont l’intensité est toujours en raison inverse de l’aisance. Voyez encore Arès, dont la population est presque toute marinière ; où chaque jour la famille entière pêche et vend sa capture ; où la propreté est grande, où l’aisance, sans être considérable, est assez commune vous n’y trouverez de pellagreux que parmi ceux dont la profession ou le mode de bail à ferme repoussent les moyens de satisfaire aux exigences les plus strictes d’une hygiène tant soit peu confortable. Ainsi s’explique la fréquence de la pellagre chez les laboureurs et les bergers. Les laboureurs, en effet, cultivant leur héritage, n’ont pas en général assez de terres pour récolter beaucoup au-delà de leurs besoins ; heureux encore quand ils atteignent cette fin si légitime Les colons partiaires, muselés par leurs propriétaires, de telle façon que ces derniers ont toujours la part la plus franche du produit territorial, sont encore dans une détresse plus grande. Privations de tous genres, grande misère, telle est leur triste condition. Les bergers sont pour le moins aussi malheureux. Payés en céréales par leurs maîtres, ils sont liés à leur troupeau de manière à ne pas le quitter quelquefois, ni le jour ni la nuit, souvent pas même pour dormir ; s’ils ont femme et enfants, tout le grain de leur gage, et souvent même au-delà, est absorbé par la consommation de la maison ; et si, dans son engagement, il gagne en espèces une soixantaine de francs par an, il en a à peine assez pour le lard, les sardines, etc., qui doivent alimenter sa famille. Détresse et pénurie, tel est son partage. Voilà les individus que frappe la pellagre, car elle s’attache à la misère comme l’ombre suit le corps. Aussi point de pellagreux chez les propriétaires des landes, qui sont les hauts et puissants seigneurs du dix-neuvième siècle. Ils sont à la féodalité ce que la pellagre est à la lèpre. Grandissez les dispositions des uns, augmentez et généralisez la cause de l’autre, et vous aurez remis nos landes comme elles étaient il y a trois siècles.
Comme la maladie commence par les mains, qu’elle n’attaque que les cultivateurs et les bergers, serait-il possible qu’il y eût, dans les champs ou dans les landes, quelque plante ou quelque insecte assez vénéneux pour la produire ? Mais le territoire de La Teste, étant en tout semblable à celui du reste du littoral, doit contenir les mêmes plantes et les mêmes insectes ; or, le mal n’existant pas dans cette commune, je dois dire que je ne suis pas encore arrivé à sa cause. Pourrait-elle exister, cette cause, dans la malpropreté ? Oui, je pense qu’elle est là. Non point dans cette malpropreté générale au village, mais dans une malpropreté particulière, et que je vais exposer. La Teste n’a aucun troupeau de brebis. Tous les ferments des terres y sont composés de plantes marines, de fumier de vaches et de chevaux. Dans toutes les autres communes, au contraire, presque tous les ferments pour les terres labourables se tirent du fumier de brebis ; mais les vignes reçoivent d’autres engrais, ainsi que je le dirai plus bas.
Les bergers de ces communes, et souvent les cultivateurs, se vêtissent de peaux de brebis non tannées, et qu’on ne lave jamais.
Après avoir réfléchi longtemps et bien analysé la situation de tous les cultivateurs, des bergers et des pâtres de tout le pays, je n’ai pu voir d’autre différence notable entre eux que celle que je viens d’établir, et j’ai cru voir en cela la cause de la maladie. On sera disposé à partager mon sentiment lorsqu’on aura fait, sans prévention, la même analyse.
Mais il est encore deux choses qui sont bien faites pour corroborer mon opinion, que du reste je n’embrasse point avec opiniâtreté.
Voici la première : on cultive beaucoup la vigne à Gujan, principalement dans le quartier de Mestras, où il y a grand nombre de personnes qui ne font que cette culture, et qui n’ont que de faibles rapports avec les cultivateurs des terres labourables, presque tous situés dans deux quartiers éloignés, qu’on nomme Laruade et Meyran. Ces vignerons de Mestras ne se servent point du fumier de brebis pour leurs vignes, mais ils les engraissent avec des terres argilo-salines, prises sur les bords du bassin. Eh bien, aucun de ces vignerons n’a la maladie. On dirait que la providence a voulu laisser ainsi des distinctions frappantes dans sa marche, pour qu’on pût en mieux découvrir la source.
La seconde chose et peut-être la plus importante, la voici : je m’étais souvent informé à des bergers si les brebis étaient sujettes à des maladies particulières, pour savoir si quelqu’une aurait du rapport à celle qui m’occupe ; mais, soit ignorance, soit manque de mémoire de leur part, ils ne m’avaient cité que la clavelée et une sorte de tournoiement de tête, occasionné par des hydatides, développées dans les sinus frontaux, pour la guérison desquelles hydatides (soit dit en passant), ces rustres bergers appliquent très bien le trépan, sans d’autres instruments qu’un petit couteau. Je n’avais point vu dans ces maladies rien qui ressemblât à celle qui faisait l’objet de mes recherches ; car, le tournoiement de tête des brebis me paraissant produit presque par une cause mécanique, je ne lui voyais aucune similitude avec celui de mes malades. Mais ayant depuis peu pris de nouvelles informations, j’ai su d’un berger que quelquefois, dans l’été, quelques brebis mouraient d’une forte diarrhée, accompagnée d’une rougeur dans l’intérieur des cuisses. Si cela est, ne pourrait-ce pas être la véritable cause ? On sait que les bergers soignent leur brebis malades, et qu’ils les écorchent, lorsqu’elles sont mortes, pour en avoir les peaux. Il doit paraître très vraisemblable qu’ils peuvent prendre celle maladie, si elle est susceptible de s’inoculer.
La maladie est-elle contagieuse ? L’exemple de Jeanne Dutruch, celui des époux Degraves, et celui de la nièce Condon, semblent répondre affirmativement à cette question ; cependant je crois qu’il faut encore du temps et de nouvelles expériences pour être entièrement fixé à ce sujet. S’il parait très probable que ces personnes avaient pris la maladie sur d’autres qui en étaient atteintes, je ne dois point taire que j’ai d’autres exemples très récents qui peuvent faire naître quelques doutes. Les nommés Deycard et Brouchet, à Gujan, quartier de Laruade, ont la maladie ; ils sont mariés et ont des enfants. Leurs femmes, qui couchent avec eux, ne sont point atteintes, et leurs filles ainées le sont. La veuve Deligey, de Meyran, a un garçon et deux filles nubiles ; la plus jeune a la maladie et quoique sa mère et sa sœur aient couché avec elle, elles ne l’ont point. Serait-ce qu’elle reste longtemps à se montrer après s’être inoculée ? Des observations ultérieures pourront l’apprendre.
Qu’elle soit contagieuse ou non, il est certain qu’elle est très répandue ; qu’elle doit sa naissance à une cause lente dans ses effets, mais terrible, et qu’il est instant de tâcher d’en prévenir les funestes résultats. On a vu le traitement, à la vérité très incomplet, que je lui ai opposé ; mais on doit aussi sentir que je ne pouvais mieux faire. Une maladie peu connue, son haut degré lorsqu’on m’appelait, la grande distance qui me séparait des malades, souvent leur misère, leur peu de soumission, leur incurie, la démence qui leur survenait, mes autres occupations, tout cela formait une masse d’obstacles qu’avec le plus grand zèle je ne pouvais vaincre.
Pour porter des secours salutaires à ces malades, il faudrait les réunir dans un hospice, ou les soigner à domicile. Dans ce dernier cas, il ne suffirait point de leur prodiguer les secours de l’art, mais encore il faudrait, le plus souvent, pourvoir à tous les besoins de leur existence.
« La maladie a disparu avec l’amélioration du sort des habitants qui a coïncidé avec l’assainissement des landes et leur mise en valeur …. En fait, la pellagre était une maladie sociale et même l‘archétype de ce type d‘affection.»
Il s’agit d’une carence sévère en vitamines liée à la misère et à la mauvaise alimentation générale des malades. « Les conditions de vie très dures, l’ignorance de l’hygiène, certaines conditions climatiques défavorables entraînaient la carence en vitamines PP [ou vitamine B3] par ration alimentaire insuffisante. Ceci n’était pas lié au travail mais à l’absence de rentabilité du travail. Dès qu’il y eut amélioration des conditions de vie, l’avitaminose disparut et avec elle la maladie ».
Des travaux confirmèrent que le maïs n’était pas en cause : la vitamine B3 y est présente mais elle nécessite une méthode de préparation différente de celle utilisée par les landais. Les Aztèques se nourrissaient également de maïs : ils le faisaient tremper préalablement dans l’eau de chaux. Cette méthode permettait l’assimilation par l’organisme de la vitamine en cause.
Actes de l’Académie royale des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux, 1846
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k33942q/f390.item.r=%22le%20teich%22#
Les Landes girondines ; Une note sur l’alios, Frédéric Vassillière (1840-19..), 1892
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9615336r/f61.item.r=%22le%20teich%22#
https://famillepopineau.wordpress.com/2015/03/11/la-pellagre-des-landes/