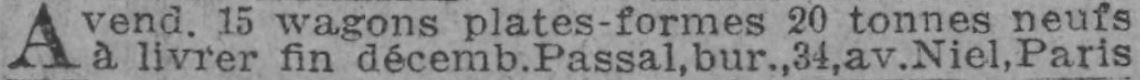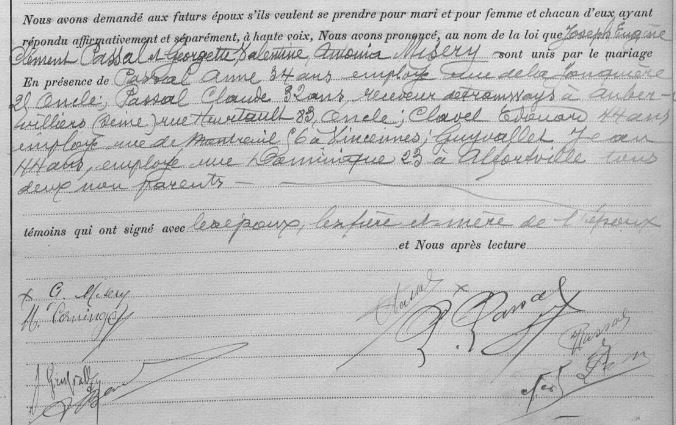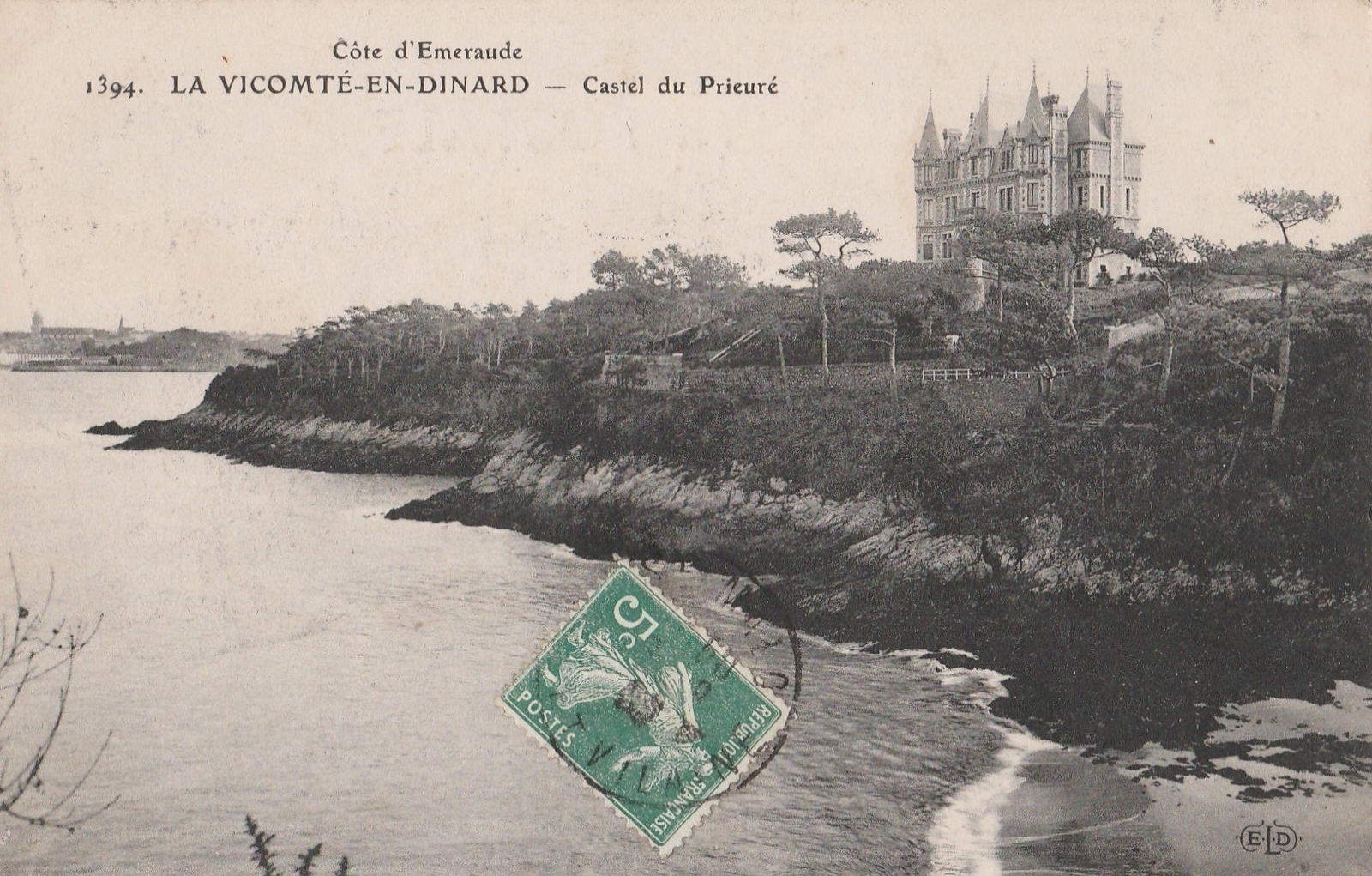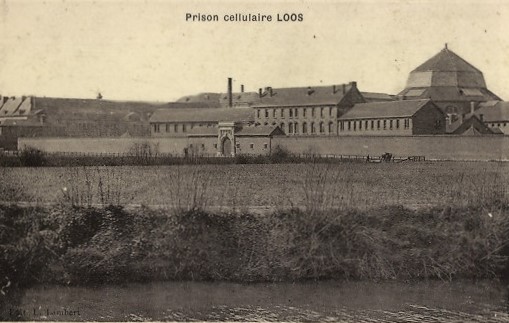Faux aristocrate mais véritable escroc rivalisant d’imagination pour dépouiller ses victimes, ses nombreux stratagèmes firent la Une des plus grands journaux de l’entre-deux-guerres.
Joseph Eugène Clément Passal, dit le « marquis de Champaubert », est un aventurier français né le 29 septembre 1892 à Saint-Denis (Seine), et mort le 2 octobre 1929.
1911 – Passal est professeur dans un skating bordelais
Clément Passal est professeur dans un skating bordelais; il est l’ami d’une jeune et jolie femme, Marguerite d’Orsel, véritable virtuose du patin, qu’il dit avoir épousée dans les Basses-Pyrénées.
Il passe toute une saison à Bordeaux et, par son habileté, réussit à être introduit dans un grand nombre de familles de l’aristocratie des Chartrons.
En 1913, il quitte Bordeaux pour Paris.
L’Ouest-Éclair, Emmanuel Desgrées du Lou, (1867-1933). Directeur de publication, 2 octobre 1924
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k647781d/f2.item.r=passal%20fourniture%20wagon%201916.zoom#
En 1912, après avoir été exempté de service militaire par le conseil de révision du 10ème arrondissement de Paris, il se fait réformer frauduleusement en 1914 et ne participe pas à la Première Guerre mondiale.
Une fabrique de matériel roulant à Facture-Biganos
À la suite de l’enquête ouverte dans le Bordelais, concernant une escroquerie commise à Facture-Biganos, il est établi que la fabrique de matériel roulant est installée vers le milieu de l’année 1919 à Facture-Biganos sous le véritable nom de l’escroc Clément Passal.
Comme le manque de wagons se fait alors particulièrement sentir, Clément Passal achète, à Tours au cours du vieux matériel, et fait fabriquer, plutôt mal que bien, des wagons qu’il vend à raison de 8 à 10 000 francs pièce.
Comme il en a livré 24, de nouvelles commandes affluent : vingt-six clients demandent bientôt 40 wagons pour lesquels ils versent 240 000 francs d’avance.
 Dès qu’il est en possession de cette somme, Clément Passal, qui habite avec une amie l’Hôtel Terminus à Facture-Biganos, disparait.
Dès qu’il est en possession de cette somme, Clément Passal, qui habite avec une amie l’Hôtel Terminus à Facture-Biganos, disparait.
L’escroc est alors marié[1] depuis 1912 avec Georgette Valentine Antonia Misery 1894-1979, fille de Charles Gustave Misery, ingénieur résidant à Deuil-la-Barre (Seine-et-Oise). Cette union n’empêche pas Clément Passal de vivre maritalement, à Facture-Biganos, avec une jeune femme brune, Denise Delorme, née à Paris et connue sous le nom de Loulou.
[1] – Mariage dissous par jugement du 7 juillet 1926 par le tribunal civil de Rouen. Georgette se remarie le 24 septembre 1932 avec Eugène Bouron †, puis le 25 janvier 1947 avec Joseph Gassler †. Geneanet
L’Ouest-Éclair du 8 octobre 1924
La Bourboule, été 1920, professeur de danse
En 1917, j’étais une midinette très connue dans les établissements de nuit, notamment « Au Canari », bar d’un music-hall du faubourg Montmartre, chaque soir, jusqu’au 31 juillet, je viens danser dans cet établissement. Un jour, dans le métro, je vois un jeune homme très brun, très bien, qui me regardait ; je le regarde aussi. Nous ne fîmes que cela, tout le long du parcours. Il descendit à l’Opéra ; moi je continuai. Nous ne nous étions pas dit un mot. Eh ! bien, vous allez voir : le soir du même jour, je monte dans un tramway, place de la Madeleine, et qui est-ce que je retrouve ? Mon compagnon de route de midi ! Cette fois, nous avons fait connaissance. La destinée, quoi !
Depuis l’époque de la réouverture du bar, le 15 septembre, on n’a pas revu la jeune femme. C’est ainsi que Marie-Louise Noirait, va être attachée à Clément Passal comme son ombre…
À cette époque, seul de la corporation de professeurs de danse dans la station, le « couple », Passal alias Henry de Vaudrey et sa maîtresse, a une nombreuse clientèle et réalise un bénéfice de 40 000 francs, dit-on, tant au Casino qu’à l’hôtel Briston où il a loué une salle.
Les affaires se gâtent en fin de saison : un jeune homme très brun, à œil de verre, nommé Thibertin, et dit Bertin le Borgne, est engagé par de Vaudrey pour le seconder ; et en plein Casino la belle Gisèle, dans un match de boxe qui ne figure pas au programme, l’envoie sur le parquet d’un swing magistral. À la suite de cet incident, le professeur de danse voit sa clientèle diminuer peu à peu : les mères de famille ne se soucient pas que la belle Gisèle puisse enseigner ainsi le noble art à leurs filles.
En quittant La Bourboule, le couple déclare qu’il se rend à Néris-les-Bains où il a un engagement au Casino ; on l’y trouve en 1922. C’est là qu’il se fait adresser sa correspondance, poste restante. Bertin accompagne ses amis à Néris.
Au mois d’octobre1922, le couple va à Montluçon où il ouvre un nouveau dancing, mais cette nouvelle exploitation ne donne pas de résultat.
On le sait, peu de temps après la saison, Thibertin finit tragiquement assassiné par sa maîtresse à son retour à Paris dans des circonstances mystérieuses qui défraient longuement la chronique scandaleuse de l’époque.
Le drame aurait éclaté à la suite des révélations apportées par une lettre sur la conduite du borgne à la Bourboule. Cette lettre ne fut-elle pas écrite par Gisèle ou par Vaudrey ? C’est, ce qu’il sera, sans doute, curieux de rechercher…
La France de Bordeaux et du Sud-Ouest, 30 septembre 1924
Hyères – au parfum !
Apparu au XVIIIe siècle en Europe occidentale par fascination pour l’Empire ottoman, l’orientalisme prend de l’ampleur à la faveur de l’expansion colonialiste. [Notons que pour les européens occidentaux que nous sommes, l’Orient est un concept général faisant fi de la géographie puisqu’il englobe à la fois le Maghreb et le Moyen-Orient.]
Touchant tous les courants artistiques et mélangeant allègrement les styles, les civilisations et les époques, l’orientalisme n’est pas sans créer de nombreux clichés. Mais n’en retenons ici que l’aspect créatif…
À partir des années 1830, cet esthétisme est largement adopté par les établissements de loisirs pour épater leur clientèle. À Paris, les cafés se font turcs et mauresques et les bains publics orientaux. Mais cet engouement exotique dépasse bientôt le cadre de la capitale et de la décoration intérieure ; on le retrouvera même à Arcachon ! Mais la riviera, de par son climat proche à celui de l’Afrique du Nord, est le terrain privilégié de constructions orientalistes. Les expositions universelles, bien sûr, dont certains édifices sont d’ailleurs directement issus, mais aussi de nombreuses publications spécialisées sont les influenceuses de l’époque !
D’origine très modeste, Alexis Godillot (1816-1893) fait fortune en créant plusieurs entreprises commerciales et industrielles, et surtout en devenant le fournisseur officiel des régimes politiques successifs entre les années 1830 les années 1890. Si son nom vous rappelle celui de chaussures militaires, ce n’est pas un hasard !
Partageant son temps, comme de nombreuses personnalités de l’époque, entre Paris et la Côte d’Azur, il découvre Hyères vers 1860 et tombe immédiatement sous le charme. Rapidement, Alexis Godillot devient le plus important promoteur et propriétaire foncier de la commune où il mène grand train. Même la reine Victoria d’Angleterre lui rend visite lors de son séjour en 1892. Visionnaire, il entame également l’aménagement du littoral, prévoyant le proche développement du tourisme estival.
Mais plusieurs de ses projets restent inachevés car sa réussite éclatante n’est pas sans irriter et susciter la jalousie, ce qui lui vaut nombre de procès et d’échecs politiques. Si, pour ces raisons, il ne devient jamais maire de la ville, son nom reste attaché à cette dernière qui lui doit une large part de son patrimoine (architectural, végétal et urbain).
Depuis la fin du XVIIIe siècle, Hyères se développe grâce à l’aristocratie anglaise en quête de soleil. Afin de fidéliser cette riche clientèle et d’en attirer de nouvelles, Alexis Godillot décide de transformer la ville, avec son architecte Pierre Chapoulart (1849-1903), en créant dans sa partie ouest un vaste et élégant domaine privé (quartier des îles d’Or) fait de parcs et de larges avenues bordées de luxueuses villas et de grands hôtels, plantées de palmiers et agrémentées de fontaines, de lampadaires et de bancs.
Parmi les très nombreuses constructions que l’on doit à Pierre Chapoulart, deux se distinguent par leur architecture de style orientaliste : la villa mauresque et la villa tunisienne.
La villa mauresque, maison de villégiature, est réalisée en 1881 pour Alexis Godillot qui l’utilise pour ses réceptions et la loue aux riches hivernants.
Si, par commodité, elle est imaginée sur une structure classique contemporaine (salon, salle à manger, cuisine et bureau organisés au rez-de-chaussée autour d’un vestibule ; chambres à l’étage ; ouvertures sur le jardin et non sur des espaces intérieurs), c’est dans la créativité de son ornementation (arcs ; arabesques ; belvédère-minaret à coupole ; frises géométriques en carreaux de faïence…) et sa végétation (palmiers, orangers, yuccas…) que l’Orient donne toute sa mesure.
 Trois ans plus tard, en 1884, Pierre Chapoulart, réalise cette fois pour lui-même la villa Tunisienne où il élit domicile et installe également son agence. Même s’il n’a jamais quitté l’Europe, il construit aussi de nombreuses autres villas de ce type, de Nice à Marseille.
Trois ans plus tard, en 1884, Pierre Chapoulart, réalise cette fois pour lui-même la villa Tunisienne où il élit domicile et installe également son agence. Même s’il n’a jamais quitté l’Europe, il construit aussi de nombreuses autres villas de ce type, de Nice à Marseille.
Cette villa, de volumétrie composite symétrique compte trois niveaux. L’entrée est marquée par un perron avec portique surmonte d’un balcon. Les façades présentent un décor de ciment moulé rehaussé de polychromie, largement décoré d’arcs outrepassés, de merlons, carreaux de faïence, ornement géométriques en ciment. Le belvédère a une coupole en cuivre. Les pièces de réception du premier étage sont organisées autour d’un patio à l’origine à ciel ouvert. L’ensemble y est traité avec beaucoup de soin. La villa est accompagnée d’un jardin d’agrément. Le couple Passal reste dans cette villa environ un an et demi.
En 1918, la fille Noirait quitte Paris pour habiter à Hyères, avec Clément Passal sous le nom d’Henri de Vaudrey. Ils jettent leur dévolu sur la villa Tunisienne, 1 avenue Andrée-David-de-Beauregard.
En octobre 1920, Passal est à nouveau à Hyères ; comme à La Bourboule, et autrefois à Hyères même, il se fait encore appeler Henri de Vaudrey. Avenue de Belgique, il monte une parfumerie outillée à la moderne et fait à cette occasion une publicité dont les frais s’élèvent à 245 000 francs. Il embauche un chimiste du nom de Caillat et à grand renfort de publicité lance deux parfums qu’il baptise « Cœur pâmé » et « Démon d’amour », ainsi qu’une poudre et une crème « Cœur de Lys ».
 Le couple séjourne à la villa « Blanche-Pierre », 14 rue Victor-Hugo. Toujours d’architecture éclectique et en retrait par rapport à l’espace public, c’est une villa de trois niveaux, dont un étage de comble, aux volumes composites. L’encadrement des baies, les bandeaux ainsi que les angles sont marqués par des décors de brique. La toiture est à fort débord de rive sur potence.
Le couple séjourne à la villa « Blanche-Pierre », 14 rue Victor-Hugo. Toujours d’architecture éclectique et en retrait par rapport à l’espace public, c’est une villa de trois niveaux, dont un étage de comble, aux volumes composites. L’encadrement des baies, les bandeaux ainsi que les angles sont marqués par des décors de brique. La toiture est à fort débord de rive sur potence.
Henri de Vaudrey subvient à tous les besoins de Gisèle jusqu’à ce que celle-ci le quitte.
Il dépose son bilan en 1921 : le passif s’élève à 835 573 francs mais obtient un concordat et réussit à faire patienter ses créanciers, car il attend, dit-il, de gros capitaux.
https://carnets-mediterraneens.com/un-souffle-dorient-sur-hyeres/
L’Ouest-Éclair du 28 septembre 1924
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5846421/f3.item.r=%22Henri%20de%20Vaudrey%22.zoom#
Le Temps, 8 octobre 1924
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9ment_Passal
Marseille – Toujours au parfum
Par la police privée, Passal fait rechercher Gisèle sous prétexte qu’elle lui a volé un bijou. C’est à Marseille qu’il la retrouve alors qu’elle va se marier avec un monsieur à qui elle a fait « casquer » 15 000 francs.
Clément Passal et Marie-Louise Noirait se remettent en couple. Ils demeurent à Marseille de mars à septembre 1922. Clément achète une automobile de 28 800 francs.
 À cette époque se déroule l’Exposition coloniale, dont la première pierre a été posée neuf ans plus tôt, par Raymond Poincaré, le 12 octobre 1913 sur l’ancien terrain militaire du Prado, l’actuel Parc Chanot. Son succès n’est pas lié seulement aux intérêts du négoce, il est également dû à l’attrait d’un monde qui à l’époque parait mystérieux.
À cette époque se déroule l’Exposition coloniale, dont la première pierre a été posée neuf ans plus tôt, par Raymond Poincaré, le 12 octobre 1913 sur l’ancien terrain militaire du Prado, l’actuel Parc Chanot. Son succès n’est pas lié seulement aux intérêts du négoce, il est également dû à l’attrait d’un monde qui à l’époque parait mystérieux.
Véritable zoo humain, les Expositions Coloniales sont à l’articulation de trois processus : la construction d’un imaginaire social de l’Autre, la théorisation scientifique de la « hiérarchie des races », et l’édification d’un Empire colonial alors en pleins expansion. Ce sont des lieux au centre desquels se place la mise en scène de la différence : c’est l’invention du sauvage. En vérité, on fabrique un monde qui n’a aucun rapport avec le réel. Quand les Kanaks arriveront à Paris en 1931, on leur demande d’arrêter leurs chants chrétiens, car cela ne colle pas avec l’image du sauvage cannibale. On fabrique tout un environnement qui correspond à l’univers qu’on présuppose qu’un sauvage doit avoir : la hutte, le village, les danses, etc.
Néanmoins, la Grande Guerre puis les premiers mouvements de décolonisation ont changé les données. Les mentalités vis-à-vis de nos colonies ont évolué. L’indigène est, à présent, regardé davantage comme un partenaire que comme un serviteur ; on s’intéresse à sa culture pour elle-même et on souhaite la préserver.
Paradoxe : l’attitude des Marseillais prêts à se ruer pour voir des « indigènes » ou des « Orientaux » en situation à l’Exposition coloniale ou lors d’exhibitions ponctuelles, mais méprisant ces mêmes « étrangers » qui souhaitent s’installer dans leur ville.
Isabelle Richefort conclut ainsi son livre Désirs d’ailleurs : « Si les critiques portèrent sur la mise en scène convenue et stéréotypée de l’indigène ainsi que sur la volonté des organisateurs de démontrer la légitimité de la colonisation, l’exposition a témoigné d’une réelle reconnaissance d’autres cultures et d’autres modes de vie ». À l’exception de l’Humanité, critique vis-à-vis de l’esprit colonialiste français, la presse couvre avec enthousiasme toutes les étapes de cette manifestation.
Passal y loue un pavillon ; Gisèle de Gisors se montre sur le stand avec des bijoux de grande valeur. Passal expose sa parfumerie qu’il se fait livrer par des commerçants de la ville, ainsi que de Toulon, Hyères, Grasse ; des marchandises qu’il ne paye pas !
Le Peuple du 8 octobre 1924
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4696181c/f3.item.r=%22Henri%20de%20Vaudrey%22.zoom
https://www.tourisme-marseille.com/fiche/exposition-coloniale-1922-marseille/
Nantes – 1922 – « Canadian Motor & Co Ld »
Nous trouvons ensuite le « couple » Passal à Nantes. Installé rue Babonneau, Clément Passal, sous le nom de Gabriel Gouraud, vend à crédit des automobiles comme représentant de la Canadian Motor Co. Là, les bénéfices sont certains !
 Gouraud fait envoyer un nombre important de catalogues très luxueux (il y en a pour 10 000 francs qui ne seront naturellement jamais payés à l’éditeur) et une page entière de publicité également faite dans un journal sportif : « Une surprise sensationnelle ! et une bonne nouvelle ! Nous prions tout spécialement nos lecteurs désireux de faire l’achat d’une voiture, d’une voiturette ou d’une motocyclette de luxe sérieuse, puissante, souple, confortable et silencieuse, de prendre connaissance et de méditer l’annonce que la « Canadian Motor Co Ltd » où sont indiqués les prix spéciaux sensationnels et les conditions de paiement extraordinaires qui sont consentis par cette puissante firme, exceptionnellement pendant la durée du Salon français, en vue d’obtenir la diffusion rapide et certaine, en France, en vue d’obtenir ses Modèles qui ont déjà fait leurs preuves outre-Atlantique. Aucune personne ayant besoin d’une voiture, d’une voiturette ou d’une motocyclette sérieuse ne laissera échapper cette occasion qui ne se représentera certainement jamais.
Gouraud fait envoyer un nombre important de catalogues très luxueux (il y en a pour 10 000 francs qui ne seront naturellement jamais payés à l’éditeur) et une page entière de publicité également faite dans un journal sportif : « Une surprise sensationnelle ! et une bonne nouvelle ! Nous prions tout spécialement nos lecteurs désireux de faire l’achat d’une voiture, d’une voiturette ou d’une motocyclette de luxe sérieuse, puissante, souple, confortable et silencieuse, de prendre connaissance et de méditer l’annonce que la « Canadian Motor Co Ltd » où sont indiqués les prix spéciaux sensationnels et les conditions de paiement extraordinaires qui sont consentis par cette puissante firme, exceptionnellement pendant la durée du Salon français, en vue d’obtenir la diffusion rapide et certaine, en France, en vue d’obtenir ses Modèles qui ont déjà fait leurs preuves outre-Atlantique. Aucune personne ayant besoin d’une voiture, d’une voiturette ou d’une motocyclette sérieuse ne laissera échapper cette occasion qui ne se représentera certainement jamais.
Des retards étant survenus dans l’envoi des premières machines, celles-ci n’ont pu être présentées au Salon. La « Canadian Motor Co Ltd » prendra sa revanche aux prochains Salons anglais et belge, en novembre, décembre, janvier et février prochain. »
L’avantage du client est extraordinaire : cette publicité déclenche ses premières commandes pour lesquelles il se fait remettre des arrhes pour des automobiles dont il n’effectuera jamais la livraison.
Par une adresse remarquable, Giraud-Passal demande à chaque acheteur de lui fournir cinq noms de personnes solvables auxquelles il envoie naturellement ses catalogues, faisant en quelque sorte boule de neige.
Son installation 3, rue Deshoulières est plus que modeste, dans le local pour lequel Marie-Laure Noiret a signé un bail sous le nom de Mme Gouraud.
Dans ce local, Gouraud ne reçoit jamais les clients ; mais il a fait percer, dans le plafond, un judas par lequel il surveille les conversations. Ce judas lui permet d’entendre la réclamation du client qui dépose la première plainte et de prendre la fuite sans attendre celles, qui devaient se poursuivre par la suite.
Gouraud dégoûté de son affaire emporte un viatique de 200 000 francs.
Il reçoit ensuite par la poste pour 600 000 francs de nouveaux mandats. S’il est vrai qu’il aurait pu les encaisser, pourquoi ne l’a-t-il pas fait ? Simplement parce qu’il ne sut ou n’osa pas négocier en banque les nombreux chèques barrés qu’il avait reçus des commettants en acompte sur le prix de voitures « Canadian Motor & Co Ld » qu’ils ne devaient jamais recevoir.
Si « fort », si averti que fut l’aigrefin de la psychologie de ses contemporains, son éducation commerciale parait avoir cependant présenté une lacune. Car il lui était facile, en consignant l’argent en banque, de se faire ouvrir un compte de dépôt, qui lui eut permis en moins de quarante-huit heures, le télégraphe aidant, de négocier ses chèques, ou tout au moins une partie d’entre eux afin que l’attention ne fut pas éveillée.
De ce côté, Gabriel Gouraud, alias de Champaubert, a manqué de hardiesse, ou, simplement, de connaissances commerciales.
L’imprudence perd souvent les audacieux. Gouraud vient d’en faire l’expérience, et pourra sans doute méditer, de longues années, avec amertume, la véracité de cet aphorisme.
Il n’empêche qu’il ait, si l’on peut dire, rénové l’escroquerie. Ses devanciers usaient généralement de la vente pour atteindre à leurs fins frauduleuses. Gouraud a pratiqué l’escroquerie « à l’achat ». Ses offres de service extrêmement avantageuses, lancées par toute la France, dans une période particulièrement opportune, puisque le Salon de l’Automobile se tenait alors Paris, et appuyées d’une publicité malhonnête, mais intelligemment conçue et propagée, lui ont valu, durant neuf jours, une avalanche de commandes et d’envois d’argent.
Plaçons ici une anecdote dont fait les frais un brave et honorable garagiste d’Algérie. Cet excellent homme envoie de l’argent à l’escroc « valeur en comptes pour recevoir une licence « Canadian Motor Ld ». Il désire être accrédité dans toute la colonie comme agent de l’imaginaire compagnie américaine ; et, pour décider Gouraud, il lui adresse sa photographie, en même temps qu’un chèque ! « Jugez par vous-même, lui écrit cet homme crédule, si j’ai bonne figure et si je mérite de vous représenter ! »
En somme, Gabriel Gouraud est dans la vérité, quand il déclare que le coup de Nantes ne lui a pas rapporté beaucoup (tout, est relatif). Rappelons que l’on a seulement retrouvé, 3, rue Deshoulières, après le départ le 14 septembre du chevalier d’industrie pour « la chasse à la perdrix », un peigne cassé, un flacon vide de parfum, un autre demi-plein, un élixir odontalgique, et enfin une chemise de nuit, actif évidemment maigre au regard des francs d’escroqueries, et d’autres menues indélicatesses consistant en de nombreuses dettes.
Car si les anciens employés du faux ingénieur-représentant attendent encore leurs appointements, il y a des fournisseurs qui attendent aussi, avec la certitude d’attendre ad vitam aeternam, le règlement de leur facture.
Henri Desgrange (1865-1940), Directeur de publication, L’Auto-vélo du 5 octobre 1922
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4629062p/f3.item.r=%22Canadian%20Motor%20C%22.zoom#
L’Ouest-Éclair du 22 juillet 1926
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6116611/f5.item.r=passal.zoom#
Saint-Aubin-Jouxte-Bouleng – 1922
Passal, alias André Simonin, loue à Saint-Aubin-Jouxte-Bouleng (Saint-Aubin-lès-Elbeuf depuis 1931), localité située en face d’Elbeuf, sur la rive gauche de la Seine, une propriété pour l’élevage des pigeons, propriété où il vit avec sa femme et sa mère.
Marie-Louise Noirait vient en février 1923 habiter Elbeuf. Elle demeure au Grand Hôtel pendant trois ou quatre mois, sous le nom de Blanche Calmel ; au mois de juin, elle va habiter rue Céleste, où, dans une petite propriété acquise à son nom, vient d’être édifié un pavillon. Henri de Vaudrey subvient à ses besoins et vient la voir presque journellement.
Passal dépense de grosses sommes pour se livrer a l’élevage des pigeons. Cette affaire ne lui rapporte guère et il vit d’escroqueries.
Comme le commerce de pigeons finalement périclite, il décide de cesser ses opérations.
Lille – novembre 1923 à janvier 1924
L’escroc de haut vol n’est pas un personnage très familier à Lille ; il ne fréquente presque personne, et n’y séjournera que peu de temps.
D’ailleurs, hâtons-nous de le dire, les personnes dont il fait connaissance, n’ont pas à se louer de leur nouvelle relation, car toutes, ou peu s’en faut, sont victimes de celui que l’on peut considérer justement comme l’as de l’escroquerie.
Le 10 novembre 1923, un monsieur fort élégamment vêtu, âgé d’une trentaine d’années, conclue un bail de neuf ans avec le directeur du Café de la Paix, 9, Grande-Place, et prend aussitôt possession d’un vaste appartement situé au second étage « pour y installer, dit-il, les bureaux d’une importante firme de T.S.F. ».
De fait, il installe des bureaux, luxueusement meublés, surtout ceux où a accès le public ; il se réserve une petite chambre où sont des meubles très simples : lit pliant, table de bois blanc, une cuvette et un pot à eau dépareillés ; c’est le logis, le « private » de M. Jean-Marie Patté, c’est ainsi que déclare s’appeler le nouveau directeur du « Radio-Imperator » la grande marque de radiophonie qui vient de naître de son imagination fertile.
Un panneau de vastes dimensions s’étale sur la façade : « Radio-Imperator » et une plaque de cuivre sur la porte extérieure du rez-de-chaussée annonce : « J.-M. Patté, constructeur, 2e étage ». Des appareils de T-S-F. sont exposés dans les bureaux. Cinq employés et un directeur recrutés par le locataire à des appointements mirifiques, entrent en fonctions : une grande firme est née !
 Une publicité parait dans Le Petit Parisien du 20 décembre 1923
Une publicité parait dans Le Petit Parisien du 20 décembre 1923
Fabricant / Marque / Modèle: Radio-Impérator – Patté, Éts. de Radiotéléphonie J.M.; Lille
Modèle de table, boitier, normalement avec couvercle (pas de panneau incliné). Boitier en bois. Année: 1923/1924
Poste à 5 lampes extérieures.
Principe général Récepteur TRF en général (avec ou sans réaction inconnu)
Gammes d’ondes OM (PO) et OL (GO).
Particularités
Tension / type courant Piles (rechargeables ou/et sèches)
Haut-parleur – For headphones or amp.
Puissance de sortie
Prix de mise sur le marché 750.00 FRF
L’affaire est florissante, de nombreux clients viennent au bureau et achètent des appareils ; quelques-uns sont livrés, mais d’autres commandes, très nombreuses celles-ci, restent en souffrance, malgré l’argent souscrit d’avance par les clients trop confiants.
Vers la Noël 1923, ce M. Patté, déjà coté sur la Place, se rend chez M. Boutry, bijoutier, rue des Manneliers,
Comment parler de la joaillerie Boutry sans évoquer au préalable sa magnifique façade et sa vitrine Art Nouveau qui semble sortir du temps ? Sans doute, le plus ancien bijoutier de Lille… date de 1896. On y trouve de nombreux bijoux en or et en argent massif mais aussi de l’horlogerie : montres de poche, montres, cartels et bric-à-brac… On peut aussi réparer des objets horlogers. Vous trouverez également de magnifiques pièces d’argent ou des lampes pour lampes tulipes. Un bijou classique, mais qui sait harmoniser ses bijoux avec le temps et la mode actuelle.
Patté y choisit un riche collier de perles, une jolie bague, deux boutons d’or ornés de brillants, le tout d’une valeur de 155 000 fr. « Je suis, déclare-t-il, le directeur du « Radio-Imperator », dont le siège est sur la Grande-Place qui ne se nomme pas encore Charles de Gaulle ; voici un chèque sur le Crédit Lyonnais, vous le ferez encaisser. » La scène se passe samedi soir. Quand le bijoutier se présente à la banque le lundi matin, il apprend que Patté n’y a hélas aucune provision ; c’est la douche froide et notre bijoutier ne peut que porter plainte…
M. Abbe, commissaire de police du 1er arrondissement, fait une perquisition dans les bureaux de la « Radio-Imperator », le directeur général est absent ; on l’attend. Il ne revient jamais. Les employés ne revoient plus leur patron, les clients ne seront jamais servis. Une grande partie de l’installation ne sera pas payée, le grand hôtel du centre où l’escroc avait pris pension n’est pas indemnisé. La grande firme a vécu !
M. le Directeur a levé le pied en emportant la caisse, naturellement.
L’escroc avait essayé de faire le même coup chez deux autres bijoutiers, mais ceux-ci, plus méfiants, n’ont pas voulu accepter de chèques en paiement.
L’affaire, est-il besoin de le dire, fait grand bruit, et un mandat d’arrêt est lancé contre l’escroc, qui a déjà accompli un grand nombre de méfaits pareils, le montant des préjudices est estimé à 300 000 francs.
Le Grand écho du Nord de la France, 6 octobre 1929
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9ment_Passal
https://www.radiomuseum.org/r/patte_radio_imperator.html
Le Havre – de Pâques au 15 juillet 1924
Clément Passal demeure avec Marie-Louise Noirait, dans un appartement meublé, boulevard Albert-1er au Havre ; Marie-Louise a également un appartement 25 rue Raspail. Clément Passal roule en automobile et offre pour 20 000 francs de bijoux à sa maîtresse.
Clément Passal alias William Gardner se présente comme l’importateur exclusif pour la France, la Belgique et leurs colonies, d’appareils de pesage qu’il présente avantageusement dans des prospectus distribués chez de nombreux commerçants havrais ; place Gambetta, il ouvre un bureau d’importation de bascules automatiques américaines de marque Cincinnati. Il encaisse le tiers du prix de vente à la commande et, comme dans les affaires précédentes, les matériels commandés ne seront jamais livrés.
C’est au moment où les réclamations commencent à s’accumuler sur son bureau, que Passal-Gardner disparaît de la ville à la mi-juillet mais cette fois sans avoir réussi à encaisser les 50 000 francs de mandats qui l’attendent à la Poste mais sur lesquels la Police, alertée par certains commerçants, a fait opposition.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9ment_Passal
Phare de la Loire du 1er octobre 1924
Paramé
Dans la première quinzaine d’août 1924, Passal décide d’aller à Saint-Malo. Il y loue sous le nom de M. et de Mme Lamy, avenue Saint-Roch à Paramé, la villa « Les Frênes », appartenant à un Foncerais. Cette villa, louée et payée jusqu’au 30 septembre, était vide depuis environ cinq semaines.
Passal y reçoit des produits pharmaceutiques qu’on retrouvera au Prieuré.
M. Courcoux, commissaire de police, qui rentrera plus tard dans la villa « Les Frênes » pour faire les recherches, n’y trouvera que des feuilles de papier à lettre au nom de Robert Lamy, chimiste-vétérinaire, ainsi que plusieurs lettres de fournisseurs. En se référant aux dates, il semble que les Passal, après avoir séjourné à Paramé, en sont repartis pour une destination inconnue avant de se rendre à Dinard.
Dinard – Le Guet-apens du Prieuré
La scène se passe en septembre 1924 à l’entrée d’un grand hôtel de Dinard. Un homme portant des vêtements achetés chez un grand couturier et dont le veston est orné du célèbre ruban rouge, symbole de la légion d’honneur, attise les regards curieux. Entre fierté et mépris, il affiche la mine imbue que certains privilégiés aiment arborer face à ceux qu’ils considèrent comme étant leurs inférieurs. Le réceptionniste a l’habitude de ce genre de personnages. Et pourtant, cette fois-ci, quelque chose semble clocher. Peut-être un accent un brin « populo » ou l’esquisse d’un geste grossier qui ne collent pas avec l’allure générale de l’inconnu. À moins que ce ne soit le carton qu’il présente à l’employé et sur lequel est noté : « Marquis de Champaubert, chevalier de la Légion d’honneur, administrateur délégué des mines de Phuond-Do, administrateur général des mines de Uyen-Kuang et de Thaï-Nguyen (Tonkin) ».
 La première chose que fait un coquefredouille qui veut faire ses orges dans les poches du voisin, c’est de troquer son nom roturier contre un titre. Il s’appelait tout simplement Passal. Bon ! Par la grâce de l’alphabet, il devient le marquis de Champaubert. Ouvrez le ban ! Et les gogos qui n’eussent pas apporté dix sous au déplorable Passal, mitrailleront de leurs économies l’escroc coiffé d’une auréole de bataille.
La première chose que fait un coquefredouille qui veut faire ses orges dans les poches du voisin, c’est de troquer son nom roturier contre un titre. Il s’appelait tout simplement Passal. Bon ! Par la grâce de l’alphabet, il devient le marquis de Champaubert. Ouvrez le ban ! Et les gogos qui n’eussent pas apporté dix sous au déplorable Passal, mitrailleront de leurs économies l’escroc coiffé d’une auréole de bataille.
C’est la même méthode dans la galanterie et la vaticination : Mélanie Patonflara se transforme en Gabrielle d’Etampes ou Lucienne Tocsin de la Saint-Barthélémy. Quand on prend du galon… Si vous vous nommez tout crûment Hélène Radis, vous aurez beau percer les ténèbres de l’avenir, lire comme votre journal dans les tarots, le blanc d’œuf et le marc de café, vous ne ferez pas un radis. Mais donnez-vous du Mme de Thèbes, de Syracuse, de Delphes, de Corinthe, et les amateurs d’astrologie assiégeront votre rue et feront la queue, de l’aube à la nuit, sur les marches de votre escalier.
Autre métamorphose : tout illettré orne du titre de gendelettre ses cartes de visite. Tel qui n’a jamais rien publié se donne du publiciste. Je ne parle pas des banquiers qui n’ont tenu de banque qu’au baccara dans les estaminets.
Quoiqu’il en soit, notre « marquis de Champaubert » ne réussit pas à en imposer à M. Rivelli, directeur de l’Hôtel Royal, où il descend. L’affectation qu’il apporte à baiser la main de Gisèle de Gisors qu’il fait passer pour sa femme, chaque fois qu’il rentre, après une absence de l’hôtel plus ou moins longue ou s’il prend congé de sa complice, celle qu’il appelle, à propos de tout et de rien, « marquise » et cela très fort afin que tout le monde l’entende ; le dédain avec lequel il traite la domesticité ne manque pas de le rendre suspect aux yeux de M. Rivelli.
L’aristocrate explique à qui veut l’entendre qu’il est de retour en métropole après un long séjour en Asie du Sud-Est.
Après avoir séjourné à l’hôtel – où il se fait aussi remarquer par ses généreux pourboires -, le marquis entend louer une villa dans la célèbre station balnéaire, très en vogue à cette époque. Il se présente dans les différentes agences de Dinard où l’on gardera de lui un souvenir très précis. Ce qu’il veut, c’est une villa confortable, mais entourée d’un grand jardin.
Lorsqu’on lui propose le « Castel du Prieuré », une villa de style néo-gothique construite au début du siècle, sur la pointe de la Vicomté, isolé de plusieurs centaines de mètres de l’hôtel Beauvallon et du couvent du Prieuré, il déclare aussitôt « Cela fera parfaitement mon affaire » ; il règle aussitôt les 14 000 francs, prix de la location pour deux mois. M. le marquis de Champaubert déclare qu’il vient chercher à Dinard la tranquillité et le repos. Il arrive du Tonkin, avec la marquise très déprimée par le climat indochinois, et tous les deux veulent se refaire des fatigues de la vie coloniale. À vrai dire, M. le Marquis parait assez bien reposé. De taille au-dessus de la moyenne, 1 m 70 environ, portant beau avec un costume de bonne coupe, il donne toutefois l’impression qu’il ne possède pas un titre nobiliaire remontant bien loin. Par contre, Mme la Marquise, jeune femme d’une grande beauté, porte avec aisance un superbe vêtement de loutre et des bijoux qui n’ont rien de criard. Un des agents de location déclare qu’il a eu, en voyant ce couple, l’impression d’une femme du monde tombée entre les mains d’un aventurier qui l’a enlevée et qu’elle entretient. De fait, M. le Marquis, d’une politesse recherchée, « trop poli pour être honnête » dit le proverbe, conserve, dans son allure générale, quelque chose de suspect sentant l’aventurier ou le parvenu.
Mais M. le Marquis a le portefeuille bien garni. Il règle tout rubis sur l’ongle, comme on dit à Bordeaux (c’est-à-dire jusqu’à la dernière goutte du précieux breuvage) avec une désinvolture de grand seigneur et ceux qui se trouvent en relations avec lui n’en demandent pas davantage.
Avant de jeter son dévolu sur le castel du Prieuré, le marquis avait voulu habiter Saint-Servan. Par l’intermédiaire d’agents de location, il s’était trouvé le 9 septembre en relations avec Me Alexandre Sulblé, notaire à Saint-Servan, qui lui offrit la location d’un château situé à proximité de la Rance. Rendez-vous fut pris avec le propriétaire bien connu dans nos villes et, le jeudi 11 septembre, M. le Marquis et Mme la Marquise arrivaient à Saint-Servan, venant de Dinard, dans une superbe conduite intérieure que pilotait un chauffeur de maitre.
La visite de la propriété a lieu. L’étang qui s’y trouve retient l’attention du marquis qui s’informe de sa profondeur. Les sous-sols avec des murs très épais, la salle de billard et l’ensemble de la propriété lui plaisent. Le prix de 5 000 fr par mois est aussitôt accepté mais une première difficulté intervient au sujet de la date d’entrée en jouissance. M. la Marquis veut le lundi suivant ; cinq domestiques, avec des malles, attendaient à Marseille un ordre télégraphique pour arriver aussitôt.
Cette formalité aplanie, le marquis posa ensuite d’autres conditions : il voulait que les jardiniers n’aient le droit de circulation que dans le potager et l’accès au parc un jour par semaine qu’il fixerait lui-même. Le propriétaire répondit à ces exigences qu’il se réservait le droit de visite à sa propriété non seulement dans 1e parc, mais, encore, dans le château. Les pourparlers se terminèrent alors et, le soir, le propriétaire téléphonait au marquis qu’il considérait l’affaire comme rompue.
Ayant loué l’aimable logis sous le nom de marquis de Champaubert, Clément Passal s’y rend avec la véritable Mme Passal, née Georgette Misery, confinée dans le rôle de cuisinière, manquant par trop d’élégance pour personnifier la « marquise de Champaubert», rôle dévolu à Marie-Louise Noirait, dite Gisèle de Gisors, qui passe pour l’épouse du grand seigneur.
Le marquis est très généreux en pourboires : « Il ne donne pas moins de dix francs aux chauffeurs rien que pour le conduire à la Vicomté »
À vouloir paraître trop distingué, le « marquis de Champaubert » finit par attirer l’attention sur lui, mais pas à son profit. Le propriétaire d’un des plus importants garages de Dinard nous disait, hier : « Cet individu est venu plusieurs fois à la maison demander une auto pour le conduire au Prieuré, mais jamais, à le voir vêtu de façon aussi ordinaire et toujours des mêmes effets, je ne l’aurais pris pour un monsieur portant un nom à particule. »
À peine installé, Passal se met en devoir d’aménager le château à sa manière : deux chambres du sous-sol sont capitonnées avec des matelas ; au plafond, dans chacune des pièces, sans respect pour le chêne ciré, le marquis y pratique deux trous de quinze centimètres carrés. L’une de ces ouvertures donne dans le salon, l’autre dans la salle de billard. Un tuyau de caoutchouc – pendant encore à travers le plâtre gisants comme de larges serpents sur le beau parquet du salon et de la salle de billard – communique avec un pulvérisateur dont l’usage honnête et normal est de sulfater les vignes, mais que Passal destine à un autre usage.
Des détails, pour Georgette Misery, qui parait bien lors de son séjour à Dinard s’en être toujours tenue au rôle de la soubrette, n’en sont pas moins significatifs ; ils montrent que Georgette venant passer une commande déterminée chez M. Herbert, suit exactement les ordres qui lui sont donnés par son seigneur et maître le marquis de Champaubert. C’est elle qui apporte de Saint-Aubin la pompe Vermorel, qui prête la main à tous les préparatifs du Marquis, qui va commander les robinets nécessaires chez M. Herbert.
On doit à Victor Vermorel l’invention de « l’éclair », pulvérisateur dorsal et manuel qui porte son nom, passé dans le langage courant. Fait entièrement de cuivre, il sert à la pulvérisation de la bouillie bordelaise contre le mildiou.
Passionné par la traction automobile, en 1908, il conçoit un véhicule pour la compétition, qu’il engage dans la course de côte du Mont Ventoux, la plus dure épreuve existant alors. La Vermorel arrive en tête et remporte à nouveau la victoire, quelques jours après au Mont Pilat.
Passal rapatrie de Paramé les soixante-dix kilos de « produits pharmaceutiques ». Pour pouvoir contempler leur effet sur ses prochaines victimes, le marquis fait un autre petit trou, grand comme une pièce de dix sous. De plus, il installe l’électricité dans les deux pièces du sous-sol ; la lumière est commandée de l’extérieur. Enfin un tableau, représentant Vénus sortant de l’onde, est amené dans une des pièces d’opération, sans doute pour adoucir la captivité des captifs par des visions d’art.
Le marquis écrit à différents joailliers parisiens, leur demandant d’apporter au castel des bijoux, colliers, rivières et bagues qu’il projette, dit-il, d’offrir à la marquise pour son trente-cinquième printemps, le 26 septembre 1924. Le marquis indique que le prix du collier ou de la rivière ne doit pas dépasser 800 000 francs et celui des bagues 300 000 francs.
Les jours passent et l’étonnante discrétion des aristocrates intrigue le voisinage. Nul ne les voit sortir en cette saison estivale pourtant propice aux balades sur le littoral. Sans compter les bruits étranges provenant de la propriété, comme si l’on effectuait des travaux au sein de la villa. La police malouine est informée. Le commissaire spécial Schwab (ou Schwob) décide alors de mener sa petite enquête en toute discrétion.
Mais qui est donc ce fichu marquis de Champaubert ? C’est rapidement la question qui se pose. Son nom est inconnu des fichiers de la « Maison ». Plus étrange ou inquiétant, la consultation du gotha du Bottin mondain est aussi vaine. Enfin, la Grande Chancellerie est formelle : aucune légion d’honneur n’a été délivrée à un individu portant ce titre.
La constatation est dès lors évidente : le marquis est un escroc ! Le commissaire malouin en est d’autant plus convaincu qu’après avoir mené des investigations en région parisienne, il apprend avec stupéfaction que le marquis a invité des grands joailliers de la capitale à venir lui présenter ses plus belles pièces dans sa villa dinardaise.
Un piège est alors tendu au faux marquis ; les joaillers donnent rendez-vous dans un café de la ville. Ils ne sont pas seuls mais accompagnés de policiers. Bien leur en a pris.
Passal passe à table : c’est ainsi qu’il paraît que l’organisateur du traquenard est, en réalité, un nommé Joseph Eugène Clément Passal, qui a déjà été condamné à cinq ans de prison à Paris pour escroquerie. Il est originaire de Paris, et a fait ses études à l’école Diderot.
Lorsque, mercredi, à 6 heures du soir, les inspecteurs Bonny et Royère, après avoir arrêté Passal, se présentent au Prieuré, on sait comment la bonne refuse péremptoirement de leur ouvrir la grille du castel. Mme la marquise est au lit, malade ; je n’ouvrirai qu’à M. le marquis.
Cette bonne, si dévouée, n’est autre que la femme de Passal, Georgette Misery, née le 29 avril 1894, à Deuil, et que l’escroc épousa en justes noces à Paris, le 28 décembre 1912. Le rôle de celle-ci dans l’affaire parait assez obscur. Elle porte le tablier blanc et considérait d’un œil indifférent celle qui remplissait le rôle qu’elle eût dû jouer, celui de marquise. Mais il ne semble pas qu’elle en tenait rigueur à son mari, car la famille à trois faisait en définitive assez bon ménage. Chacun faisait abstraction de ses rancunes particulières pour le bien-être commun et les deux femmes avaient pleine confiance dans l’ingéniosité et dans l’étoile du marquis. Aucun détail n’était négligé pour cela et il s’agissait d’en imposer aux visiteurs. Aussi lorsque les fournisseurs pénétraient dans la cuisine pouvaient-ils voir un paravent sur lequel étaient représentées les armes du marquis de Champaubert. Pauvre blason ! Comme il aurait aujourd’hui besoin d’être redoré depuis que les titres et parchemins se sont envolés dans le courant d’air produit lors de l’ouverture des portes du castel par des policiers curieux par profession.
Quant à la marquise, les inspecteurs n’en trouvent pas trace. Celle qui jouait ce rôle pendant l’installation du marquis au château en est partie la veille, le mardi 16 septembre. C’était l’amie de Passal, Marie-Louise Noirait, qui a pris le nom de Gisèle de Gisors pour des raisons plus ou moins théâtrales et artistiques. La jeune femme est partie pour Paris où elle passe la journée, couche à l’hôtel du Quai d’Orsay, et réintègre ensuite Elbeuf avec la fameuse valise d’argenterie volée au Prieuré.
La visite de la villa leur est aussi enrichissante qu’invraisemblable. Toutes les ouvertures sont calfeutrées avec des matelas et des couvertures, le moindre interstice bouché. Les policiers découvrent alors une surprenante installation reliée à un tuyautage permettant d’acheminer un gaz de chloroforme qui aurait servi à asphyxier les joailliers afin de s’emparer de leurs collections.
Les policiers poursuivent leur enquête et il est à prévoir que le passé mystérieux de Passal leur donnera encore bien du travail. Le 27 septembre, M. Barbedaine, inspecteur de la brigade mobile, malgré un temps fâcheux, photographie la chambre des supplices du castel du Prieuré et tous les détails de l’ingénieuse machination montée de toute pièce par le pseudo-marquis ; puis à la prison, il photographie le marquis et sa femme, Georgette Misery. L’aventurier n’avait pas été mensuré depuis ses derniers démêlés avec la justice, qui remontent à plusieurs années. C’est que depuis, il a quelque peu changé, il a surtout, engraissé.
Au cours d’une nouvelle perquisition au Prieuré, on trouve dans le garage du château une puissante automobile, qui est prête à partir, avec son plein d’essence, et sur laquelle on relève deux numéros, le 284-7-9 recouvrant le 11411-Y-S.
Sinon le million de bijoux promis par le « marquis », le commissaire Vidal a du moins offert à sa femme, pour son anniversaire, une petite promenade en mer. Les gendarmes prennent place dans une vaste automobile que M. Vidal a réquisitionnée et, qui, cependant, ne doit pas être encore assez grande pour contenir tout le monde, si bien que des policiers sont installés sur des marchepieds. Avec un faux-col souple, son chapeau et son pardessus d’un gris trop clair, le « marquis » a une allure misérable. Ses regards sont inquiets et il obéit docilement à ses gardes du corps. Sa femme qui le suit – une blonde assez boulotte – enroulée dans un manteau également gris, a encore l’air plus misérable que lui. Au moment où tout le monde va monter dans l’auto, il aperçoit M. Dessoudex, le propriétaire du castel du Prieuré, dont il a fait la connaissance au temps de sa fugitive splendeur. Cette rencontre émeut beaucoup l’aventurier qui fond en larmes et, se tournant vers M. Dessoudex, lui demande à plusieurs reprises pardon pour le mal qu’il lui a causé. Enfin voyageurs et bagages sont casés tant bien que mal dans l’auto qui, quelques minutes après, s’arrête devant l’embarcadère des vedettes pour Saint-Malo. C’est par une vedette à vapeur, au milieu des voyageurs ordinaires, mais entourés d’une importante escorte de policiers, que le « marquis de Champaubert » et sa femme légitime, domestique d’occasion, sont conduits le 27 septembre 1924, de Dinard au parquet de Saint-Malo. À cinq heures, en effet, les pêcheurs et baigneurs réunis sur le port d’embarquement des vedettes blanches voient descendre d’une automobile bondée de voyageurs jusque sur le marchepied, le marquis de Champeaubert et sa cuisinière-femme légitime. Le « marquis » n’a pas plus bel air que la cuisinière. Le marquis et sa femme s’embarquent et vont s’installer à l’arrière, en s’exhortant mutuellement à avoir du courage. La vedette démarre ; « Hé le marquis, crie un vieux marin avec une voix habituée à dominer la bourrasque, tu nous enverras des pigeons » : ce fut toute l’oraison funèbre de Dinard et ses seigneurs en simili.
C’est un petit homme trapu, aux yeux inquiets, au nez rougeoyant, qui a abandonné toute sa superbe, avec son ruban rouge et son monocle cerclé d’or. Sa femme est bien la grosse blonde, un peu molasse, qui forme avec l’espiègle Gisèle aux cheveux courts le piquant contraste qu’affectionne le faux gentilhomme. Tous deux pleurnichent lamentablement dans la vedette n° 5 qui, par mer moutonneuse, se dirige, en se balançant fortement, vers les remparts de Saint-Malo.
Après une courte traversée, assez durement secoués par une forte houle, Passal et sa femme arrivent enfin au Palais de Justice de Saint-Malo ; il est près, de 5 heures lorsque Passal en franchit le seuil.
Aussitôt M. Boucly, juge d’instruction, leur fait subir, en présence de M. Savidan, procureur de la République, et Vidal, un premier interrogatoire.
Passal ne fait aucune difficulté pour répondre aux questions du magistrat et il retrace ainsi les grandes lignes de son orageuse existence. Elevé à l’école professionnelle Diderot, de 1907 à 1910, il se prépare à une honnête vie de travail lorsque se laissant entraîner sur la pente fatale.
Pressé de questions, par le magistrat qui a été solidement documenté, il avoue avoir exercé, à son domicile avenue Niel aux Ternes à Paris, sous son vrai nom de Passal, une entreprise de wagons-plateformes implantée à Facture-Biganos, gérée de telle façon qu’elle lui valut d’être sous le coup d’un mandat d’amener du parquet de la Seine et une condamnation par défaut à cinq ans de prison, échappant malgré, cela à la justice. Mais ses déboires ne l’ont pas empêché d’aller monter à Hyères, en octobre 1920, une fabrique de parfumerie qui tomba en faillite.
On connait la suite de son itinéraire.
Abordant le récit de la dernière affaire, Passal renouvelle les aveux qu’il a déjà faits à M. Vidal ; la mine de plus en plus piteuse, il reconnait tous les préparatifs que l’on sait, mais il assure encore, très fort, que jamais il n’a eu l’intention de tuer, que d’ailleurs toutes ses précautions ont été prises pour qu’il n’y eut pas mort d’hommes.
pleurant et s’exhortant à nouveau au calme et au courage.
Le stratagème démasqué, le marquis donne d’amples détails sur la façon dont il voulait opérer : « Ma foi, puisque je suis pris, déclare-t-il aux inspecteurs Bonny et Royère, autant que vous connaissiez toute l’histoire.
Voilà. J’ai quitté Saint-Aubin (Seine-inférieure) où je suis éleveur de pigeons, le 13 août dernier. Je suis parti en auto pour Paris, où j’ai retrouvé mon amie Gisèle de Gisors dans le hall d’un grand hôtel des boulevards. Nous nous sommes rendus à Saint-Malo, où j’ai d’abord loué pour deux mois la villa les Frênes. Pendant mon séjour, l’idée m’est venue de tenter un coup intéressant. J’ai donc loué le « Prieuré » pour trois mois, jusqu’à Noël, moyennant quatorze mille francs. J’avais dit au propriétaire, M. D… que la marquise était souffrante et que nous venions pour nous reposer.
J’ai écrit, comme vous le savez, aux bijoutiers parisiens et, en attendant leurs réponses, je me suis mis à préparer le castel.
Je ne voulais pas répandre de sang ; je me serais contenté d’anesthésier les envoyés des joailliers, Dès leur arrivée, je les aurais reçus dans le salon, leur aurais fait faire le tour du propriétaire, admirer la vue splendide sur la Rance, jusqu’à la terrasse, et une fois là, devant la porte du sous-sol, je leur aurais dit : « Maintenant, messieurs, je vais vous conduire à la marquise. »
J’aurais ajouté avoir oublié la clef de la porte de l’escalier et, faisant seulement semblant d’appeler la bonne, je me serais dirigé vers la sortie. Là, j’aurais vivement refermé la porte – vous avez pu voir que j’avais posé un verrou extérieur qui permet de boucler plus rapidement qu’avec une clef.
Tandis que les pauvres diables auraient vainement crié, personne n’aurait pu entendre avec mes murs capitonnés et essayé d’ouvrir portes et fenêtres, dont les crémones étaient vissées et les ouvertures comblées par des planches et des matelas, je montais dans la salle de billard et en avant la pompe ! Oh ! je serais allé doucement. De temps en temps, j’aurais regardé par le petit trou. Quand ils auraient été endormis, je me serais emparé des bijoux, puis j’aurais préparé mon auto, dans laquelle cent vingt litres d’essence et deux bidons d’huile me permettraient de faire du chemin. Après quoi, j’aurais aéré la pièce au chloroforme et allongé les anesthésiés sur des divans pour qu’ils soient très « confortables ». Quand ils se seraient réveillés, j’aurais été loin. »
Le faux marquis de Champeaubert avoue cyniquement le coup qu’il avait préparé : « Mais je ne voulais pas répandre le sang, précise-t-il, je me serais contenté d’anesthésier les joailliers quand ils se seraient réveillés, j’aurais été loin »
Passal a fait preuve d’ingéniosité pour la façon dont il a réussi à obtenir ces « produits pharmaceutiques » alors que le commun des mortels serait dans l’impossibilité de s’en procurer un centigramme sans ordonnance d’un médecin.
« Ce fut tout simple, dit-il ; ayant loué la villa des Frênes, sous le nom de Robert-Lamy, je me suis fait faire du papier à lettres à en-têtes, au même nom, avec comme profession : vétérinaire-chimiste. Sur le vu de cet en-tête, on m’a envoyé tout ce que j’ai demandé.
Attention en manipulant les caisses de chloroforme, poursuit l’inculpé, c’est dangereux. »
Le chloroforme provenait des usines Lambiotte à Prémery (Nièvre). La façon dont l’escroc s’appropria la marchandise vaut d’ailleurs la peine d’être contée : le pseudo marquis sitôt informé de l’arrivée en gare de Saint-Malo des caisses de chloroforme se rendit une nuit sur les voies de triage et prit livraison de l’anesthésiant sans être inquiété par personne. Puis quelques jours après il s’informa de l’arrivée des colis et le chef de gare après enquête dut déclarer qu’il y avait perte. Le marquis se fit alors indemniser et, l’argent en poche, il rentra chez lui satisfait de sa journée.
Le juge annonce alors à l’aventurier que sa maîtresse, Gisèle de Gisors, vient elle aussi d’être arrêtée. « Pauvre petite, elle n’a rien fait », s’écrie Passal dont le visage s’inonde à nouveau de larmes. « La malheureuse, elle est comme moi, elle n’a pas de chance », gémit à son tour Mme Passal qui semble s’apitoyer plus qu’on aurait pu le supposer sur le sort de sa rivale. Enfin, l’aventurier reprend la parole pour gémir sur le sort de sa mère restée seule à Saint-Aubin-Jouxte-Boulleng, dans la Seine-Inférieure. « Sans moi, que va-t-elle devenir ? » se lamente-t-il. Le juge clôture alors l’interrogatoire de Passal qui, tour à tour ajusteur, industriel, parfumeur, pharmacien, vétérinaire-chimiste et « marquis », prend le chemin de la prison.
Dans les couloirs du Palais de Justice, une scène, émouvante se déroule encore entre l’aventurier et sa femme légitime, tous deux s’embrassant longuement.
Le faux marquis de Champaubert et sa femme sont transférés à Saint-Malo, et écroués à la prison de la Victoire. Ils sont poursuivis pour tentative d’assassinat, faux en écritures publiques, escroquerie, port illégal de décorations, et complicité.
 L’entrée du marquis de Champaubert à la Victoire ne passe pas inaperçue vendredi soir à Saint-Malo. Une foule nombreuse stationne, vers 8 heures, rue Saint-Benoit, où l’on sait que le couple aventurier va passer pour se rendre à l’hôtel meublé de la rue de la Victoire, où sont déjà passés tant de criminels dont les annales judiciaires conservent le souvenir.
L’entrée du marquis de Champaubert à la Victoire ne passe pas inaperçue vendredi soir à Saint-Malo. Une foule nombreuse stationne, vers 8 heures, rue Saint-Benoit, où l’on sait que le couple aventurier va passer pour se rendre à l’hôtel meublé de la rue de la Victoire, où sont déjà passés tant de criminels dont les annales judiciaires conservent le souvenir.
La prison qui intra-muros appelée « Prison de la Victoire » est bâtie entre 1823 et 1825 à la place d’un ancien couvent. Fermée en 1931, elle est remplacée par la prison de l’ « Espérance » ; que de drôles de noms pour des prisons ! La porte d’entrée existe toujours ; c’est une porte d’accès de l’École nationale supérieure maritime (ENSM).
La foule, on le sait, est sans pitié, tout comme les enfants. Les lazzis pleuvent donc sur le marquis dégonflé que les inspecteurs emmènent. Un loustic lance cette phrase, boutade pas très spirituelle, mais qui amusa « Il est trop gras, faudra le faire jeuner. » Et, les rires d’éclater pendant qu’on écroue Joseph Passal, dit Gouraud, Simonin et Champaubert.
L’aventurier auquel le bat-flanc du poste de gendarmerie, pendant deux jours, et surtout deux nuits, avait paru plutôt dur, retrouve avec plaisir un lit, le modeste couchage de nos vieilles prisons. Sans doute ce n’est plus les lits moelleux du castel du Prieuré, mais dans la vie il faut savoir s’accommoder aux circonstances.
Se voyant pris, il juge que la franchise est peut-être le meilleur moyen de s’en tirer. Nous avons dit hier qu’il a avoué la plupart des faits qu’on lui reproche. Il n’a tiqué, jusqu’ici que sur la provenance de son automobile, auto qui n’est pas celle qu’il amena à Dinard et qui le conduisit au château de Saint-Servan, où nous avons relaté sa visite.
Depuis son arrestation Passal couche en dortoir et se plaint du bout de ses lèvres dédaigneuses d’une certaine promiscuité qui l’a gratiné de parasites sautillants ; il désirerait une chambre à part et de son côté sa femme exprime le même désir.
L’enquête se poursuit afin de savoir si Passal, ne serait pas aussi Gabriel Gouraud, l’escroc de Nantes, comme on le soupçonne fortement. Ce point sera élucidé dès que l’affaire de Dinard sera elle-même tirée au clair.
Puisque nous parlons de Dinard, réparons un oubli relativement au rôle joué par la gendarmerie. Depuis mercredi soir, date de l’arrestation du faux marquis et de sa femme, tout le personnel de la brigade ne cessa de se dépenser, montrant le plus grand zèle à faire aboutir les recherches entreprises. Cette activité est dans la tradition de la gendarmerie ; elle méritait cependant d’être signalée.
L’enquête révèle alors que ce fameux Passal n’en est pas à son coup d’essai. Bien au contraire. Il a endossé différentes identités et passé sa vie à élaborer des stratagèmes pour escroquer aristocrates et bourgeois aux quatre coins de la France. Pour la petite histoire, notre « Arsène Lupin MacGyver » s’est même déjà illustré dans les environs proches, à Paramé, en se faisant passer pour un éminent pharmacien ! Et le plus incroyable, c’est qu’avant cet épisode dinardais, il a toujours réussi à échapper à la police, en dépit d’escroqueries s’élevant à plusieurs centaines de milliers de francs.
Le 27 septembre 1924, le contrôle général des services des recherches judiciaires continue activement son enquête sur délégation de M. le Juge d’instruction de Saint-Malo au sujet de l’affaire Gouraud. Des perquisitions ont été effectuées aujourd’hui au domicile de Gouraud, alias Simonin, à Saint-Aubin (Seine-Inférieure), ainsi qu’au domicile de sa maîtresse, Mlle Noirait, dite Gisèle de Gisors, arrêtée hier à Elbeuf.
La sûreté générale a déjà envoyé partout le signalement de la pseudo-marquise de Champeaubert, quand lui parvient la nouvelle que cette femme a été retrouvée, dans la matinée, à Elbeuf, par M. Meslin, commissaire de police de cette ville. Ce magistrat, en lisant les journaux, est frappé de la concordance d’état-civil du nommé André Simonin, « éleveur de pigeons dans la Seine-inférieure », avec un éleveur de pigeons portant le même nom, habitant Saint-Aubin-Jouxte-Boulleng. Or M. Meslin sait que Simonin a une amie, habitant, 2 bis, rue Céleste, à Elbeuf, sous de nom de Blanche Calmel. Accompagné de son secrétaire. M. Déparrois, il s’y rend.
La pseudo Blanche Calmel reconnait sans peine qu’elle vient de Dinard, où elle a joué le rôle de la marquise. Au cours de la perquisition, le commissaire trouve dans une valise fermée à clef une quantité d’objets en argent, couteaux, fourchettes, cuillers, plats à hors-d’œuvre, etc., et un sous-main en cuir de Russie. La femme déclare que ces objets proviennent du Prieuré. Passal dira plus tard que c’est à l’insu de sa maîtresse qu’il a placé dans la valise de celle-ci le linge et l’argenterie dérobés du Prieuré.
Conduite au commissariat, elle décline son identité véritable, Marie-Louise Noirait, dite Gisèle de Gisors, et dite encore Blanche Calmel, née à Soissons le 13 mars 1896 et demeurant à Elbeuf depuis deux ans. Elle déclare avoir connu son ami à Paris en mai 1917, sous le nom d’Albert Passal. Il se donnait comme ingénieur et habitait 46 boulevard de la Chapelle.
Quelques mois après, dit-elle, j’étais son amie et j’allais habiter à Paris, 76 boulevard Pereire. En 1918, nous quittâmes Paris pour habiter Hyères, dans une villa louée par mon ami sous le nom d’Henri de Vaudrey. Nous y restâmes un an. Au bout de ce temps, reprend-elle, mon ami voulut reprendre la vie familiale avec sa femme et sa mère. J’avais de mon côté loué une petite villa à Elbeuf, sous le nom de Gisèle de Gisors.
[…]
Poursuivant son enquête, M. Vidal, commissaire à la sûreté générale, a fait procéder à des perquisitions à Saint-Aubin et à Elbeuf, aux domiciles respectifs de Passal, alias Simonin, alias « marquis » de Champeaubert, et à celui de Marie-Louise Noirait, dite Gisèle de Gisors, son amie.
À Saint-Aubin, on a retrouvé une torpédo à quatre places, qui, avec la voiture retrouvée au Prieuré, porte déjà à deux le nombre des automobiles du « marquis ».
À Elbeuf, on a découvert une quantité considérable de linge, provenant du prieuré que « Champeaubert », qui, vraisemblablement, trouvait qu’aucun profit n’était négligeable, avait « déménagé » le jour même où il prit possession du castel.
D’autre part, M. Vidal a reçu la visite d’un joaillier, M. Haimet, dont les magasins sont installés 4, rue de la Chaussée-d‘Antin. Le commerçant est venu lui faire part d’une affaire de bijoux qu’il avait traitée avec « Champeaubert ». Celui-ci, qu’accompagnait Gisèle de Gisors, s’était donné au bijoutier, comme étant M. Simonin, riche négociant, voulant se défaire de quelques bijoux que sa femme ne trouvait plus à son goût. Un collier de perles fines, deux bagues avec diamant, et une barrette en diamants furent ainsi achetés par M. Haimet, pour le prix de 80 000 francs.
Simonin, contrairement à l’habitude qu’ont les escrocs de vendre sans discussion, en avait ardemment débattu le prix, ce qui mit en confiance le bijoutier. Au surplus, ajouta M. Haimet, comment aurais-je pu douter de la qualité de M. Simonin, qui arriva à mon magasin, dans une splendide voiture pilotée par un chauffeur à livrée fort élégante.
Il est probable que bijoux et automobile ont été volés par « Champeaubert » et le magistrat cherche à retrouver les propriétaires des uns et de l’autre.
Ajoutons que Gisèle de Gisors qui, jusqu’ici, s’était défendue d’avoir joué un rôle actif dans la machination préparée par « Champeaubert » a été confondue par M. Vidal. Ce commissaire a, en effet, établi que Gisèle de Gisors s’était rendue chez M. Millard, quincaillier à Elbeuf, pour y faire l’acquisition du pulvérisateur destiné à envoyer le chloroforme dans la « chambre d’asphyxie », mais elle avait renoncé à son achat par suite de l’insuffisance de puissance de l’appareil qui lui avait été présenté.
Indiquons en outre que les enquêteurs pensent que Passal ne serait autre que l’escroc Gardner qui, au Havre, monta l’affaire des bascules automatiques, réplique de la fameuse affaire de la « Canadian Motor » de Nantes.
Joseph Passal vient de faire choix de Me Gasnier-Duparc, maire de Saint-Malo, pour l’assister à l’instruction ; sa femme a demandé à Me Marjot des Clos de défendre sa cause.
Après avoir recueilli ses aveux, M. Meslin téléphone à la sureté générale, qui ordonne l’arrestation de Marie-Louise Noirait.
La soi-disant marquise de Champaubert arrive le 27 septembre 1924 à Rouen. Son passage à travers les rues de la ville reste inaperçu. Les rares curieux qui ont pu la dévisager la dépeignent comme une jeune femme brune, assez jolie, portant fort bien une toilette élégante. Conduite au Parquet, elle y subit un interrogatoire de pure forme au cours duquel elle reconnait que c’est bien d’elle qu’il est question à propos de l’affaire de Dinard ; Gisèle de Gisors est ensuite reconduite à la prison de Bonne-Nouvelle, qu’elle quittera lundi ou mardi pour gagner Saint-Malo.
1er octobre 1924. Pendant que le marquis de Champaubert et Georgette attendent, à la Victoire, l’arrivée de Gisèle où sa présence ne saurait tarder, la justice fait rechercher un peu partout les traces du passage de l’aventurier et de ses deux femmes.
- Schwab et Coureaud enquêtent sur la Côte d’Émeraude ; M. Vidal et les inspecteurs de la Sûreté générale opèrent de leur côté à Paris ; et un peu partout, à Rouen, au Havre, Elbeuf et à Lille notamment, des policiers travaillent sur commission rogatoire du parquet de St-Malo.
Un des points qui va être élucidé en premier lieu, c’est la façon dont Passal se procure tous les papiers d’identité trouvés en sa possession. On croit qu’il les a fabriqués lui-même. Lors de son arrestation, on le trouve porteur d’une pièce militaire au nom de « de Champaubert ». Il s’agit d’un certificat dit de position militaire portant tous les cachets nécessaires.
Cette pièce, pour un profane, paraît parfaitement en règle. Or, les gendarmes de Dinard qui l’ont examinée, signalèrent au marquis une erreur impardonnable. En effet, le cachet portant les mots Recrutement de la Seine eût été très régulier s’il se fut agi d’un bureau de recrutement d’un département quelconque ; il ne peut l’être pour la Seine, dont les bureaux de recrutement ont tous un numéro. Passal ignorait ce léger détail, connu de tous les gendarmes de France.
Et l’histoire de ce certificat de position militaire montre bien que l’aventurier fabriqua lui-même les différents papiers d’identité trouvés en sa possession : déjà l’inculpation de faux, relevée contre lui, est suffisante pour le conduire devant la Cour d’Assises, puisqu’il est prouvé par ailleurs que Passal s’est servi des papiers au nom de Champaubert pour toucher à la poste de Dinard, les 5 000 francs que Gisèle de Gisors lui a envoyés en prenant le nom de Dessoudex, celui du propriétaire du Castel du Prieuré.
Et maintenant comment le « Marquis » fabriqua-t-il toutes les fausses pièces trouvées en sa possession ? C’est, croit-on, assez simple. Il a composé des phrases contenant les lettres nécessaires pour faire les mots Commissariat, mairie, bureau de recrutement, etc. et en possession des lettres de cuivre nécessaires, qu’il a pu trouver assez facilement, il les a ensuite soudées pour les disposer autour de l’effigie de la République figurant sur les cachets officiels, et il a ainsi obtenu tout ce qui lui était nécessaire à la fabrication des papiers officiels.
Il ne s’est trompé qu’une fois, comme nous le disions plus haut, pour son certificat de position militaire, au nom de Champaubert. Par contre, ses pièces militaires, au nom de Simonin étaient des plus régulières. D’ailleurs son erreur s’explique par le fait que Passal a été exempté du service militaire. Ce gaillard de 32 ans, qui arborait si fièrement la Légion d’honneur, n’aurait pas fait la guerre !
Le 3 octobre 1924, Gisèle de Gisors arrive à huit heures du soir à Saint-Malo, par un train omnibus, entre deux gendarmes qui l’accompagnent depuis Rouen. L’amie du faux marquis de Champaubert est conduite à la prison de la Victoire. Après les formalités d’écrou, la jeune femme, vêtue avec une élégance discrète, est enfermée dans un local voisin de celui occupé par Mme Passal. On sait que l’amie et la femme légitime sont inculpées également de tentative d’assassinat et d’escroqueries.
- Boucly, juge d’instruction, chargé de l’affaire, est donc armé lorsqu’il commence son information, après l’arrivée de la fausse marquise à la Victoire.
Le 5 décembre 1924, voulant se procurer de l’argent, car les quelques réserves qu’elle possède sont épuisées, Gisèle de Gisors, l’amie du pseudo-marquis de Champaubert, demande à son avocat de faire vendre les meubles qu’elle possède à Elbeuf, dans la villa qu’elle habitait lors de son arrestation.
Première quinzaine d’octobre 1924 sont expérimentés au castel du Prieuré, par le professeur Bourdinière de Rennes, les effets du chloroforme que le bandit se proposait d’administrer aux joailliers qu’il avait honorés de son choix.
Le 11 novembre 1924, Passal déclare qu’il aurait hésité à recourir au crime au dernier moment. Mais il est fort probable qu’il n’aurait pas eu ces scrupules s’il avait réussi à attirer dans le traquenard qu’il avait préparé l’un des quatre bijoutiers de Paris auquel il avait écrit de venir lui présenter un choix de pierres précieuses.
Gisèle de Gisors reçoit la visite de sa mère, venue de Vailly-sur-Aisne, où elle est commerçante. L’entrevue est très émouvante.
L’Ouest-Éclair, Emmanuel Desgrées du Lou, (1867-1933). Directeur de publication, 28 septembre 1924
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k647777b/f3.item.r=passal%20Lamy%20Robert%20chloroforme.zoom#
La Dépêche, 13 avril 1927
La Dépêche, 13 avril 1927
Le Petit journal du 27 septembre 1924
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k628959t/f3.item.r=%22gisele%20de%20gisors%22elbeuf.zoom#
Le Petit Parisien du 30 septembre 1924
Le Gaulois, Arthur Meyer (1844-1924), Directeur de publication, 27 septembre 1924
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k539925k/f2.item.r=%22gisele%20de%20gisors%22elbeuf.zoom#
La Lanterne, Victor Flachon, Directeur de publication, 6 décembre 1924
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7521394k/f4.item.r=%22gisele%20de%20gisors%22elbeuf.zoom#
Paris, 13e chambre correctionnelle, 8 janvier 1925
Le 8 janvier 1925 après-midi, devant la 13e chambre correctionnelle, comparait Joseph Passal, alias marquis de Champaubert, qui fait opposition à un jugement à 5 ans de prison prononcé contre lui par défaut, par le tribunal correctionnel, pour escroqueries commises au préjudice de 17 personnes. Le montant de ces escroqueries s’élève à 307 750 francs.
Joseph Passal qui se présente en uniforme de détenu vient de la prison de Saint-Malo. Aucun défenseur ne l’assiste. La partie civile ne s’est même pas présentée en raison de l’insolvabilité de l’inculpé.
Il y a une petite scène amusante. Le substitut du Procureur de la République lui-même ne sait pas quel est en réalité cet accusé qui fait opposition à un jugement prononcé par défaut, lorsqu’un expert qui se trouve dans la salle, fait remarquer que Passal n’est autre que le pseudo marquis de Champaubert, qui doit répondre devant les assises d’Ille-et-Vilaine du crime de tentative de meurtre.
À l’audience, Joseph Passal affirme qu’il ne se donne pas faussement, ainsi qu’on le lui reproche, comme directeur d’un chantier de construction de matériel roulant, el qu’il offre réellement la construction de wagons-réservoirs à des marchands de vin. Il ajoute qu’il a un petit bureau et qu’il tient les contrats qu’il signe.
Le tribunal, se reportant au dossier déjà chargé du faux marquis, ne tient qu’un compte relatif de ses dénégations et il condamne Joseph Passal à deux ans de prison sans sursis et à 50 francs d’amende.
L’Ouest-Éclair du 10 janvier 1925
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k496434d/f3.item.r=passal%20fourniture%20wagon%201916.zoom#
Pris de démence, Passal est interné à l’asile de Saint-Méen.
Passal continue à faire le fou. Le Parquet de Saint-Malo le dirige sur Saint-Méen de Rennes.
Le pèlerinage à la fontaine du grand Saint-Méen, entre Gaël et Montfort, à 10 lieues de Rennes, attirait beaucoup de fidèles atteints surtout aux mains de « maladies de peau lépreuses, purulentes et dartreuses », qui devaient s’y rendre à pied en demandant l’aumône ; certains passaient par Rennes et l’hôpital Saint-Yves ne suffisait plus à les abriter. Pour leur venir en aide, Guillaume Régnier, conseiller au Parlement de Bretagne, fonda en 1627 une chapellenie au Tertre de Joué relevant de l’abbaye de Saint-Georges de Rennes (fondée en l’an 1000) dont son fils Guillaume devint le premier aumônier. En principe, les pèlerins n’y pouvaient séjourner qu’une nuit ou deux ; cette formule, qui reprenait l’idée de l’hôtellerie du Moyen Âge, était périmée. Bien des voyageurs étaient trop faibles pour repartir rapidement, leur séjour se prolongeait et certains même y mouraient, ainsi Saint-Méen devint un hôpital. Il s’agrandit de plusieurs fermes aux alentours, et une chapelle fut construite en 1652.
Entre 1920 et 1926, l’asile de Saint-Méen reçoit les épileptiques, les idiots, etc.
Là, Passal est confié aux bons soins, et mieux aux soins avertis, de M. le docteur Quercy. Passal imagine une folie très douce, celle des Mathématiques ! c’est un savant qui veut jouer au « Jacques Inaudi », au calculateur effréné. À Saint-Malo, du matin au soir, il barbouille les murs de sa cellule d’innombrables divisions : il a une affection spéciale pour cette opération, moi qui croyais qu’il avait un faible pour la soustraction ! M. le docteur Quercy ne se laisse pas prendre à ce piège grossier.
Champaubert chiffre, chiffre sans relâche. Ce n’est pas là le fait d’une folie de maniaque. Un maniaque n’agit ainsi que de temps en temps ; il met de l’intermittence dans sa manie. Champaubert exagère. Premier soupçon !
Ensuite, pour agir ainsi, il faut avoir une certaine éducation scientifique, que rien ne laisse prévoir dans le passé du pseudo-marquis.
Enfin, il aurait fallu que les opérations fussent justes ou aient une apparence de vraisemblance. Or, les chiffres sont alignés au hasard.
- le docteur Quercy se rend compte bien vite à qui il a affaire. Il rend visite à son malade, se lie d’amitié avec lui et peu à peu obtient sa confiance. On en vient aux confidences, mais Champaubert griffonne toujours des chiffres.
Passal fait connaissance à la prison de Saint-Malo d’un certain Georges R… avec lequel il avait élaboré un projet d’évasion, au cas où il serait transféré à Saint-Méen. R… connaissait un veilleur de nuit, qui, moyennant la forte somme de 5 000 francs, fermerait les yeux. Dans une première lettre à son codétenu, transmise par le veilleur de nuit, Passal parait renoncer à son projet. Il conseille à son ami d’être patient et d’attendre. Bientôt il se ravise et lui donne toutes indications pour préparer sa fuite, par un train de nuit sur Paris quand son père lui aura fait parvenir l’argent qu’il lui demande (8 000 francs). Il en verserait 5 000 au veilleur de nuit pour l’achat d’une combinaison de chauffeur avec laquelle il partirait. Une fois à Paris, il serait sauvé.
Dans une lettre à son père, Passal qui décrit sa pénible situation, lui demande de l’aider à s’évader pour lui éviter les 20 ans de prison qui l’attendent, où la mort chez les fous. Il ajoute qu’il saura lui faire une vieillesse heureuse ayant mis en lieu sûr, avant de venir à Dinard, 76 bons de 5 000 francs qui représentent, avec les arrérages, 420 000 fr. Ensuite, devenu libre, il monterait un garage et redeviendrait honnête.
Ces lettres, on le devine, ne parvinrent pas à leurs destinataires. Le veilleur de nuit était un honnête homme et cette correspondance sert à démasquer le simulateur.
C’est un jeudi matin d’août 1925 que M. le docteur Quercy arrive à ses fins. Passal, dit Champaubert, doit avoir le cafard. Il se rend compte que son nouvel ami n’a aucune confiance dans son zèle pour les mathématiques. Il lui avoue n’être pas fou et n’être qu’un simulateur. M. le docteur Quercy est parvenu à son but ; il avertit son client que cette confidence serait immédiatement donnée à la Justice. Passal n’y voit pas d’inconvénient. Les choses ne traînent pas : le soir même, Passal est transféré de l’asile à la maison d’arrêt.
Le lendemain, écrit-il dans son rapport, Passal, bien qu’affaibli, est redevenu normal. Cette situation ne devait pas durer d’ailleurs.
Nous avons questionné le docteur Quercy qui nous a reçu avec la plus parfaite urbanité, mais nous a déclaré ne pouvoir nous rien dire.
« Docteur, avons-nous insisté, votre client n’a-t-il pas eu un certain moment de révolte quand vous l’avez fait passer à la maison d’arrêt ? »
« Du tout. Du reste, à aucun instant je ne lui ai caché le but dans lequel j’agissais qui est d’éclairer la Justice. Il m’a conservé son amitié et je compte aller le voir demain à la prison. »
Voilà ce qui s’appelle opérer sans douleur. Cette heureuse solution ne peut que donner un titre nouveau à la réputation du docteur Quercy.
Et maintenant, quelles sont les suites de l’acte du marquis de Champaubert ?
Certes, on ne peut affirmer qu’il ait eu commencement d’exécution dans sa machination. Il demeure pourtant passible de la Cour d’Assises d’Ille-et-Vilaine. C’est que pour s’affubler de titres et décorations, il a commis de nombreux faux dont est justiciable devant les jurés de notre département.
Fin août 1925, Passal, alias marquis de Champaubert, est transféré à Saint-Malo.
Tribunal correctionnel de Saint-Malo, mars 1926
À Saint-Malo, le matin du 16 septembre 1925, le juge d’instruction convoque pour l’interroger, l’escroc Passal, pseudo-marquis de Champaubert. Encore une fois, c’est peine perdue. Passal se met à divaguer, à parler de ses inventions, de mouvement perpétuel et de rayons lumineux, si bien que le juge doit interrompre ce monologue inintéressant. Dans ces conditions, le juge ne pense pas pouvoir continuer plus avant son information.
Le 25 mars 1926 comparait devant le tribunal correctionnel de Saint-Malo Joseph Passal, dit Simonin, dit Gabriel Gouraud, dit marquis de Champaubert, 34 ans, originaire de Saint-Denis, ex-ajusteur aux usines Hotchkiss, qui avait loué à Dinard en septembre 1924, une confortable villa, le « Castel du Prieuré », où il avait projeté d’attirer les joailliers parisiens pour les dévaliser. Son projet n’ayant, pas reçu de commencement d’exécution, l’affaire ne devait pas avoir de suites judiciaires.
C’est seulement pour vol d’argenterie et de linge fin commis au préjudice du propriétaire du « Castel du Prieuré », et d’un vol de drap et serviette, et même des fleurs artificielles, opéré à la villa « Les Frênes », à Paramé, où Passal ne séjourna que quelques semaines sous le nom de Robert Lamy, vétérinaire-chimiste, que le pseudo-marquis est poursuivi.
Les débats annoncés du procès de Champaubert attirent aux abords de la prison et du tribunal une foule énorme, curieuse de voir de près l’homme dont les exploits défrayèrent pendant près de deux ans la chronique.
Avant l’audience, de la prison de la Victoire au Palais, les curieux sont massés attendant la sortie de Passal. Quand il parait, c’est une surprise générale. Le marquis de Champaubert descend les marches de la prison soutenu, porté presque par 2 gendarmes. Il flotte dans ses habits, et sa barbe, vieille de plusieurs semaines, lui donne l’aspect d’un vieillard. C’est par une porte dérobée que Passal, soutenu par les gendarmes, car il marche littéralement courbé en deux, pénètre dans la salle d’audience.
Un service d’ordre très rigoureux a dû être organisé pour empêcher l’envahissement du prétoire.
Il s’affale aussitôt sur le banc des prévenus, marmottant des propos inintelligibles, et traçant avec son index droit des figures géométriques.
Son défenseur, Me Gasnier-Duparc, cherche alors à s’entretenir avec lui, mais en vain ; Passal, perdu dans son rêve, ne lui répond pas.
L’audience commence. Le Tribunal liquide quelques affaires courantes, puis l’huissier évoque l’affaire Passal-Noirait.
Celle qui fut la marquise de Champaubert parait alors, vêtue sobrement ; l’allure assez effacée, elle va s’asseoir sur le banc des prévenus, face au Tribunal. Passal ne répond pas à l’appel de son nom. On appelle les témoins MM. Dessoudex, le propriétaire du Castel du Prieuré ; Mme Bérel de Fougères, propriétaire de « Fresnes » à Paramé ; M. Schwab, commissaire spécial ; les docteurs Ollivier et Guint.
M. Dessoudex ne comparait pas, s’étant excusé par télégramme.
M. Gouéry, président du Tribunal, qui va diriger les débats avec son habituelle maîtrise, commence alors l’interrogatoire de Marie-Louise Noirait dite Gisèle de Gisors, qui fut la marquise de Champaubert.
Née en 1896, à Vailly-sur-Aisne, Marie-Louise Noirait y vécut avec sa mère jusqu’en 1914. La guerre les obligea à se réfugier à Paris, où elles vécurent de travaux de couture ; en 1917, Marie-Louise Noirait rencontra dans le métro Joseph-Clément Passal. Une idylle s’ébaucha et un mois plus tard Marie-Louise Noirait, jusque-là jeune fille sage, devint l’amie de Passal.
Passal s’était présenté à elle comme ingénieur. Elle avait alors 21 ans.
Elle dit avoir ignoré les agissements frauduleux de son amant à Bordeaux, à Hyères, à Nantes, où il fit de nombreuses dupes sous le nom de Gouraud. Puis à Lille, où il vendait des appareils de T. S. F.
Elle affirme n’avoir su que Passal avait été condamné à Paris, pour escroquerie, à cinq ans de prison.
Marie-Louise Noirait nie avoir été mise au courant des vols commis par Passal à Dinard et à Paramé, pour lesquelles elle est poursuivie en qualité de complice. Ce fut à Paramé que Passal commanda le chloroforme qu’il comptait utiliser à Dinard.
J’ai connu cette commande, répond Gisèle, mais je croyais qu’elle était destinée à son élevage de pigeons.
Puis c’est sa préparation de l’aventure de Dinard. Marie-Louise Noirait déclare qu’elle ne participa pas aux vols d’argenterie commis au Castel du Prieuré, pas plus qu’aux vols de la villa « Les Fresnes ». Dans les deux cas, ce fut dit-elle. Passal qui mit les objets dans ses bagages, alors qu’elle était absente. Quand elle s’en aperçut, elle voulut protester, mais Passal lui imposa silence, et elle dut partir, emportant à Elbeuf les objets dérobés par son ami, où furent retrouvés ensuite.
La prévenue prétend avoir été menacée de mort par Passal si elle le quittait.
Le Président, s’adressant alors à Passal, lui dit « Vous avez entendu les questions que j’ai posées à Marie-Louise Noirait et les réponses qu’elle a faites. Qu’avez-vous à répondre ? »
Deux gendarmes, prenant chacun par un bras le prévenu, le soutiennent à son banc.
Comme celui-ci, tête basse, reste muet, le Président le fait se rasseoir.
On entend ensuite M. Schwab, commissaire spécial, qui s’était présenté au faux marquis comme le représentant de M. Boucheron, joaillier, place Vendôme, à Paris, venu, en passant, pour lui présenter un choix de bijoux, et qui procéda à son arrestation.
Puis, alors que doit intervenir le docteur Ollivier, médecin de l’asile de Dinan, qui examina Passal, une scène assez dramatique se produit. Pour permettre au docteur de mieux voir Passal, les gendarmes l’amènent sur le banc qui fait face au Tribunal. Ils sont obligés de le trainer. L’ex-marquis parait un véritable déchet humain.
Le Président le fait ensuite réintégrer sa place, et le docteur Ollivier fait sa déposition. Il a conclu à la responsabilité normale de Passal, tout au moins à l’époque de l’affaire du Prieuré. Pour lui, le marquis est un simulateur.
Sur une question de la défense, relative à la maladie spéciale, dont Passal est atteint, le docteur déclare qu’il faudrait un fait nouveau pour amener la paralysie générale. Il conclut qu’au moment où il l’observa, le prévenu était en pleine possession de ses moyens mentaux.
Le docteur Quercy, médecin de l’asile de Saint-Méen, qui mit Passal en relations avec un de ses anciens codétenus de la prison de Saint-Malo, lequel lui suggéra l’idée de s’évader, est ensuite entendu.
Les deux médecins affirment, dans leurs rapports, la conviction que le prévenu est un simulateur doué d’une force de volonté extraordinaire. C’est aussi l’avis du docteur Guyot, médecin de la prison, qui, entendu ensuite, déclare que depuis le retour de Passal à la prison il n’a remarqué aucun fait nouveau qui puisse infirmer les conclusions du médecin aliéniste.
Mme Bérel, la propriétaire de la villa « Les Fresnes » à Paramé, reconnaît qu’elle est rentrée en possession de la plupart des objets qui lui furent volés avenue Saint-Roch
Le procureur, au début de son réquisitoire, commence par rendre hommage à la sûreté générale, dont la perspicacité épargna une mort affreuse aux commerçants que Passal voulait attirer au Prieuré.
Il demande au tribunal de frapper avec justice le bandit qu’elle tient dans le faux-marquis.
La défense de l’accusé est présentée par Me Gasnier-Duparc, de Saint-Malo, qui demande aux juges d’être indulgents pour son client.
Marie-Louise Noirait est défendue par Me Le Plénier.
Après une courte délibération des jurés, Georgette Passal bénéficie d’un non-lieu. Gisèle de Gisors est gratifiée de huit mois de prison, durée égale à la prévention qu’elle a déjà faite, et 50 francs d’amende.
Passal est condamné à deux ans de prison et cinquante francs d’amende ; Clément Passal lui-même, ayant ramassé dans quelques tribunaux diverses condamnations, deux ans, quatre ans, puis cinq ans de prison, cette dernière peine se confond avec les autres, et dix ans d’interdiction de séjour.
Philosophe, le « marquis » murmure à la sortie de l’audience : « Bah! je referai ma vie ! »
Figaro du 17 septembre 1925
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k294515f/f3.item.r=passal%20fourniture%20wagon%201916.zoom#
L’Ouest-Éclair du 26 mars 1926
La Dépêche de Brest du 26 mars 1926
Cet individu, dont la traduction devant les juges correctionnels ne constitue pas un début dans la triste carrière de prévenu, semblait appelé à une rentrée judiciaire plus retentissante. On n’imaginait pas moins que l’imposant appareil de la Cour d’assises pour l’escroc à l’imagination ardente qui avait aménagé une chambre de torture, bien digne du moderne théâtre d’épouvante, entièrement réservée aux bijoutiers trop confiants. En effet, la traduction de Passal devant les assises d’Ille-et-Vilaine fut annoncée à diverses reprises. Mais peut-on dire que c’est déjà beaucoup, pour la satisfaction de la justice en soi, qu’on puisse voir le faux marquis, en correctionnelle. L’affaire Passal-Champaubert manqua de peu de compter parmi celles qui, après avoir occupé le premier plan de l’actualité policière, sombrent à jamais dans ces fosses, dans ces oubliettes dont la neurologie officielle fait manœuvrer la trappe. Rarement accusé dérangea plus de psychiatres, rarement prévenu fut aussi près d’être proclamé irresponsable. On finit tout de même par le reconnaître assez équilibré pour répondre de ses actes. Cependant, aucun bijoutier n’ayant eu l’imprudence de s’introduire dans la chambre matelassée où le chloroforme devait être prodigué, l’affaire à l’instruction alla se rétrécissant comme une peau de chagrin, d’où l’aboutissement aujourd’hui rien qu’en correctionnelle !
C’est l’un des avantages de la profession de chroniqueur judiciaire que, depuis quelques années, on s’y crée des relations propres à éblouir M. Paul Bourget. C’est dans les couloirs du Palais de justice qu’il m’est advenu de rencontrer le marquis de Champaubert, pendant la saison estivale de 1924 qui est particulièrement brillante. Non point pour lui, certes. C’est un assez bel homme, au visage glabre. Il chemine à petits pas entre deux jeunes gens que je connais bien, MM. Bony et Royère, inspecteurs à la Sûreté générale.
MM. Bony et Royère rendent visite au marquis de Champaubert, en son castel du Prieuré, à la Vicomté, alors qu’il attend un bijoutier parisien assez sournoisement invité par lui à un « five o’clock chloroforme ».
Depuis, les trois hommes ne se quittent plus. Les journalistes, accourus de Paris, télégraphient fidèlement les « déplacements » du marquis, qu’on promène du violon municipal aux lieux du crime manqué et de là, au commissariat spécial, pour la plus grande joie des baigneurs.
Puis, avant de transférer le marquis à la prison de Saint-Malo, on le ramène au castel du Prieuré, pour y procéder à certaines constatations d’ordre matériel. C’est là que, durant un quart d’heure, j’ai le privilège de me trouver en tête-à-tête avec le marquis, tandis que les inspecteurs interrogent sa femme, une grosse commère blonde, effondrée, qui pousse des : « Ah, mon Dieu ! » à attendrir tous les gendarmes de France.
Le marquis n’était pas un causeur particulièrement brillant. Son entrée en matière est classique. Il me demande une cigarette. C’est ce que font avant toutes choses les inculpés qui engagent une conversation avec quelqu’un d’autre qu’un policier. Puis, il me dit sa confiance. En somme, il n’a fait de mal à personne. Que peut-on lui faire ? Ferré en droit comme le sont les chevaux de retour, il répète inlassablement : « Y a pas de commencement d’exécution, comme on dit. On doit me « délibérer ».
Il a le ton indigné d’un monsieur victime d’une injustice. Il semble sincère, oubliant sans doute dans son souci d’équité froissé, ses exploits antérieurs qui ont mis vainement à sa recherche une dizaine de parquets de France.
Puis, mezza voce, il ajoute : « Ah ! J’en connais des histoires. J’en ai eu une vie… Ah ! là ! là ! Si je racontais tout cela ! Tenez, vous qui êtes journaliste, on pourrait faire une affaire… Je vous raconterai ; vous écrirez. On vendra ça aux Américains…
Qu’eussiez-vous fait à ma place ? » J’acquiesce silencieusement. L’idée de devenir le « nègre » du marquis m’enchante.
Hélas ! les policiers apparaissent soudain et emmènent mon collaborateur avant que nous nous soyons mis d’accord.
Il s’éloigne en me jetant un regard complice, à la fois ravi et prometteur… Très sincèrement, il doit penser : « En a-t-il de la chance, celui-là, de m’avoir rencontré… »
Geo London
Je lisais le récit des aventures extraordinaires de Clément Passal, tour à tour ajusteur, industriel, parfumeur, pharmacien, vétérinaire-chimiste, marquis de Champaubert et, pour le moment, prisonnier de la police, redevenu Passal comme devant.
Je lisais son histoire et je n’étais pas loin de l’admirer, car ce gentilhomme sans ressources était un homme de ressources, un homme de réalisation, qui, malgré une longue série d’avatars, avait fait preuve d’une imagination, d’une énergie, d’une ténacité et même d’une intelligence fort au-dessus de la moyenne.
L’avouerai-je ? Je n’étais pas le moins du monde disposé à m’apitoyer sur l’infortune des bijoutiers-millionnaires qui allaient tomber dans son traquenard admirablement tendu, et bien au contraire (oui, oui, je suis cynique, exactement comme vous l’êtes presque tous, en secret, au troisième acte de quelque Nick-Carter ou au vingtième épisode de quelque « masque aux dents vertes »), — bien au contraire, je me disais : « Puisqu’il ne doit pas les tuer, il serait dommage qu’il ne réussît pas ! »
Et au chapitre suivant — au chapitre de l’échec — je songeais : « Eh ! quoi, tant d’habileté, tant d’ingéniosité, tant de travail dépensés pour… se faire arrêter ; pas de veine ! »
Mais au dernier chapitre — le chapitre des aveux — Clément Passal, marquis de Champaubert, m’a tout à coup dégoûté. Ce grand filou, cet énergique chenapan s’est mis à pleurer comme un simple veau, devant le juge. Ce bandit supérieur s’est dégonflé lamentablement. Cet « as » de l’escroquerie a eu une longue série de faiblesses comme une femmelette, ce magnifique aventurier s’est mis à geindre et à larmoyer comme un écolier pris en faute, comme un caniche à qui on va donner la fessée parce qu’il a fait pipi au pied de la cheminée du salon. Oui, le marquis m’a complètement dégoûté.
J’entends bien que ses larmes et ses jérémiades sont sans doute des larmes de crocodile et des jérémiades de circonstance. N’empêche que ce sont là des moyens indignes de lui, indignes de son passé.
Sans ce détestable chapitre et si le marquis n’avait pas « flanché », s’il avait jusqu’au bout gardé sa dignité d’homme, que de femmes l’auraient admiré, et que de lettres d’amour il aurait reçues dans sa prison qui eussent doucement caressé son orgueil et embelli ses tristes heures ! Que de grandes et de petites folles lui eussent offert leur cœur et le reste !
Mais il a pleuré, il s’est effondré, il n’est plus pour elles qu’un « chialeur » et il a perdu tout son prestige.
C’est un homme fichu ! Quand on écrira son histoire — car après avoir inventé des aventures pour servir aux grands chenapans, les romanciers se servent maintenant des grands chenapans pour suppléer à leur imagination défaillante — il faudra modifier sérieusement le chapitre des aveux de Clément Passal, marquis de Champaubert.
Jean Ziska
Ces révélations font la Une des journaux où l’on passe en revue les photographies de l’installation diabolique de la « villa truquée de Dinard ».
Passal est condamné à plusieurs années de prisons où il simule l’idiot du village pour tenter de raccourcir sa peine derrière les barreaux.
Le faux marquis, qui s’appelle en réalité Joseph-Eugène Passal, dit Gardner, dit de Champaubert, est incarcéré à la maison centrale de Loos. Il accomplit une peine de contrainte par corps.
La prison au bord de la Deule
Quand il sort de prison, il donne, à M. le Directeur de Loos, l’adresse où il doit résider, qui est la suivante : 25, rue de Tourville, à St-Aubin-Jouxte-Boulleng, dans la Seine-Inférieure.
Il est libéré en pleine crise de 29, promettant de tourner la page de son passé sulfureux. Il s’attelle, dit-il alors, à l’écriture de ses mémoires. Plusieurs éditeurs l’ayant en effet contacté afin de publier le récit de sa vie extravagante.
La reconstruction de la prison de Loos, fermée en octobre 2011, est prévue par le ministère de la Justice en 2016.
Le Gaulois, Arthur Meyer (1844-1924) Directeur de publication, 4 octobre 1924
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k539932s.texte.langFR
L’Ouest-Éclair du 28 septembre 1924
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5846421/f3.item.r=%22Henri%20de%20Vaudrey%22.zoom#
L’Ouest-Éclair du 8 octobre 1924
Le Matin du 23 mars 1926
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5753759/f1.item.r=%22Henri%20de%20Vaudrey%22.zoom#
Les Nouvelles (Alger) du 28 juillet 1926
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5036860q.item#
« L’histoire extravagante du marquis de Dinard », Samuel Sauneuf, Le Pays Malouin du 18 Janvier 2012
https://actu.fr/bretagne/dinard_35093/lhistoire-extravagante-du-marquis-de-dinard_6373738.html
Phare de la Loire du 1er octobre 1924
Cyrano : satirique hebdomadaire, rédacteur en chef Léo Marchès, 13 octobre 1929
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5595741k/f16.item.r=%22marquis%20de%20Champaubert%22passal
Le Petit Parisien, Jacques Roujon, (1884-1971), Directeur de publication, 27 septembre 1924
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6058863/f1.item.r=%22cl%C3%A9ment%20passal%22.zoom#
Le Peuple : organe quotidien du syndicalisme, Confédération générale du travail, 28 septembre 1924
L’Ouest-Éclair, 28 septembre 1924
L’Ouest-Éclair, Emmanuel Desgrées du Lou, (1867-1933). Directeur de publication, 2 octobre 1924
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k647781d/f2.item.r=passal%20fourniture%20wagon%201916.zoom#
L’Intransigeant, 9 octobre 1924
Le Gaulois, Arthur Meyer, (1844-1924). Directeur de publication, 11 novembre 1924
Le Nouvelliste de Bretagne, du 29 août 1925
https://www.retronews.fr/journal/le-nouvelliste-de-bretagne/29-aout-1925/699/2078549/2
Figaro, 9 avril 1926
Le Matin, 2 août 1926
Les Nouvelles (Alger) du 29 juillet 1926
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k50368614/f1.image.r=%22Canadian%20Motor%20C%22?rk=42918;4#
L’Echo d’Alger, 5 octobre 1929
Devant le tribunal correctionnel de Nantes, 1926
Le 8 avril 1926, le pseudo marquis de Champaubert est extrait de la prison de Saint-Malo, où les délais d’appel expirés, il n’a plus rien à faire. Toujours de plus en plus minable, Passal doit être porté, de la voiture qui l’a transporté à la gare, où il s’embarque, sous une escorte de gendarmes, dans l’express de 18 heures pour Nantes, étant réclamé par le parquet de cette ville pour répondre des escroqueries de « Gabriel Gouraud ».
Le 27 juin 1926, Gisèle de Gisors, l’amie du « marquis de Champaubert » qui a été retenue à Soissons par une attaque d’appendicite, arrive à Nantes. Elle sera prochainement confrontée avec Passal qui, de nouveau, a perdu la mémoire, et interrogée sur l’affaire de la Canadian Motor.
Rattrapés par la Justice, Passal et Gisèle de Gisors comparaissent devant le Tribunal correctionnel de Nantes. Voici les débats de l’audience du tribunal de Nantes.
22 juillet, 13 heures. La salle comble a l’aspect des grands spectacles judiciaires. Public mélangé, public des spectacles de boxe, anxieux de connaître le séduisant et « génial » marquis de Champaubert ; quelques jolies toilettes mettent leur note claire parmi les sombres robes d’avocats. Les conversations bourdonnent. Les accusés à leur place sont corrects dans leur conscience de premier rôle.
Le président Lignier, lui-même, a son sourire des grands jours.
Passal est assis dans le box des accusés, entre un vagabond et un interdit de séjour. Il porte son visage comme un masque. Gisèle de Gisors est repliée sur elle-même, dans une attitude de résignation. Ses yeux ont un éclat volontaire, une étrange fixité. Ses lèvres, sans fard, ont un pli amer qu’elle n’essaie pas de dissimuler.
Lorsque l’huissier appelle le nom de cet homme et de cette femme, ils se lèvent avec calme, comme deux acteurs dont c’est le tour d’entrer en scène. Ils connaissent leurs rôles. Ils vont les jouer avec pathétique.
Passal en complet gris, un petit carnet à la main, répond à l’interrogatoire d’identité, d’abord d’une voix basse et presque timide, mais par la suite l’homme réservé et distingué va se révéler un homme habile et parfaitement possesseur de tous ses moyens. Si Passal a réellement été un malade du cerveau, il n’y parait plus rien à l’heure actuelle, et c’est avec une certaine élégance de verbe et une remarquable précision d’arguments qu’il va présenter sa défense sur laquelle il ne se fait d’ailleurs aucune illusion.
- le Président lui rappelle quelques condamnations antérieures pour escroqueries et les malheureuses tentatives commerciales qu’il fit à Hyères où il avait installé une usine de parfumerie, à Bordeaux où il s’associa dans une affaire de wagons qui aboutit à des poursuites correctionnelles.
Passal fait en souriant des gestes évasifs. Je me rappelle une partie des faits que vous me dites, avoue-t-il, mais l’amnésie dont j’ai été atteint m’empêche de pouvoir affirmer l’exactitude de la totalité de ces faits.
Le Président parle de la folie simulée par Passal pendant 16 mois. M. Passal, dit-il, ne croyait pas à l’amnésie dont vous avez prétendu être atteint. Cette amnésie n’était pas totale, vous aviez, quelquefois, de la mémoire ; c’est une amnésie fractionnée. Vous ne vous souvenez que de ce qui est peu dangereux pour votre défense.
Passal sourit encore. « M. le Président, dit-il, je n’ai aucun intérêt à simuler cette amnésie, et d’ailleurs, par quel mobile serais-je poussé ? Pourquoi simuler ? Étant donné l’état d’esprit où vous êtes à mon égard, Messieurs, je sais pertinemment que je serai condamné, il me serait donc inutile de conserver pareille attitude ? Quel intérêt ai-je à vous tromper Le Président. »
- le Président sursaute un peu à cette déclaration, mais poursuit l’interrogatoire ; il rappelle à Passal ses différentes simulations à Saint-Malo.
Passal – Mais, si j’ai simulé la folie, répond l’accusé, pourquoi par deux fois m’a-t-on interné ?
Le Président – Le Tribunal n’a contre vous aucun parti-pris. Vous avez joué d’une façon extraordinaire la comédie de la folie. Vous avez été mis en observation, c’est différent.
Mais Passal ne veut pas faire de différence entre l’internement et la mise en observation. Lorsque le président lui dit que plusieurs médecins ont constaté qu’il simulait la folie, Passal répond : Tout cela, ce sont des impondérables.
Le Président rend hommage à l’extraordinaire puissance du prévenu qui, pendant seize mois, est parvenu à simuler la folie.
Le Président – On sait que vous êtes très fort.
Passal – Ainsi j’aurais arrêté ma simulation à huit jours de la sentence, à quoi cela me servirait-il. D’abord, je ne nie rien. J’ai tout reconnu à l’instruction.
Le Président – Aujourd’hui, vous ne vous souvenez de rien. Le 6 octobre 1924, à Saint-Malo, vous avez reconnu en bloc les escroqueries qui vous étaient reprochées.
Passal répond avec une merveilleuse subtilité : J’ai perdu la mémoire, mais je ne nie pas les faits.
- le Président rappelle alors 1’affaire Canadian Motor, société de vente d’autos à tempérament, qui fut lancée sous le nom de Gouraud : Vous êtes, dit le président à Passal, le type supérieur du brasseur d’affaires. Vous avez mené la Canadian Motor avec maestria.
Passal ne répond pas ; il consulte un carnet où il a pris quelques notes sur lui-même. Il prépare sa défense.
Il y a en ce moment une telle affluence dans la salle que le Président est obligé d’intervenir et de menacer de faire sortir tout le monde. Le public, qui, tout à l’heure, causait comme au cinéma, se tait.
Le Procureur – Le 13 octobre 1922, vous avez écrit de Paris au Parquet de Nantes une lettre très habile. Vous nous préveniez que vous aviez quitté Nantes et que la Canadian-Motor « C’est une entreprise « imaginaire ».
Passal – Il y a contre moi des preuves irréfutables. Je ne nie rien. Je ne peux pas nier l’évidence.
Le Président – En ce moment, vous essayez de jeter de la poudre aux yeux. Il est inutile de jeter de la poudre aux yeux.
Passal – Je ne le fais pas, je m’explique.
On aborde le vif du débat. Le séjour de Passal à Nantes, la recherche du garage, les catalogues. Passal écoute l’exposé des faits avec indifférence. Il a quelques gestes d’impatience, et il dit : Je ne me rappelle pas ces faits. En tout cas, je ne les nie pas. C’est l’essentiel.
Avant d’ouvrir le garage du Canadian-Motor, Gabriel Gouraud a choisi ce nom après avoir été Henri de Vaudrey, parfumeur à Hyères.
Gabriel Gouraud fit éditer un catalogue somptueux où l’on voyait la photographie de l’usine de la Canadian-Motor, la photographie des voitures, le nom des coureurs qui avaient gagné sur ces voitures des courses en Amérique, les caractéristiques des 5 chevaux, des 10 chevaux, etc.
Peut-on ne pas s’émerveiller devant l’imagination prodigieuse, devant cette faculté de réaliser avec intensité, avec une admirable précision, une entreprise chimérique. Passal a manqué sa vocation. Il a l’imagination d’un romancier ou d’un poète. Réalisé, le lancement publicitaire de la Canadian-Motor, il loue un garage, engage des dactylographes. Il poursuit jusque dans ses moindres détails l’organisation de son affaire ; détail typique, il ne reçoit jamais les clients, mais dans le plancher de son bureau fait aménager une trappe, de telle façon qu’il entend les conversations entre les clients et le chef du personnel. C’est ainsi qu’il assiste à la scène que fait le commissaire de Montpellier, et s’enfuit précipitamment. Il part à Lille avec 200 000 francs, puis installe une entreprise d’élevage de pigeons voyageurs.
[…]
Le Président – Vous reconnaissez aujourd’hui tout ce qui est à votre charge ?
Passal – Ah non, pas tout.
Le Président – Avez-vous quelque chose à ajouter ?
Passal – Que voulez-vous que j’ajoute ?
Passal s’assied toujours souriant.
On interroge Gisèle de Gisors ou plutôt Marie-Louise Augustine Noirait, 30 ans, née à Soissons, poursuivie pour complicité d’escroquerie.
Vous êtes, lui dit le Président, l’associée de Gouraud depuis 1917. Vous avez vécu longtemps dans son intimité, vous avez connu ses escroqueries.
Elle reconnaît qu’elle vit avec Giraud depuis 1917 et qu’elle connut les mauvaises affaires d’Hyères et de Bordeaux. « J’ai connu les escroqueries de Gouraud toujours après. »
Le Président – Vous l’avez secondé dans l’entreprise ?
MLN – Je ne l’ai pas secondé.
Le Président – Vous saviez son genre de vie. Pourquoi ne le disiez-vous pas ?
MLN – Je connaissais toujours ses escroqueries lorsqu’elles avaient été commises, mais je ne l’ai jamais aidé dans ses entreprises.
Le Président – Mais cela ne vous paraissait-il pas étrange qu’il changeât de nom aussi fréquemment ?
MLN – Il était bien forcé de changer de nom puisqu’il avait fait de mauvaises affaires.
Le Président – Vous êtes arrivée à Nantes avec votre amant, sachant qu’il venait de commettre une escroquerie. Il a pris un nom nouveau. Pourquoi l’avez-vous accompagné chez le notaire et avez signé l’acte du nom de Mme Giraud ?
MLN – J’étais obligée.
Le Président – Vous n’avez pas cédé à une contrainte ?
MLN – J’ai signé chez le notaire parce qu’il m’avait dit que l’affaire était nette cette fois.
La maîtresse de Passal répond avec une douloureuse résignation. Elle a été entre les mains de cet homme un instrument banal ; asservie, elle n’a pu se dégager de son emprise.
Le Président – Pourquoi êtes-vous restée avec lui ?
MLN – Je ne pouvais plus m’en aller.
Le Président – Vous étiez, je crois, marquise de Champaubert. Vous aviez une vie large. Si vous aviez eu un peu de cœur, vous l’auriez quitté.
Gisèle de Gisors, marquise de Champaubert, baisse la tête. Dans son visage, la lueur de ses yeux est éloquente. Elle a trop longtemps vécu avec Passal, elle a partagé trop longtemps sa vie aventureuse pour pouvoir s’en séparer.
Le Président – Vous ne deviez avoir, sur la mentalité de votre amant, aucune illusion ?
MLN – Il m’avait promis à Marseille de monter désormais des affaires honnêtes, je l’ai cru.
Le Président – Vous prétendez que vous êtes de bonne foi ?
MLN – Je l’étais. Je n’ai compris qu’il s’agissait d’une escroquerie qu’au moment du départ. Il m’a tout avoué.
Le Président – Et vous êtes restée avec lui !
MLN – Que fallait-il que je fasse. À Marseille j’avais essayé de partir. Il m’a reprise tout de suite.
Le Président – Mais enfin, quel rôle avez-vous joué dans l’affaire ?
MLN – Aucun. Je n’ai joué aucun rôle dans l’escroquerie de la « Canadian Motor Co ». J’ai envoyé quelques catalogues. J’ai bien vu, comme tout le monde qu’il n’y avait pas d’autos mais j’ai cru, comme il me le disait, que ces voitures arriveraient par le prochain cargo. Il m’avait montré un contrat qui le liait à la « Canadian Motor Co », j’ai eu confiance.
Le Président – Giraud ne recevait personne et il vous fallut un jour vous nommer pour être reçue par lui, cela ne vous surprit pas ?
MLN – Je le savais très occupé, c’était tout naturel.
Le Président – Les mandats qu’il recevait en masse ne vous ont pas surpris.
MLN – Non, Giraud m’avait montré la lettre qui le nommait directeur de la « Canadian Motor ». Je trouvais naturel que l’affaire prospère.
Le Président – Un jour Giraud se fit envoyer un télégramme annonçant l’arrivée prochaine des voitures. C’est vous qui avez porté ce télégramme. Cela ne vous a pas paru bizarre ?
MLN – Mais non, je pensais que c’était pour faire patienter les clients.
Marie-Louise Noirait, dite Gisèle de Gisors, reconnait pourtant qu’elle vécut avec le produit du vol après le départ de Nantes.
[…]
Me Servat présente avec habileté et le talent méticuleux qu’on lui connaît la défense de Marie-Louise Noirait. Marie-Louise Noirait est la fille d’un ferblantier et d’une épicière fruitière de Vailly. Il la présente d’abord à Soissons petite fille se révélant déjà dans les leçons de morale, puis au début de la guerre, fuyant l’invasion avec sa mère et se réfugiant à Paris. En mai 1917, dans le métro, elle rencontre l’homme qui va faire d’elle Gisèle de Gisors ; elle subit à la fois son charme et son emprise, comme un oiseau subit de branche en branche la fascination du reptile : à propos de la vie aventureuse de Passal, Gisèle de Gisors croquait à chaque fois à ses promesses.
Passal, disent les médecins aliénistes, est un homme séduisant. Il possède une volonté de fer, est doué d’une puissance de mensonge extraordinaire. Marie-Louise Noirait a été pour lui une conquête facile. Il l’a entraînée dans sa vie aventureuse.
Par la suite, des scènes fréquentes se produisirent entre les amants.
Me Servat, discutant l’accusation, dit que le faux nom et la fausse qualité prises par Marie-Louise Noirait n’ont pas servi à la réussite de l’entreprise. Elle n’est pas coupable de complicité.
De Passal, dit Me Servat, Marie-Louise Noirait a été la première et la plus intéressante victime. On l’accuse d’avoir profité des escroqueries de Passal. Quand Giraud alla à Bruxelles pour tenir un stand en son nom, et quant aux bénéfices, tout le monde en a profité, la femme légitime et la mère de Giraud.
Passal – C’est vous qui le dites Maître.
Passal proteste avec énergie et affirme que sa mère n’a jamais profité de rien.
Le Président fait remarquer que la mère de Passal a été étrangère aux escroqueries de son fils. Passal qui, avec spontanéité, avec émotion, a défendu sa mère, obtient gain de cause.
Me Servat poursuit. Il s’adresse à Passal : Je vous demande, dit-il, que dans l’avenir vous la laissiez tranquille, que vous ne la mêliez plus à votre vie.
Passal – Vous devancez le temps, Maitre.
Me Servat révèle que dans cette affaire les 3/4 des victimes n’ayant pas porté plainte, les créanciers ont pu toucher 100 pour 100 des dividendes.
- Servat demande, en concluant, que la peine qu’infligera le Tribunal à Marie-Louise Noirait soit confondue avec celle de huit mois de prison prononcée par le Tribunal de Saint-Malo.
Passal alors se lève. En quelques paroles nettes et choisies, avec cet air souriant qui ne l’a jamais quitté, il demande au tribunal de tenir compte de son état et de l’honorabilité de sa famille. Je suis obligé de me défendre seul, dit-il, n’ayant pas reçu l’argent nécessaire pour me trouver un avocat.
Mais, dit le Président, vous pouviez demander un avocat d’office.
C’est inutile, déclare Passal, toujours aimable, cela ne changera rien aux résultats et cela retarderait les débats.
- le substitut Imbart Sarrazin résume brièvement les faits. Après avoir fait la preuve de l’intention frauduleuse, il demande, pour Passal, le maximum de la peine. Il retient contre Marie-Louise Noirait deux actes matériels : les prospectus qu’elle a expédiés en compagnie de son amant ; le télégramme, de New-York, annonçant l’arrivée des voitures, qu’elle a mis à la poste.
- Imbert Sarrazin retient en outre contre Marie-Louise Noirait des présomptions nombreuses. Elle a vécu avec Passal depuis 1917 ; elle a participé à ses escroqueries. Au moment du départ précipité, elle a dit à la concierge de l’immeuble où ils vivaient, pour la rassurer : « Nous partons, mon mari et moi, à la chasse chez des amis. »
Pour M. Imbart Sarrazin, il n’y a aucun doute : Marie-Louise Noirait a été la complice « consciente » de Passal. Elle a connu les secrets de Passal, il lui était difficile de s’en dégager.
Passal se lève. Il va présenter devant le Tribunal sa défense. Passal demande pardon à la société et à Marie Noirait, dont il a brisé la vie. J’ai beaucoup de torts envers elle. Il rappelle qu’il fut ajourné et réformé définitivement pour paralysie.
- le Substitut – Oui, mais pas pour paralysie.
Passal rappelle qu’à plusieurs reprises il a été exempté pour cause de paralysie des jambes. « Mais, M. le Procureur, la paralysie atteint toujours un peu le cerveau par la moelle épinière. Enfin, je trouve bizarre que deux conseils de réforme m’aient exempté pour paralysie et que j’aie été interné deux fois pour examen mental. Je dois ajouter que je viens d’apprendre par deux camarades de prison un fait assez étrange : Pendant mon aliénation, un gardien m’a brûlé avec une allumette les oreilles et le nez, il m’a enfoncé des épingles dans les bras et les cuisses. »
- le Substitut – Vous n’aviez qu’à porter plainte.
Passal, souriant – Non, mais je dis que si maintenant on m’en faisait autant, j’enverrais ma main sur la figure de mon tortionnaire.
Je conçois, dit-il, que ce que j’ai fait en 1922 dénote une certaine intelligence, mais cette intelligence n’était-elle pas mélangée de quelques aberrations ? Ces aberrations n’étaient-elles pas dues à mon état physique ?
Il insiste sur la folie dont il a été la proie pendant seize mois.
Je vous rappellerai qu’il est très drôle que j’aie joué la simulation pendant 16 mois et que j’aie cessé d’être fou deux mois avant de comparaître devant le tribunal. J’aurais d’ailleurs intérêt à me rappeler les faits. J’y trouverais certainement des circonstances atténuantes.
Le ton devient pathétique.
Quoiqu’il en soit, mon repentir est profond. Je vous demande d’avoir pour moi un peu de pitié, d’avoir pitié à cause de ma vieille mère pour qui j’ai de l’amour et je vous demande de croire que je suis absolument sincère.
En terminant, Passal rend un nouvel hommage à sa mère et demande qu’on lui accorde des circonstances atténuantes et que le tribunal, comme pour Mlle Noirait, veuille bien prononcer la confusion de la peine avec celle infligée par le tribunal de Saint-Malo.
Le Tribunal renvoie son jugement au lundi suivant.
En sortant, Passal-Giraud, dit marquis de Champaubert, échange quelques paroles avec Marie-Louise Noirait, sa marquise, avec cette affectueuse douceur que l’on témoigne aux gens que l’on a mis dans le pétrin.
Le 26 juillet 1926, le tribunal correctionnel de Nantes condamne Passal, alias marquis de Champaubert, pour escroqueries, à 4 ans de prison et 100 francs d’amende, et sa complice Marie-Louise Noirait, dite Gisèle de Gisors, à deux ans de la même peine et 100 francs d’amende.
Le 28 juillet 1926, Passal dit Gouraud, fait appel du jugement du tribunal de Nantes le condamnant pour l’affaire d’escroqueries de la Canadian Motor. D’autre part, il est certain que le ministère public fera appel a minima de la peine de 2 ans de prison infligée à Marie-Louise Noiret, dite Gisèle de Gisors, pour complicité dans cette affaire. Il faut donc s’attendre à la prochaine comparution des deux accusés devant la Cour de Rennes. Ces formalités leur permettront tout au moins de vivre quelques jours relativement heureux, sous le régime de la prévention, plus doux que celui des condamnés, et ce sera toujours cela de tiré sur la peine définitive.
Le 1er août 1926, Passal, est transféré de la prison de Nantes à celle de Rennes, devant comparaître devant la cour d’Appel de cette ville qui confirmera la peine prononcée en première instance.
L’Ouest-Éclair du 22 juillet 1926
Journal des débats politiques et littéraires du 29 juin 1926
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4915541/f3.item.r=%22gisele%20de%20gisors%22argenterie.zoom#
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6295963/f3.item.r=%22gisele%20de%20gisors%22argenterie.zoom
L’Ouest-Éclair du 29 juillet 1926
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k611668p/f5.item.r=tribunal%20nantes%20Passal.zoom#
Devant le tribunal correctionnel de Lille – 1927
En septembre 1924, M. Abbé, commissaire de police à Lille, est frappé en lisant les journaux, de certains détails concernant l’arrestation du fameux marquis de Champaubert à Saint-Malo. Il croit reconnaître dans les photographies publiées un individu nommé Joseph-Clément Passal qui, sous le nom de Jean-Marie Patte, s’était installé à Lille où il avait fondé, fin novembre 1923, une Société s’occupant de la fabrication et de la vente des appareils de T.S.F. , entreprise sans-filiste absolument chimérique.
Il escroqua un joaillier de la ville pour 155 000 francs de bijoux. M. Abbé soumet au bijoutier la photographie du fameux marquis de Champaubert et le bijoutier volé reconnait formellement son voleur.
C’est pour répondre de ces faits délictueux que Joseph Passal déjà condamné pour d’autres faits en d’autres lieux, revient présentement à Lille. Le pseudo marquis vient de purger dans les prisons du département de la Seine trois années de prison pour des méfaits commis à Nantes, à Saint-Malo et autres lieux.
Sa peine terminée, il est dirigé par les services pénitenciers sur Lille ; en mars 1927, le marquis de Champaubert est l’hôte passager de la maison d’arrêt de Loos-lez-Lille.
Le vendredi 11 mars 1927 dans la soirée, il arrive au Palais de Justice de cette Lille. M. Thermes, Juge d’instruction est chargé de procéder à l’interrogatoire du faux marquis de Champaubert : spn dossier lillois est donc repris. On dit que nombre des dupes du directeur de « Radio lmperator » vont profiter de la présence de Passal à Lille, pour porter des plaintes qui risquaient jusqu’à ce jour de demeurer platoniques.
Le marquis va donc subir un nouvel assaut. Il est, paraît-il, de taille à le supporter, car, si au cours de ses différents procès à Paris il a habilement simulé le gâtisme, il a depuis retrouvé toute sa superbe…
Joseph Passal comparait le 5 avril 1927 devant le Tribunal, présidé par M. Foucart, ayant pour assesseurs MM. les juges Le Friec et Darrondel. Dans le box réservé au public se presse une foule que l’on ne remarque guère de coutume.
Les questions posées au détenu n’apportent aucune révélation. « Je me nomme Joseph Clément Passal, en effet. J’ai 37 ans. Je suis né à Saint-Denis. »
Qu’avez-vous à dire ? présente d’un air affable de Président, à celui qui comparait devant lui.
Passal – Je regrette infiniment, Monsieur le Président, mais je ne me souviens de rien de tout ce qui s’est passé à Lille. Je vous le jure sur la tête de ma vieille mère que je vénère entre toutes les personnes que j’ai pu aimer. Je regrette toute la peine que j’ai pu lui causer ces temps derniers.
Le Président – Vous reconnaissez les faits ? L’escroquerie des 300 000 francs au préjudice des clients de Radio-Imperator ? Les émissions des chèques sans provision de 150 000 et 5 000 francs au détriment de M. Boutry.
Passal – Je ne me souviens plus de quoi que ce soit. J’ai perdu la mémoire. Trois médecins m’ont examiné quand j’étais en prison et ont reconnu que j’avais perdu certaines facultés mentales.
Le Président – Vous n’y paraissez guère.
Passal – C’est possible ! Vous préjugez Monsieur le Président ! Je n’ai pas besoin d’avocat maintenant. Je suis assez grand pour me défendre moi-même, quoique j’aie oublié…
C’est dur de faire de la prison quand on est innocent. Je le jure sur ma mère !
Coupant court au bavardage du Marquis, le Président donne la parole à M. Boutry, bijoutier, puis à M. Rogier, substitut de M. le Procureur de la République. Ce dernier condense en quelques minutes les méfaits pratiqués par lui à Paris et à Lille et termine en réclamant la confusion des peines et le maximum de condamnation
Après quelques minutes de discussion avec ses assesseurs, le Président Foucart condamne le sieur Joseph-Clément Passal à cinq ans de prison avec confusion des peines, à dix ans d’interdiction de séjour et à trois mille francs d’amende ainsi qu’aux dépens.
L’Ouest-Eclair du 28 septembre 1924
Le Grand écho du Nord de la France du 13 mars 1927
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4760633k/f1.item.r=passal%20wagons%20arm%C3%A9e%201916.zoom#
Le Grand écho du Nord de la France du 6 avril 1927
Verneuil
Au début de juillet 1929, une vieille femme habitant Saint-Aubin-Jouxte-Boulleng (Seine-Inférieure), a la grande joie de revoir son fils arrivant de la prison de Loos, ses cinq ans de réclusion purgés, qui, pour elle, se montra toujours bon. Elle pense qu’il s’est amendé ; tout le monde le pense aussi, d’autant que Passal ne sort guère pendant les deux mois et demi qu’il demeure à Elbeuf. Les ouvriers qui le cherchent dans la rue, les rentières qui soulèvent discrètement leurs rideaux, en sont pour leurs frais de curiosité.
Le 22 septembre, le marquis écrit à sa mère.
Le document porte tout d’abord une suscription énigmatique. On lit :
de X, dimanche matin.
Ma bonne vieille maman bien aimée,
C’est le cœur bien gros pour toi que je t’adresse cette lettre, qui sera sans doute la dernière, que tu recevras jamais de moi. Toutes les propositions que j’avais reçues de Mme d’Orgeval pour l’établissement d’une société d’édition de mes mémoires n’étaient qu’un piège tendu dans le but de s’assurer de ma personne et de l’argent qu’on me supposait avoir caché en 1924. Actuellement, je suis prisonnier d’une puissante société secrète, qui a pour programme de faire expier les grands escrocs qui n’ont pas assez, d’après elle, payé leur dettes à la collectivité.
Je suis condamné à mort et dois subir des épreuves terribles dans ce but.
J’ai le choix de celles-ci, mais il y en a qui sont insurmontables. Dans la journée d’aujourd’hui même, j’ai demandé d’en affronter deux terribles. Je ne pense pas y parvenir et c’est pourquoi je t’adresse cette dernière lettre. J’ai demandé qu’après ma mort ma montre en or et les différents objets que j’avais emportés avec moi te soient restitués. Garde-les pieusement en souvenir de ton pauvre fils qui, toute sa vie t’a aimée comme une idole.
Je ne regrette rien de ce que j’ai fait, quoique tu ne connaisses pas la vingtième partie de mes aventures et de mes escroqueries. Je n’ai jamais fait de tort volontairement aux faibles ou aux pauvres, ne m’étant jamais attaqué qu’aux riches ou aux puissants, qui avaient la force et l’intelligence de lutter, contre moi, qui agissais toujours seul. Cela procure à ma conscience tout l’apaisement voulu et j’ai du courage. Quant à ma volonté, elle est légendaire ; ce n’est pas la mort qui me fera trembler, tu dois le voir à mon écriture. Je ne sais même pas où je me trouve et le saurais-je qu’il me serait, en ce moment, impossible de te l’apprendre. À mon arrivée à Deauville, mardi dernier, j’ai été mis dans l’impossibilité de faire quoi que ce soit et embarqué en auto pendant de longues heures pour être conduit là où je suis.
Ces messieurs de la police doivent être heureux s’ils savent mon aventure.
En tout cas, je pardonne à tous ceux qui m’ont fait souffrir pendant ma longue détention. J’adresse mes dernières amitiés sincères à mes bons et vrais amis, à Pierre, Alice et Jacqueline, ainsi qu’à Félix et sa dame, Henri, à sa femme et à ses enfants. J’oubliais le petit Pierrot que j’aimais tant.
Quand il sera grand, je te demande que tu lui donnes ma montre en souvenir de moi. Sois forte, mère bien aimée, quand tu liras cette lettre et pardonne-moi pour toutes les peines ou les alarmes que j’ai pu te causer involontairement, à toi qui fus toujours un modèle de courage, de vertu et de travail.
Ma dernière pensée avant de mourir sera pour toi et le dernier cliché que j’emporterai dans ma tombe sera ton cher visage bien aimé. J’ai demandé à mes bourreaux que la photographie, que j’ai emportée avec moi, soit mise, sur ma poitrine, près de mon cœur, lorsque j’aurai cessé de vivre. On me l’a promis. Allons, adieu ma bien aimée maman. Je vais mourir en homme. De cela, du moins, tu pourras être fière. Je t’embrasse une dernière fois comme je t’ai aimé toute ma vie, à l’infini. Adieu Sois forte et pardonne-moi.
Clément
Le document ci-après est, non sans ingénuité, signé « Pour les Chevaliers de Thémis Leur chef »
Paris, 22 septembre 1929
Il faut croire que le marquis de Champaubert est un habile tireur pour avoir choisi l’épreuve dite des trois carabines Winchester, comme, du reste, les renseignements que nous allons donner sur cette épreuve vont le démontrer.
Trois carabines Winchester, chargées à balle, sont fixées, sur un bâti spécial et braquées sur un poteau où le supplicié va être attaché et mis dans l’impossibilité absolue de faire aucun mouvement de déplacement, du corps. Ce poteau est fixé à 40 mètres des carabines.
La détente de celles-ci doit être actionnée simultanément par un ressort tendu auquel est attaché un cordon Bickford, qui supporte lui-même toute la pression de ce ressort : Un allumoir électrique à mouvement d’horlogerie doit communiquer l’allumage à ce cordon, 4 minutes après son déclenchement. Pour éviter cet allumage du cordon Bickford qui, par sa combustion, libérerait le réssort qui commande les trois détentes des carabines Winchester, le supplicié doit, à l’aide d’une autre carabine, et à cette distance de 40 mètres, sectionner le fil électrique d’un diamètre d’un millimètre qui transmet le courant produisant l’étincelle destinée à enflammer le cordon. Comme on le constate, il faut être véritablement bon tireur nour y parvenir à cette distance. S’il ne parvient pas à trancher le fil électrique dans les 4 minutes qui lui sont accordées, la décharge des 3 carabines viendra le frapper au cœur.
Ces explications étant données, revenons au marquis. Il a passé une excellente nuit, toujours sous la surveillance d’un chevalier, relevé chaque heure au cours de la nuit.
Il a déjeuné de fort bon appétit et ne paraît nullement émotionné par l’épreuve qui l’attend. Il nous a simplement demandé, dans la matinée, si, nous avions fait parvenir à sa mère la lettre qu’il avait écrite, ainsi que sa montre et les différents objets lui appartenant.
Comme nous lui disions que nous n’en avions rien fait, étant donné qu’il avait triomphé de l’épreuve d’hier, il a acquiescé de la tête et nous a demandé de ne les envoyer qu’après sa mort. Cette requête, faite avec le calme et sur le ton le plus tranquille qui soit. Quel homme !
À 3 heures, nous l’avons extrait de sa cellule et conduit, sous bonne escorte et toujours garrotté, au stand, situé dans l’intérieur de la propriété où va se dérouler l’épreuve. Arrivé au poteau, nous lui avons rendu, pendant quelques instants, la liberté de ses mouvements et, après 10 minutes que nous avons laissées s’écouler pour lui rendre l’usage normal de ses membres, nous l’avons très solidement attaché à l’aide de courroies de cuir, qui lui interdisent tout mouvement latéral ou longitudinal du corps. Il a simplement la possibilité de pouvoir viser et tirer, étant attaché de manière que son corps se présente de trois quarts aux carabines.
Nous lui avons à ce moment remis la carabine chargée.
Un chevalier, armé d’un pistolet automatique, s’est alors placé desrière lui et nous l’avons informé que dans le cas où il se servirait de cette arme contre l’un de nous, il serait immédiatement foudroyé derrière la nuque par le chevalier armé qui allait se tenir en arrière de lui, avertissement qui a eu le don de lui faire hausser les épaules et de nous traiter de lâches.
Nous l’avons prié de mettre en joue, l’informant qu’il pouvait commencer dès notre signal et au moment précis où nous déclenchions la minuterie de l’allumoir électrique. Une petite horloge est posée devant ses yeux, sur un trépied, à 2 mètres de lui. La grande aiguille marquant exactement 3 h 30, nous lui donnons l’autorisation de commencer le tir. Il vise quelques secondes et lâche son premier coup, qui vient frapper la cible, placée derrière le fil électrique à sectionner, à environ 4 centimètres à gauche de celui-ci.
Aucune émotion ne perce sur son visage. Posément, il élève de nouveau son arme pour tirer, puis la rabaisse et nous demande une cigarette que nous lui passons et qu’il allume avec un calme renversant. Il y a déjà une minute d’écoulée. Ayant épaulé de nouveau, il tire sa deuxième balle, qui est encore un peu trop à gauche, de 3 centimètres environ. Il daigne sourire. Quelques secondes après, il envoie son troisième coup, qui est encore un tout petit peu trop gauche, mais si peu. Il fronce les sourcils légèrement. Oh si légèrement qu’on s’en aperçoit à peine.
Il y a déjà deux minutes d’écoulées.
Une quatrième fois, il vise et presse la détente presque aussitôt. Cette fois, la détonation de son arme est suivie d’un petit claquement et d’une vibration sonore comparable à celle que donnerait une corde de mandoline. Le fil électrique est brisé. Une nouvelle fois il ̃ échappe la mort : sur son visage apparaît encore le sourire méprisant qu’il prit hier après-midi, après qu’il eût triomphé des trois épreuves du saut mais, cette fois, il ne nous dévisagea pas de cet air blessant qu’il sait si bien prendre.
La petite horloge marquait à ce moment 3 h 32′ 1/2.
Si extraordinaire que cela puisse paraître, nous étions presque heureux pour lui qu’il ait réussi cette nouvelle épreuve.
Du reste, il en a encore quatre, et il choisit toujours celle qui lui semble le plus favorable. Celles qui vont suivre sont plus dangereuses. Peut-être va-t-il s’en rendre vraiment compte et perdre de sa belle assurance et de son calme. Quoi qu’il en soit, nous sommes obligés de reconnaître que, jusqu’ici, il s’est conduit très crânement sans la moindre affectation.
L’ayant ensuite débarrassé de son arme et délié du poteau, nous l’avons, garrotté de nouveau, ne lui laissant que l’usage de ses jambes, et recoinduit dans sa cellule où, par humanité, nous l’avons rendu libre de tous ses mouvements, le prévenant qu’il était surveillé jour et nuit et qu’à la première tentative d’évasion, nous le priverions de nouveau de l’usage de ses mouvements.
Vers 4 h. 30, il nous a demandé la liste des autres épreuves à accomplir. Nous la lui avons donnée immédiatement. Il l’a conservée et étudiée longuement pendant près d’une heure et nous a fait connaître que cette fois, il désirait en affronter deux pour le lendemain.
La première consiste livrer un combat singulier et sans aucune arme avec un énorme gorille adulte, mesurant environ 1 m 85 et pesant 136 kilos. Ce gorille, comme aussi d’autres fauves qui auront à jouer leur rôle, appartiennent à l’un des chevaliers qui a bien voulu les mettre à la disposition de notre association pour servir de moyen d’expiation au marquis et ses émules. Ce gorille vit en liberté relative dans une fosse créée pour son usage et mesurant 20 mètres de long sur 15 de large et 6 de profondeur. Il est absolument indomesticable et nourrit envers l’homme une haine farouche. Il est extrêmement puissant et, pour corser la distraction, nous lui donnerons une lourde massue pour se rencontrer avec le marquis. Nous verrons si celui-ci aura le même succès envers Sam le gorille qu’il en a eu depuis vingt ans avec ses victimes.
La deuxième épreuve que le marquis demande également à effectuer demain consiste à franchir en vol libre et sans aucun balancier, aller et retour, une longueur de 25 mètres sur un câble d’acier de 4 millimètres de diamètre, tendu au-dessus d’une autre fosse dans laquelle se trouvent également en liberté quatre tigres splendides. Mais nous avons bien peur que le marquis n’ait pas à nous montrer ses talents d’équilibriste, car nous sommes sceptiques quant à l’issue de son combat avec Sam, surtout étant sans arme.
Il aura de la chance s’il parvient à le séduire.
En tout cas, il paraît toujours aussi calme et sûr de lui et, après qu’il nous eut informés, ce soir, qu’il désirait aborder ces deux épreuves l’une après l’autre, nous nous sommes demandé si cet homme avait réellement des nerfs pour pouvoir se dompter pareillement en face de dangers insurmontables comme ceux qui l’attendent demain.
Il est 5 h lorsque nous le quittons dans sa cellule, lui donnant rendez-vous pour la première épreuve demain matin, vers 10 heures. Peut-être a-t-il cru que, demain étant dimanche, le Seigneur lui viendrait en aide comme au temps des premiers chrétiens. Nous le lui souhaitons.
Pour les Chevaliers de Thémis, LEUR CHEF.
Le 3 octobre, Mme Passal reçoit une lettre mystérieuse disant notamment lui indiquer exactement l’endroit où son fils est inhumé.
La lettre signée « Les Chevaliers de Thémis » se termine par un immense point d’interrogation.
Voici comment se présentent modestement les « Chevaliers de Thémis » :
Nous avons l’honneur d’informer le public qu’une très puissante société secrète, formée par des personnalités appartenant à la haute aristocratie française, s’est constituée, il y a quelques mois, dans le but tout à fait nouveau de châtier les grands escrocs dont l’audace, depuis quelques armées, ne connaît plus de bornes.
La justice française, qui n’est plus qu’un vain mot, est bafouée et tournée en ridicule. Devant cet état de choses, notre société, qui a pris le titre de « Chevaliers de Thémis », a décidé de partir en guerre et d’entreprendre une sainte croisade, en vue de faire expier les grands escrocs par tous les moyens, même par la mort, lorsque leurs peines dérisoires sont terminées. Nous nous sommes jurés mutuellement, sous peine de mort pour les traîtres, de ne faillir en aucun cas à notre serment, de ne jamais révéler quoi que ce soit se rapportant, à nos personnalités, etc., etc…
Les « justiciers » amateurs expliquent minutieusement comment « cinq délégués » désignés pour cette « mission » ont emmené Passal jusqu’au lieu où il doit être enterré vivant, avertissant qu’un d’entre eux montera constamment la garde aux alentours et boucherait le tuyau d’aération au moindre cri poussé par Passal.
Et cette lettre – tapée à la machine – se termine ainsi : Maintenant, nous allons étudier le cas d’autres grands escrocs de haute envergure qui, pareils au marquis, n’ont pas payé assez cher leurs exploits et nous leur ferons subir les mêmes épreuves ou d’autres, que nous pourrions imaginer d’ici là. Notre volonté de continuer le programme que nous nous sommes fixé, loin de décroître, est plus que jamais bien décidée à le poursuivre envers et contre tous.
Lorsque la triste fin et l’odyssée du marquis sera connue du public — et il faudra bien que cela arrive un jour — nous sommes certains que cela rendra plus prudents les individus de son genre. Nous allons cesser nos communiqués momentanément et nous les reprendrons lorsqu’une autre victime sera tombée entre nos mains. Et, comme au début, notre devise est toujours : finis coronat opus.
Pour les Chevaliers de Thémis:
Leur chef.
Mme Passal n’est pas seule à recevoir de la correspondance des « Chevaliers de Thémis » : « Le Matin » déclare que depuis le 20 septembre il n’a cessé de recevoir des lettres signées « Chevaliers de Thémis », dans lesquelles ces « justiciers » racontent les supplices qu’ils font subir au « marquis de Champaubert ». De nouveaux courriers sont envoyés et indiquent que « Clément Passal va être enterré vivant et soumis au supplice de la faim (ou de la fin ?)».
Voici le texte de la dernière lettre qu’adressent les « Chevaliers de Thémis » au « Matin » : « Samedi vers 6 heures, nous avons profité de ce que le marquis de Champaubert était calme et silencieux dans sa cellule pour venir l’informer du sort que nous lui réservions. Nous lui avons minutieusement expliqué comment il allait souffrir terriblement de la faim, pendant des jours et des jours, puisque nous allions lui laisser la possibilité de respirer. Il n’a pas même fait mine de nous écouter et il est resté les yeux et le visage toujours égarés.
Voyant que nos efforts étaient en pure perte, nous l’avons informé que nous l’enterrerions cette nuit même, toujours sans qu’il manifeste le moindre sentiment. »
Les chevaliers décrivent ensuite en détail comment ils enterrent le marquis de Champaubert dans un grossier cercueil fabriqué avec une caisse qui a servi à transporter des tapisseries. « Avant de l’enterrer dans son tombeau, disent-ils, nous l’avons avisé que toute la nuit, nous monterions constamment la garde non loin de lui et qu’au moindre cri qu’il pousserait, quelqu’un lui fermerait la bouche. En réalité, nous l’avons abandonné purement et simplement à son sort, certains qu’il ne pourrait échapper à la mort dans un délai plus ou moins éloigné.
Nous considérons notre action contre le marquis comme virtuellement terminée et notre but atteint. Maintenant, nous allons étudier le cas d’autres escrocs de haute envergure qui, pareillement au marquis de Champaubert, n’ont pas payé assez cher leurs exploits. Nous leur ferons subir les mêmes épreuves ou d’autres que nous pourrions imaginer d’ici là. »
« Le Matin » ajoute : « Que faut-il conclure de cette formidable affaire ? »
D’autre part, n’est-elle pas pour le moins pittoresque et significative cette ultime missive également adressée à Mme Passal et signée du nom de Mme d’Orgeval : « Samedi j’ai tenu à être du nombre de ceux qui étaient désignés pour l’ensevelir car depuis plusieurs jours ma décision de le sauver était prise, comme vous allez le voir.
Le mardi 24 septembre, après sa chute en avion, c’est moi qui étais de garde de sa cellule de 9 à 10 heures pendant que les autres chevaliers tenaient un conseil au sujet de ce qu’on allait faire de votre fils.
Depuis trois jours, l’attitude fière et le courage de votre fils avaient transformé ma haine contre lui en une admiration sans borne que je dissimulais malgré tout.
Donc, vers 9 heures, j’entrai dans sa cellule, et lui demandai s’il souffrait beaucoup de la tête. Il avait les yeux fermés. Prise de compassion, je l’embrassai. Au contact de mes lèvres, il fut sur son séant et je ne peux en dire plus long sur ce qui se passa.
Néanmoins, je puis dire que j’ai vécu là, près de lui, des minutes inoubliables, comme je n’en avais encore jamais connues. Pour le sauver, je lui ordonnai de simuler la folie et de persévérer, quoi qu’on lui fasse subir, lui assurant que j’obtiendrais qu’on ne le mette pas à mort. J’ai tenu ma promesse, et vous indique où il se trouve pour que vous le sauviez, car il est certainement encore vivant.
Hier soir, j’ai quitté ma propriété dans le plus grand secret, emportant la machine à écrire sur laquelle j’ai frappé tous les communiqués, car c’étaient mes attributions. Cette nuit, je suis passée à 150 mètres du lieu où il est enterré, mais j’ai eu peur d’aller jusqu’à lui tant il faisait noir. Malgré tout, j’ai refait la bande blanche sur la route macadamisée et j’ai ajouté les deux croix blanches, puis je suis partie en auto jusqu’à Paris d’où je vous écris ce matin, harassée, mais délivrée d’un remords insoutenable.
Mais faites vite, car il doit souffrir horriblement et ses heures sont peut-être comptées. Dans la crainte que vous soyez absente ou souffrante, j’écris également à deux de ses amis dont j’avais relevé l’adresse dans son portefeuille afin que sa délivrance soit certaine. Je serais bien coupable envers vous et envers lui, mais je vous demande de me pardonner devant l’acte que je viens d’accomplir.
Entre votre fils et moi il y a désormais des liens indissolubles et je ne regrette rien.
Je pars en voyage et serai sans doute très longtemps absente pour fuir les représailles des autres personnes qui avaient juré sa mort. Ceux-là, je ne les crains pas, car au cas où ils me tueraient, leurs noms sont indiqués dans un testament que j’ai envoyé à mon notaire avant mon départ. Mais que votre fils se tienne sur ses gardes et qu’il se fasse toujours accompagner en tous lieux. Quand il vous reviendra, faites-lui lire cette présente et dites-lui que je n’oublierai jamais la nuit du 24 septembre. Qu’il ne m’oublie pas non plus et qu’il soit patient dans l’attente de mon retour que je ne puis fixer. Je lui demande encore une fois pardon ainsi qu’à vous-même, Madame, pour toutes les souffrances physiques et morales que j’ai pu vous causer.
À plus tard et courage, je ne l’oublierai jamais, jamais.
Agréez, Madame, l’assurance de ma plus profonde amitié désormais.
Mme d’Orgeval
 Cette missive, datée du 2 octobre, contient le plan et les précisions qui doivent « faciliter » la découverte du corps.
Cette missive, datée du 2 octobre, contient le plan et les précisions qui doivent « faciliter » la découverte du corps.
Deux autres habitants de Saint-Aubin reçoivent également une lettre semblable, lettre anonyme signalant que dans le bois de Verneuil-sur-Seine on a enterré vivant le marquis de Champaubert.
Un plan, joint à cette lettre, indique aussi l’endroit où est le cercueil.
L’un d’eux, nommé Bachelet, se rend à Paris et de là, en motocyclette, avec un ami, vont sur place pour se convaincre de l’exactitude des renseignements.
Hier matin, à l’aube, les gendarmes d’Ecquevilly (Seine et Oise) MM. Richard et Bertshy sont réveillés par les deux motocyclistes qui les prient de les accompagner dans le bois de Verneuil tout proche où, disent-ils, ils ont la presque certitude qu’un de leurs amis est enterré vivant.
Une demi-heure plus tard, les quatre hommes sont devant un talus ; les gendarmes ne sont pas peu surpris d’apercevoir de la terre fraîchement remuée d’où émerge de vingt centimètres environ un petit tuyau.
On creuse ; c’est facile, la terre étant meuble. À trente centimètres on trouve une caisse longue de 1 m 50, haute de 30 centimètres, sur le côté gauche de laquelle est fixé le tuyau de fonte. On fait sauter le couvercle, qui a été vissé par les fossoyeurs. Alors apparait le corps inanimé d’un homme couché sur le côté ne paraissant plus donner signe de vie, recroquevillé en « chien de fusil », vêtu seulement d’une chemise, la tête reposant sur un pantalon plié formant coussin.
C’est bien lui, c’est Clément ! s’écrient aussitôt Victor Bachelet, épicier, domicilié 38, rue de Tourville, à Saint-Aubin-Jouxte-Boulleng, et Guyvallet, mécanicien, demeurant 12, rue Jouet, à Maisons-Alfort.
Les gendarmes tâtent le corps ; il est froid. Clément Passal a succombé.
Dans le fond de la caisse, on voit encore quelques tablettes de chocolat à demi-rongées.
Clément Passal, le pseudo-marquis de Champaubert, l’homme aux cent noms et aux mille escroqueries, seigneur du prieuré de Dinard, animateur de la Canadian Motor, professeur de danse à la Bourboule, corrupteur de gardiens à la prison de Loos, émule de Rocambole, d’Arsène Lupin et de Fantomas, vient de trouver une mort horrible et rocambolesque digne de son existence extraordinaire et tourmentée.
L’enquête judiciaire commence aussitôt.
Toute une correspondance anonyme précédant le drame, avait bien dénoncé la vengeance de la secte les « Chevaliers de Thémis ».
Il y a quelques années, Passal occupait à Saint-Aubin, avec sa maîtresse Gisèle, une somptueuse villa dans laquelle il se livrait à l’élevage des pigeons. À cette époque, il se faisait appeler Simonin. Lors de sa condamnation, cette villa fut vendue, et Mme Passal, qui l’habitait depuis l’arrestation de son fils, refusa obstinément de s’en aller, au point que le nouveau propriétaire dut garder la vieille femme comme locataire pendant de longs mois. Dans le pays, le bruit ne tarda pas à courir qu’un magot était caché entre les murs de la propriété et que Mme Passal voulait attendre le retour de son fils, afin qu’il lui indique la cachette pour reprendre le trésor.
Les fameux « Chevaliers de Thémis » n’ont-ils pas eu vent de cette affaire. et n’ont-ils torturé le malheureux que pour lui faire dire où il avait caché le magot ? Simple hypothèse, qui ne laisse pas d’être troublante !
Bachelet présente la lettre qu’il a reçue le jeudi 3 octobre, dans l’après-midi :
Paris, 2 octobre 1929
Monsieur,
Ayant relevé votre adresse dans le portefeuille de Clément Passal, enterré vivant samedi dernier pour des motifs que je fais connaître à sa mère, à qui j’écris par ce même courrier, je vous avertis, ayant des remords, pour que vous puissiez le délivrer. Mais il n’y a pas une minute à perdre.
Il est dans le bois de Verneuil, situé entre Meulan et Verneuil, dans la Seine-et-Oise. Pour le trouver, prenez, en partant de Verneuil, la route macadamisée de grande communication n° 154. Environ à 1 500 ou 2 000 mètres après Verneuil, vous trouverez sur la route une grande bande blanche avec deux croix, une à chaque bout, et une autre croix au milieu, gravée dans le macadam.
À cet endroit, à gauche, se trouve une route en construction momentanément abandonnée. À environ 270 pas sur cette route, on arrive à l’endroit précis où est enterré Passal.
La fosse a été creusée dans le talus qui se trouve sur le côté droit, de façon que le tuyau par où il respire donne dans le caniveau.
Signé Mme d’Orgeval
Un plan très net est tracé sur le second feuillet de cette lettre dactylographiée sur papier gris perle et qui a été mise à la poste de la rue Gluck à Paris, le 2 octobre (vers 18 heures précisera l’enquête).
Guyvallet ajoute : « Bachelet, ami comme moi de Clément Passal, est venu me trouver à minuit ; nous sommes partis tout de suite. Nous avons vu la raie blanche, le tuyau sur la fosse ; nous avons crié : Clément ! Clément ! dans le tuyau. On n’a pas répondu. »
Joseph-Eugène-Clément Passal, né à Saint-Denis le 29 septembre 1892, dit Simonin, dit Gouraud, dit marquis de Vaudrey, dit marquis de Champaubert, etc., a un passé plus qu’orageux.
Bientôt sous les frondaisons jaunies par l’automne du joli bois de Verneuil, passe tout un défilé d’automobiles. Elles contiennent le capitaine de gendarmerie Henry, de Saint-Germain ; M. Roussel, juge d’instruction à Versailles ; le docteur Detis, médecin-légiste ; le commissaire divisionnaire Gabrielli, chef de la première brigade mobile, et les inspecteurs Adam, Faure et Malecot.
Que supposer ? Se trouve-t-on en face d’une secte de fanatiques. Les policiers s’efforcent de vérifier toutes les indications qui leur parviennent. Ils ont notamment relevé les empreintes du cadavre afin d’identifier scientifiquement le marquis de Champaubert qui, jusqu’ici, a été formellement reconnu par un de ses anciens camarades.
Tandis que le cadavre est transporté à la fondation Delapierre, à Verneuil, où le docteur Detis commence l’autopsie, M. Roussel entend MM. Bachelet et Guyvallet. Le premier déclare alors que Clément Passal, son voisin à Saint-Aubin, a disparu depuis le 16 septembre de son domicile ; que, depuis, Mme Passal mère a reçu une succession de lettres signées « Le chef des Chevaliers de Thémis » lettres dans lesquelles on l’informe que son fils est séquestré par cette secte qui, se substituant à la justice, veut lui faire expier ses méfaits. L’avant-dernière missive, datée du samedi 28 septembre, annonce la « mise en bière de Clément Passal » après des tortures inouïes ; la dernière est analogue à celle reçue par M. Bachelet, publiée plus haut.
Parmi les tortures infligées par les Chevaliers de Thémis à leur victime, les deux dernières sont particulièrement tragiques, l’une consistant à lancer Passal d’un avion en vol, muni d’un parachute disposé de façon qu’il ne puisse s’ouvrir qu’au dernier instant. Il aurait été ensuite placé devant un fil relié à un appareil électrique. Passal devait tirer sur ce fil à coups de revolver et le couper avant le quatrième coup, sous peine d’être électrocuté.
L’autre supplice, c’est l’enterrement du malheureux, qui a été réalisé comme on sait.
- Bachelet ajoute que, lorsque Mme Passal a reçu la lettre où on lui annonce la mise en bière de son fils, il se présente, avec cette lettre, dans les bureaux du quotidien Le Matin qui a déjà reçu, d’ailleurs, une série d’épîtres des « Chevaliers de Thémis » et où il rencontre un haut fonctionnaire de la police. Le fantastique de cette révélation empêche les personnes qui écoutent M. Bachelet d’ajouter foi à ses dires.
Deux jours après la découverte du corps, M. Bachelet revient au Matin avec un bulletin de bagages. Accompagné d’un rédacteur de ce journal et d’un fonctionnaire du contrôle des recherches, le témoin se rend à la gare Saint-Lazare où on lui délivre le colis qui contient les vêtements de Passal (moins la chemise et le pantalon).
Dans la poche du veston de l’ex-marquis de Champaubert se trouve un testament olographe de deux grandes pages. Passal annonce qu’il va mourir sous les coups des « Chevaliers de Thémis », après avoir subi six supplices. Il spécifie quelques legs pour des amis, sa mère étant sa légataire universelle. Il termine ainsi : « Maman ! maman ! ma dernière pensée sera pour toi. »
- Roussel en est là de l’audition, quand on vient lui communiquer les résultats de l’autopsie.
Le docteur Detis a constaté que le défunt avait les poumons très congestionnés et présentait des symptômes d’asphyxie, mais sans pouvoir déterminer les causes exactes du décès. Le médecin légiste croit que !a mort remonte cependant à plus de quarante-huit heures. Il a prélevé les viscères, qui vont être envoyés au laboratoire de toxicologie à Paris afin de savoir si la victime n’a pas été empoisonnée avant d’être mise dans la caisse.
Le praticien a relevé sur le corps des ecchymoses aux coudes, aux genoux, derrière la tête, ecchymoses qui paraissent être dues aux efforts désespérés de l’enterré vivant pendant son atroce agonie. Par ailleurs, le docteur Detis a trouvé dans l’estomac des matières qui sont sans doute du chocolat (on se souvient des tablettes trouvées dans le cercueil.)
Pendant l’audition de son ami Bachelet, M. Guyvallet déclare que Clément Passal avait l’intention de publier le récit de sa vie aventureuse. Le « Petit Parisien » confirme que Passal allait publier ses mémoires et donne à ce sujet les renseignements suivants : « Passal avait reçu en juillet une lettre d’une maison d’éditions lui faisant des offres pour la publication de ses mémoires. Un premier contrat fut conclu ».
J’ai reçu de lui, dit Guyvallet, une carte de Deauville, il y a environ un mois. L’affaire est en bonne voie, écrivait Passal, j’ai déjà un projet de contrat. D’ailleurs j’ai des amis puissants qui me commanditent. M. Guyvallet ajoute que Clément lui aurait confié que Me Gasnier-Duparc, son défenseur, s’intéressait à ces mémoires, ainsi qu’une dame qu’il ne connaissait que sous le nom de Mme d’Orgeval.
Au sujet des « mémoires », voici ce que nous avons appris : Passal a été libéré de prison fin juillet 1929. Dans les premiers jours de septembre, il reçoit une lettre lui disant qu’une société d’éditions lui fait des offres pour publier ses mémoires. Le rendez-vous est fixé à Deauville pour le 9. Passal va donc à Deauville. Il signe avec les « éditeurs » une première partie de contrat et rentre à Saint-Aubin enchanté, disant qu’il doit retourner à Deauville pour finir l’affaire. Le 17 septembre, il repart donc pour Deauville, et … disparaît.
C’est cette histoire de publication qui fait naître l’hypothèse d’une mise en scène ratée et tragique. Passal, pour avoir de la publicité gratuite, désire-t-il à nouveau faire parler de lui ? Son esprit inventif, il en a donné tant de preuves, lui aurait fait imaginer cette longue série d’épisodes rocambolesques : la disparition, la séquestration, les Chevaliers de Thémis et, finalement, l’enterrement.
Mais le journal qui reçoit les lettres des « Chevaliers », la police, flairent l’amorce ; ils laissent sans publicité la disparition et les supplices de Champaubert. Et lorsqu’il se fait enterrer, pour de bon, on ne le croit pas davantage ; ses fossoyeurs bénévoles préviennent, inquiets, mais trop tard. Ce n’est là, répétons-le, qu’une hypothèse ; les enquêteurs la trouvent si séduisante que c’est dans cette voie que s’orientent leurs premières investigations.
Le fait que le docteur Detis n’a constaté aucune violence sur le prétendu supplicié vient renforcer encore l’hypothèse, et Me Gasnier-Duparc l’envisage également : nous avons pu joindre, en effet, l’éminent avocat du barreau de Saint-Malo qui déclare : « J’ai défendu Clément Passal devant les tribunaux de Saint-Malo, de Rennes, du Havre et de Paris. Je l’ai perdu de vue depuis deux ans, lorsqu’il a comparu à Lille. Je n’ai plus eu depuis de ses nouvelles. »
Comme nous faisons connaître à Me Gasnier-Duparc les intentions littéraires de son ex-client et les encouragements que Passal prétend avoir reçus de lui à ce sujet, l’avocat précise : « Ce garçon était vraiment un type extraordinaire ! Je le crois un peu fou. Il a été interné à Rennes d’ailleurs, mais on l’a considéré, par la suite, comme un simulateur. Quoi qu’il en soit, jamais il ne m’a parlé de ses « mémoires », et je ne l’ai jamais encouragé, par commandite ou autrement, à les publier. Je ne connais pas cette Mme d’Orgeval. »
Enfin, quand il eut connu par nous la fin tragique de Passal dans son cercueil à tuyau, Me Gasnier-Duparc conclut : « Cette tuyauterie me rappelle l’affaire du prieuré de Dinard. C’est bien dans la manière du « marquis de Champaubert ».
Bien que sortant peu, Passal n’en a pas moins opéré quelques allées et venues depuis son retour chez sa mère.
C’est là, 27, rue de Tourville, à Saint-Aubin-Jouxte-Boulleng, que nous trouvons Mme Passal, petite vieille ratatinée qui semble bien avoir près de soixante-dix ans. Elle est assise sur une chaise, dans la cuisine, toute recroquevillée sur elle-même et secouée de sanglots. Elle ignore la mort de son fils, mais son inquiétude lui fait deviner le tragique événement.
Ils l’ont tué, dit-elle, et ils l’ont fait souffrir. Il est mort. Je sais qu’il est mort et on ne veut pas me le dire Que feriez-vous ici, près d’une pauvre femme comme moi, s’il n’était pas mort ?
Nous ne pouvons rien lui dire, hélas, d’autant plus que Mme Bachelet, de son côté, s’inquiète de ne pas voir rentrer son mari, et c’est de ces deux femmes en pleurs que nous obtenons le récit suivant : depuis le 17 septembre, jour de son départ pour Deauville où il allait voir Mme d’Orgeval pour signer le contrat de ses mémoires, nous dit Mme Passal, nous ne l’avons pas revu et, depuis le 20 septembre, je n’ai pas de nouvelles de lui. Sa dernière lettre est datée de ce jour ; il m’annonce « qu’il était aux mains d’une bande qui l’avait attiré dans un guet-apens ». Mon inquiétude date de ce jour et, depuis, je crains pour sa vie. Par la suite, en effet, j’ai reçu d’autres lettres, de ses geôliers, celles-là. Deux d’entre elles sont dactylographiées ; on me parle des supplices qu’on lui fait subir, on m’annonce même qu’il est condamné à mort, et c’est signé les « Chevaliers de Thémis ». Ces jours-ci, enfin, le dernier envoi est accompagné d’un bulletin de consigne de la gare Saint-Lazare concernant les deux valises que mon fils a emportées avec lui le 17 septembre. C’est M. Bachelet qui a bien voulu aller à Paris et me ramener ses effets. Il y a dans les valises son costume, sa montre et des papiers divers.
Et puis, il y a la lettre la plus terrible de toutes : je l’ai lue hier. Quelqu’un qui se dit leur complice, soi-disant pris de remords, me dit que mon fils a été enterré vivant dans la forêt de Verneuil ; on l’a mis dans un cercueil avec un tuyau de caoutchouc pour lui permettre de respirer ; un plan est joint, indiquant l’endroit exact où il est enterré. M. Bachelet, qui a reçu un plan identique, a bien voulu retourner à Paris mettre la police au courant de ces faits. Nous attendons anxieusement son retour, mais je « sens », monsieur, que mon fils est bien mort, il est mort de façon atroce et vous ne voulez pas me le dire !
L’émotion est intense à Elbeuf, où le « marquis de Champaubert », d’abord employé besogneux, puis gros éleveur de pigeons, et enfin vrai nabab, était fort connu depuis que le 26 septembre 1924, après l’affaire du castel du Prieuré, à Dinard, on arrêtait, au n° 2 bis de la rue Céleste, où il la logeait princièrement, son amie Gisèle de Gisors, fausse marquise et vraie complice dans l’affaire du chloroforme.
Le silence s’était fait sur celui qui s’appelait réellement Clément Passal. On plaignait surtout sa pauvre vieille mère âgée de 70 ans, que les frasques de son fils déprimaient.
Maintenant, on est atterré. La mort tragique du faux marquis a fait oublier ses aventures, et l’on pense encore plus à sa vieille maman, qui désormais seule dans son modeste appartement du numéro 27 de la rue de Tourville, sait que son fils n’est plus.
Les journaux ont apporté vendredi soir l’effroyable nouvelle, mais déjà hier soir Mme Passal savait. « Ah ! monsieur ! disait-elle, ils me l’ont tué ! Ils me l’ont tué. ! Je vous le dis, moi, qu’il est mort. Je le sais. Ils l’ont fait mourir. On me le cache et pourtant, c’est vrai. Vous ne voulez pas me le dire, mais vous le savez. Pourquoi d’ailleurs seriez-vous ici sans cela ? »
Nous avons relaté dans quelles conditions Félix Bachelet, épicier à Saint-Aubin-Jouxte-Boulleng (voisin et ami de Clément Passal), a été amené à signaler à la gendarmerie d’Ecquevilly l’enterrement du faux marquis de Champaubert.
M. Bachelet, qui a été entendu la veille par le Juge d’instruction, fut prié de se présenter à la sûreté générale pour y préciser ses premières déclarations. Au cours de sa déposition, le témoin indique aux enquêteurs les noms de quelques personnes qu’il connait comme intimes de Passal et qui peut-être, dit-il, en sauraient plus long que lui sur l’affaire.
Voici, comment MM. Ducloux, contrôleur général au service des recherches, Bayard et Jobard, commissaires à la sûreté générale, que secondent les inspecteurs Bouscatel, Lauret, Raymann et Reynier, Gabrielli, commissaire divisionnaire de la première brigade mobile et ses « mobilards », démêlent le difficile imbroglio.
De fil en aiguille, Bachelet cite, entre autres, M. Pierre Durot, marchand forain, demeurant 11 rue du Maréchal-Gallieni, à Elbeuf, qui, ayant reçu comme lui une lettre aussi inquiétante sur le sort de Passal, est venu le prier de l’accompagner dans une démarche qu’il a faite au journal Le Matin.
Le renseignement ayant été aussitôt transmis à la police mobile de Rouen, M. Jouanne, commissaire, signifie à M. Durot qu’il doit se présenter de toute urgence à la sûreté générale. À 12 h, M. Durot débarque gare Saint-Lazare, et quelques minutes plus tard, ce témoin est entendu par les enquêteurs. Pendant plusieurs heures, il prétend ne connaître de l’affaire rien de plus que M. Bachelet, c’est-à-dire avoir simplement reçu des lettres des « Chevaliers de Thémis ». Mais, des contradictions ayant été relevées entre les deux témoignages, M. Durot se rend compte du danger qu’il court en dissimulant la vérité et, à son tour, donne le nom d’un troisième témoin, Henri Boulogne, docker « à ses moments perdus », à Dunkerque, et présentement domicilié 52, avenue du Maréchal-Foch, à Villennes-sur-Seine.
Devenu soudainement plus loquace, Durot expose son rôle dans l’affaire. Ami d’enfance de Passal, et obéissant à un sentiment d’affection qui le lie malgré tout à celui-ci, il a accepté de prêter son concours à la tentative que ce trop inventif escroc doit effectuer pour gagner de l’argent par la publication de ses « Chevaliers de Thémis ».
Voici ce qu’imagine Clément Passal :
1er – répandre, par la presse, le bruit de sa séquestration par une secte de justiciers mystérieux,
2° – ce premier résultat obtenu, continuer à « faire marcher la presse » par la description des tortures que les « Chevaliers » lui infligent
3° – annoncer, toujours par les mêmes moyens, sa condamnation à mort avec un luxe, de détails horrifiques ;
4° – se faire enterrer vivant et laisser aux journaux alertés le soin de le déterrer et de le délivrer devant tous les cinémas possibles.
Le « marquis de Champaubert » organise donc sa disparition ; il a besoin, d’un complice à tout faire qui soit la discrétion même. Il fait appel à Henri Boulogne, qu’il a connu à la maison centrale de Loos-lez-Lille pendant leur commune détention. C’est d’ailleurs à Loos que le schéma de ce rocambolesque scénario a été composé par Clément Passal, et Boulogne en a été le confident enthousiaste.
Recherchant une publicité inédite pour le lancement de ses mémoires, Passal s’est fait enterrer vivant par un complice, Henri Boulogne.
Interrogé sur ses relations avec le marquis, Boulogne fait les déclarations suivantes : « J’avais fait la connaissance de Passal à la maison d’arrêt de Loos-lez-Lille, où j’étais détenu en même temps, que lui. Notre amitié s’étant encore resserrée, Passal me promit de s’occuper de moi lorsque nous serions libérés. Cette année, au mois d’août, alors que j’habitais Dunkerque, je lui écrivis à Saint-Aubin. Il me répondit par un télégramme ainsi conçu : Viens hôtel X… Faubourg Saint-Denis et demande Georges Leleu, ALPHONSE.
J’arrivai à Paris le 12 septembre et retrouvai Passal, qui m’attendait à la gare du Nord. Nous partîmes pour Saint-Germain, où nous séjournâmes deux jours dans un hôtel proche de la caserne des dragons. Le 14, nous revînmes à Paris. »
Pour disparaitre, il faut trouver une retraite : le 14 septembre 1929, deux hommes, modestement vêtus et dont le visage ne laisse dans la mémoire de l’employé qui les reçoit aucun souvenir précis, se présentent dans une agence de location de Villennes-sur-Seine, et demandent à louer une villa meublée, pour un mois, du 15 septembre au 15 octobre. On leur propose la villa « Les Pavots », 52 avenue du Maréchal-Foch, au prix de 600 francs. Ils acceptent, acquittent immédiatement la location et prennent possession de l’appartement dès le lendemain. L’un d’eux déclare s’appeler Fournier et demande que le reçu soit fait à ce nom. Sans avoir l’aspect seigneurial du prieuré de Dinard où jadis Passal a, comme on le sait, installé la chambre au chloroforme pour bijoutiers, la villa offre toute sécurité.
L’année précédente Physiopolis s’est installée sur l’île voisine du Platais. Le plus célèbre propriétaire d’une parcelle de l’île est certainement Emile Zola. Son ami Cézanne aimait s’y installer pour y peindre les paysages de la Seine. En septembre 1880, Zola inaugure le chalet, qu’il y a installé et baptisé « Le Paradou », qui est un kiosque norvégien acheté lors de la démolition de l’Exposition de 1878 et transporté à grands frais. Après sa mort, son épouse Alexandrine vend, au printemps 1903, la propriété de l’île au libraire parisien Belin.
Cette copropriété inaccessible sans bateau privé, est fondée en 1928 par deux médecins hygiénistes, les frères Gaston et André Durville. Ceux-ci portent une utopie de leur temps, fondée sur l’harmonie avec la nature et le sport. Sur « l’île des naturistes » en réalité en deux pièces et slips de bain, ils choquent agriculteurs et grands bourgeois en villégiature, Médanais et Villennois.
Cependant, la question de la tenue n’est pas encore définitivement tranchée. On sait seulement que le costume de ville est interdit sur les stades et que toutes les tenues sportives, par contre, sont autorisées : slips, petites culottes, maillots de bain, il y a de tout.
- Louis-Charles Royer écrit dans un de ses livres, au sujet de Villennes : « J’ai vu des jeunes filles commencer par enlever simplement leurs souliers et leurs bas. Puis, la caresse de l’air et du gazon opérant, se promener en combinaison. Le soir, elles en étaient au slip. Et ravies. »
La création d’un stade isolé de nu intégral fut un instant envisagée ; mais ce projet fut bientôt abandonné, pour de multiples raisons. […]
Enfin, la tenue minimum est ainsi fixée : pour l’homme, le slip, pour la femme, le slip et le cache-seins obligatoire. On recommande l’emploi de teintes vives ou du noir ; le blanc, « qui donne l’illusion du linge et qui déshabille celui qui le porte », est déconseillé.
Le nu intégral est formellement interdit aux adultes, même pour la baignade. Il est autorisé pour les enfants ayant moins de 5 ans.
En 1929, le slip constitue une tenue d’avant-garde : pour bien comprendre quelle audace il représente, il suffit de se rappeler que les femmes, et même la plupart des hommes, portent encore sur les plages le maillot complet, descendant jusqu’à mi-cuisses. Depuis, le slip et le « deux-pièces » ont fait leur chemin…Le slip nous paraît aujourd’hui tout à fait banal.
Après avoir rappelé que l’école naturaliste est née dans la maison d’Émile Zola, les auteurs évoquent les naturistes qui ont succédé, dans l’île, à l’écrivain et à ses amis Maupassant et Huysmans : « Est-ce pour rendre à la vérité – même quand elle est d’une beauté contestable – un hommage semblable, que les « naturistes » ont choisi, pour leurs démonstrations et leurs divertissements, l’île de Villennes ? Les naturalistes, du moins, ne mettent à nu que les âmes. »
Les nouveaux locataires de la villa « Les Pavots » ne sont pas bruyants. Leurs voisins les ignorent. Aucun bruit, aucun chant ne sort de la villa. Quelques allées et venues on ne peut plus naturelles. Le nom du locataire est vraiment tout un programme.
Le 17 septembre, Passal quitte donc Saint-Aubin, disant à son entourage qu’il se rend à ̃Deauville pour signer avec Mme d’Orgeval son contrat d’édition des fameux « Mémoires ». Au lieu d’aller à Deauville, il part se terrer aux « Pavots ».
Le 18, Passal vient à Paris faire l’acquisition d’une machine à écrire et, le lendemain, il met au courant ses compagnons de ce qu’il compte faire. Pendant une semaine, Passal et Boulogne vivent seuls dans la villa. Chaque jour, Passal tape à la machine les longs communiqués, les manifestes des « Chevaliers de Thémis », que Boulogne, presque chaque jour, vient mettre à la poste à Paris à l’adresse de l’Agence Havas et du Matin.
Les manifestes ne paraissent-pas ; mais Passal est pris dans l’engrenage : il lui faut suivre son plan jusqu’au bout. Les journaux, espère-t-il, seront bien obligés de « marcher » quand on le déterrera.
Enfin, le 25, nous vînmes tous deux Paris, confesse Boulogne, afin de faire acquisition des planches devant servir à la confection du cercueil. Nous nous rendîmes successivement chez M. Roy, rue des Vinaigriers, ou nous passâmes commander le bois qui nous était nécessaire, puis aux établissements Person, 8, passage de l’Atlas, où nous achetâmes le tuyau d’aération, enfin, chez divers fournisseurs, pour les scies, marteaux, tournevis, clous et vis pour le macabre travail. Le surlendemain je revins seul prendre livraison des planches. Ayant frété un taxi sur lequel je chargeai mon fardeau, je me rendis à la gare Saint-Lazare où je fis enregistrer mes planches pour la gare la plus proche de Villennes, d’où je les transportais à la villa. Pendant que j’étais à Paris, Passal se rendit dans le bois de Verneuil afin de repérer un endroit propice à l’inhumation.
Le lendemain je l’accompagnais au point qu’il avait choisi et, en rentrant, nous entreprîmes de construire le cercueil, opération que nous terminâmes le dimanche. Passal me communiqua alors ses dernières impressions. Le lundi, dans la villa, Passal, qui voulait éprouver la caisse, décida de se livrer à un essai de résistance. Le soir, il y prit place et je refermai hermétiquement le couvercle. Il passa la nuit, de 21 heures à 5 heures du matin, dans son inconfortable prison et se trouvait ainsi dans les conditions exactes dans lesquelles il se trouverait lors de l’épreuve définitive.
Ça ira, déclara-t-il le matin en sortant fatigué, mais satisfait. C’est alors qu’il écrivit trois longues lettres l’une à sa mère, l’autre à Durot et la troisième à un de ses amis. Le mardi, vers 21 h. 15, nous quittâmes la villa, Passal et moi, emportant le cercueil préalablement démonté en 6 panneaux, une pelle et une pioche et nous gagnâmes l’endroit convenu dans le bois de la Justice.
Pendant que Passal assemblait à nouveau les planches, je me mis à creuser la fosse.
Quand tout fut prêt, Passal retira ses chaussures et son paletot. Après m’avoir remis 150 francs, il pénétra par le tonneau et s’installa à côté du tuyau d’aération. Il avait emporté dans la poche de son pantalon – qu’il devait d’ailleurs retirer par la suite dans son cercueil afin de s’en servir d’oreiller – une demi-livre de chocolat. Pendant un quart d’heure environ il me parla pour me rassurer, me disant de ne pas m’en faire et me recommandant de mettre les lettres qu’il m’avait confiées au bureau de poste proche de l’Opéra.
Puis sur son signal, je descendis le cercueil dans la fosse que je comblai ensuite.
Je jetai près de la ligne blanche que Passal avait lui-même tracée sur le chemin pour servir de repère, la pelle et la pioche désormais inutiles. Je ne rapportai à la villa, où j’arrivai vers 7 heures, après avoir marché une heure environ, que les chaussures et la veste de Passal.
Mercredi, vers 19 heures, en rentrant de Paris où j’avais mis les trois lettres à la poste de la rue Gluck, je m’approchai de la tombe muni d’un long tuyau en caoutchouc, afin de faire boire Passal. Je l’appelai, mais n’obtint pas de réponse. Je frappai avec vigueur, mais ce fut toujours le même silence.
J’en conclus que Passal devait être évanoui, car, bien que très inquiet, je ne pensais cependant pas qu’il fût mort.
Ce matin, en lisant, les journaux, j’appris avec terreur la façon tragique dont se terminait cette mystification. Je m’aperçois, seulement maintenant de la gravité du cas dans lequel je me suis mis. Je ne m’attendais nullement à pareille fin.
Après cet interrogatoire, Henri Boulogne est gardé à la disposition de la justice. Il sera entendu à nouveau aujourd’hui ainsi que Mme Bachelet, que deux inspecteurs sont allés chercher hier soir à Saint-Aubin.
Aucun chef d’inculpation n’a jusqu’ici été retenu contre le prévenu. Le juge d’instruction aura bientôt à se prononcer sur les suites judiciaires que comportera l’affaire. Il est probable que le délit d’homicide par imprudence sera retenu contre Boulogne.
Ajoutons que les auditions et les investigations se poursuivront aujourd’hui. Les enquêteurs ne considèrent pas le problème comme entièrement résolu. Il comporte en effet encore plusieurs inconnues. L’histoire que raconte Boulogne est-elle rigoureusement exacte ?
D’autres complicités ne sont-elles pas intervenues ? Si le « marquis » a organisé toute cette machination pour lancer ses mémoires, ces mémoires doivent exister : où sont-ils ?
Le marquis a vraiment une âme d’organisateur. Avant de jouer le dernier acte de la comédie qu’il a inventée, il écrit à son ami Pierre Durot une lettre où il donne ses derniers ordres. On verra en la lisant que Clément Passal a pensé à tout. Voici le texte de la missive :
Mon cher Pierre,
Avant d’entreprendre le dernier acte, je t’écris ce petit mot pour te faire mes dernières recommandations. La première, et la plus importante est discrétion de tous. La seconde : courage et persévérance, puisque rien n’est malhonnête. En partant de la villa, évitez toutes contestations. Je te charge de prendre une machine à écrire et tout ce que je laisse qui m’appartient : paletot, blouse grise, dictionnaire, chaussures, escarpins, etc. Pour emporter tout cela, emporte un grand panier en osier tressé, très bon marché, assez grand pour contenir ma machine à écrire, qu’il ne faut laisser voir à aucun prix. Prends-la avec fermeture à clef, afin que chez toi, aucune indiscrétion ne puisse se produire du côté de ta propriétaire. Reste le moins possible absent et, en arrivant à Elbeuf, laisse ton panier en consigne pendant quelques jours et ensuite, reviens le chercher avec la voiture. Fais bien en entier comme je t’indique, j’ai une raison et on n’est jamais assez prudent.
Donne ton adresse à Henri (Boulogne), qui, lui, te donnera les siennes.
Garde tout ce que tu emporteras m’appartenant jusqu’à mon retour. Ne vends rien, surtout.
Tranquillise ma mère et dis-lui que tout va et ira très bien, quelque épreuve que je traverse. Je laisse environ 150 francs à Henri. S’il a besoin d’argent, pour partir, tu lui en donneras sur les cautions de 300 et 100 francs (300 francs de cautionnement pour la villa et 100 francs pour l’électricité). En ce qui concerne les outils, vous vous arrangerez tous les deux. Je n’en ai plus besoin. Embrasse de toutes tes forces ma bonne vieille maman, chérie, et dis-lui que je serai là avant peu, pour commencer toute l’œuvre que je me suis fixée.
Embrasse bien fort également Alice et Jacqueline sans oublier tous nos amis et amies. Donne une bonne poignée de main à Félix et à sa dame (M. et Mme Bachelet), ainsi qu’au petit Pierrot. Que tout le monde ait confiance absolue en moi. Bref, je ne vois plus rien à te dire « vieille chose » (sic). Si ce n’est qu’Henri est le roi de la soupe à l’oignon et l’oignon fait la force !
Quant à toi, vieille chose, tu resteras toujours le prince des rognons et tu nous a bien possédés, avec les tiens, pour nous avoir refilé des rognons pareils, vieille chose !
Allons, au revoir, mon vieux Pierre et sois confiant quoi qu’il arrive.
Clément.
P.-S. Je te laisse ma photo à toutes fins utiles dans le cas où tu aurais à la remettre à un rédacteur du Journal ou à t’en servir au cours de conversations que tu pourrais avoir avec des directeurs ou des metteurs en scène de films cinématographiques.
Nous avons pu visiter la mystérieuse demeure de Villennes-sur-Seine où le pseudo-marquis de Champaubert et son ami Boulogne, alias Fournier, préparèrent l’abracadabrante mystification qui devait si mal finir. La maison baptisée « Les Pavots » est un pavillon assez banal, à un étage, sur un rez-de-chaussée surélevé au milieu de deux jardinets l’un sur l’avenue, l’autre donnant le long de la ligne du chemin de fer de Paris au Havre. Un modeste perron, de cinq à six marches nous conduit à la porte d’entrée qui s’ouvre sur un petit couloir.
Au rez-de-chaussée, se trouvent une salle à manger, un salon, une cuisine, les commodités, et, sous l’escalier qui monte au premier, un petit réduit où s’entassent encore des lattes de caisses, fort probablement de celles qui servirent à confectionner le grossier cercueil du faux marquis.
Dans le buffet de la salle à manger, quelques provisions. Sur la table, une assiette remplie de bouts de cigarettes. Dans un coin, une paire de chaussures de drap blanc, assez ternies. Une horloge œil-de-bœuf anime, seule, de son monotone tic-tac cet intérieur déserté.
Au premier étage, trois chambres à coucher – deux grandes et une petite – et un cabinet de toilette. Seules, les deux grandes chambres ont été occupées. Sur les rayons d’une armoire sont rangés une chemise, un faux-col, une paire de souliers jaunes et des babouches. Sur une chaise, encore des provisions : chicorée, café, oignons, farine. Dans l’autre pièce, le lit est à peine défait et a encore ses draps, sur lesquels traîne un roman moderne. Sur un guéridon servant de table de nuit une assiette encore remplie de mégots. C’était certainement la chambre du pseudo-Fournier. Nul objet, pas le moindre document se rapportant à la mystification fatale : la police les a saisis au cours de la perquisition qu’elle a effectuée dans l’après-midi.
Dans le jardin, avant de partir, l’éclair de magnésium du photographe n’attire pas la moindre curiosité. À partir de 9 heures du soir, l’avenue du Maréchal-Foch est solitaire : le marquis de Champaubert et son ami Boulogne ont pu y préparer en toute tranquillité le tragique ensevelissement. Ils sont passés inaperçus.
Le cercueil dans lequel a été enterré le faux marquis de Champaubert a été amené, hier matin, au palais de justice de Versailles sur un camion automobile.
Lorsqu’il fut déchargé du camion, un attroupement se forma bientôt sur la place des Tribunaux. Avec l’aide de deux agents de police, le chauffeur put monter le cercueil jusqu’au greffe, situé au deuxième étage. Il figurera parmi les pièces à conviction.
- Roussel, juge d’instruction, qui est chargé de suivre cette affaire, va délivrer le permis d’inhumer puisque l’autopsie a été pratiquée par le médecin légiste.
Elbeuf, 6 octobre – Par téléphone – de notre envoyé spécial
Pauvre mère, étendue à demi-paralysée sur son lit et qui, contre toute espérance, attend dans le silence horrifiant de la nuit, son fils qui, pour avoir voulu jouer avec l’image de la mort, a succombé de la plus atroce manière.
Mme Passal, hier encore, alerte, semble anéantie aujourd’hui. La raison et la parole n’ont plus chez elle leur succession logique.
– Mon pauvre petit ! ne cesse-t-elle de répéter. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas croire. Ses amis sont, en somme, ses meurtriers ? dit la maman.
– Certains de ceux qui ont connu Clément vous diront « C’était un escroc ! »
– Eh bien, poursuit la pauvre femme, mon fils était le meilleur des enfants et le plus tendre et cela rachetait, à mes yeux, tant d’erreurs !
Hélas, nos amis, qu’ont-ils fait de mon fils.
Mon fils, ajoute-t-elle, est certainement le premier responsable de l’affaire. Je le sais par trop audacieux.
Il a été fort capable d’inventer sa rocambolesque histoire de Vernouillet.
Fort communicatif, il aura su entraîner dans cette macabre aventure ses trois amis. Hélas ! mon fils n’est plus, mes jours sont maintenant comptés !
Le journal Le Petit Parisien apporte des précisions sur la villa « Les Pavots » : en venant de Poissy, la villa est tout au bout de Villennes-sur-Seine, la charmante localité bien connue des naturistes.
Villa ? C’est beaucoup dire. Il s’agit simplement d’un petit pavillon à un étage dont la façade, protégée contre les regards indiscrets par un épais rideau de feuillage [aujourd’hui disparu], donne sur l’avenue du Maréchal-Foch.
Derrière, un jardin exigu, coupé au fond par la voie ferrée. Autour, quatre pavillons semblables appartenant tous au même propriétaire, M. Cassagne, commerçant à Paris, rue des Entrepreneurs. Celui-ci loue habituellement ses pavillons par l’intermédiaire d’une agence de location et c’est aux directeurs de cette agence que s’adressa dans les premiers jours de septembre M. Durot. Il demandait s’il y avait une villa à louer pour un mois et quelles seraient les conditions. Il agissait – dit-il – pour le compte d’un « M. Fournier » auquel il était chargé de transmettre les renseignements qu’on lui donnerait. On lui proposa « Les Pavots », et le lendemain « M. Fournier » téléphonait à l’agence pour donner son acceptation ; il louait du 15 septembre au 15 octobre le pavillon pour la somme de 600 francs. Quelques jours plus tard, M. Fournier, alias Passal-Champaubert, venait lui-même verser le prix de la location et prenait possession du pavillon en compagnie d’Henri Boulogne. Comme on pense bien, les deux hommes évitèrent toutes relations de voisinage et on les voyait si peu qu’on ne les nomma plus que les « mystérieux des Pavots ».
Je ne les vis qu’une seule fois, nous dit une voisine, et leurs allures me paraissaient bizarres. J’eus l’impression que ces gens se cachaient et qu’ils n’avaient point la conscience tranquille. J’en fis même la réflexion à une de mes amies, mais, celle-ci m’ayant fait remarquer qu’il s’agissait sans doute de personnes voulant se reposer quelques semaines en toute tranquillité, je ne m’en occupais plus. Mais tout de même, je vous assure, souvent je pensais, et non sans inquiétude, aux solitaires du petit pavillon.
Délaissant pour un temps les manifestes, Passal, secondé par Boulogne, qui, depuis le début de son internement volontaire, lui sert aussi de cuisinier, se fait menuisier. C’est Boulogne qui prend les mesures. La bière, avec son tuyau, est totalement terminée le 30 septembre au soir.
Mais il faut s’assurer que la vie est possible dans cette bière. L’expérience est aussitôt décidée. À 21 heures, Passal se couche dans la caisse dont Boulogne visse le couvercle. Les deux hommes parlent quelques instants par le tuyau. Puis, tandis que le marquis reste dans la bière seul au premier étage, son complice va tranquillement se reposer au rez-de-chaussée. La nuit se passe…
À 5 heures du matin, Passal, qui se réveille le premier – il est le plus mal couché – frappe sur les parois de la caisse, et Boulogne accourt. Il dévisse le couvercle, aide Passal à sortir. C’est un peu fatigant, dit le « marquis » en s’étirant, mais ça ira. La répétition générale a, hélas, trop bien marché !
Revenons quelques jours en arrière. Tandis que Boulogne est en train de faire ses achats à Paris et d’en assurer l’expédition à Villennes, Passal, le 27 septembre, va lui-même dans le bois de Verneuil pour y choisir l’endroit où il veut être enterré. C’est lui seul qui trace, à la chaux, les raies qui doivent permettre de découvrir aisément sa tombe et qui, sur place, dresse le plan exact des lieux, plan qui, on le sait, est adressé à Mme Passal mère et à MM. Bachelet et Durot.
Tout est donc prêt pour le dernier épisode du scénario.
Ce qui précède, les enquêteurs l’apprennent d’Henri Boulogne, dit le « Tatoué », vieille connaissance de la justice puisqu’il a été condamné huit fois pour vol.
C’est Boulogne également qui fait de l’inhumation le récit suivant : « Nous sommes partis de la villa « Les Pavots » le mardi 1er octobre, 21 heures ; la nuit était très noire. Nous étions à pied et, à tour de rôle, portions le cercueil sur les épaules. Les quatre kilomètres qui séparent Villennes de Verneuil nous parurent bien longs. C’est seulement à minuit que nous arrivâmes à l’endroit choisi par Clément. Nous étions tous les deux harassés, d’autant plus qu’il avait fallu emporter une pelle, une pioche et des outils pour fermer la boite.
Nous nous reposâmes environ dix minutes. Passal était très gai.
C’est moi, qui ai creusé le trou dans le talus. Nous avons ensuite placé la bière dans l’excavation, en tenant chacun par un bout.
Après s’être déshabillé, ne conservant que sa chemise, son pantalon et ses souliers, Passal s’est introduit dans le cercueil, les pieds en avant. Il m’a dit de rapporter ses autres vêtements chapeau, veston, imperméable, à la villa.
Les effets qui ont été trouvés à la consigne de la gare Saint-Lazare sont d’autres vêtements que j’avais, sur les instructions de Clément, portés à cet endroit quatre jours auparavant.
Le bulletin envoyé à Mme Passal mère, avec la lettre menaçante, faisait partie du scénario, et c’est Clément qui a tapé la lettre à la machine à écrire.
Il faut vous dire qu’avant de se mettre en bière, Passal avait jeûné quarante-huit heures pour ne pas être incommodé par des digestions intempestives. (Remarquons, en passant, que ce jeûne dut sensiblement affaiblir le fakir improvisé et qu’il n’est peut-être pas étranger à sa mort rapide.)
Quand Clément fut installé, il me dit : « Tu peux y aller ! »
J’ai alors vissé le couvercle et recouvert le cercueil de terre, en prenant soin de protéger le tuyau et de laisser l’orifice bien dégagé. Nous avons pu, ainsi, rester pendant près d’un quart d’heure, et quand, croyant avoir paré à tout, je le disposai à quitter la place, Clément me dit : « T’en fais pas, mon vieux. Va-t-en ! Faut pas s’en faire. N’oublie pas les lettres. » Ce furent ses dernières paroles. Il était exactement 4 heures du matin, la nuit était toujours complète.
Je m’aidai, pour retrouver mon chemin, de la lampe électrique qui nous avait servi pour l’aller et pour l’inhumation. J’arrivai aux « Pavots » à 7 heures. J’étais éreinté. Je m’endormis comme une souche.
Cependant, poursuit Boulogne, mon sommeil ne fut pas très long. À 9 heures, je partis pour Paris, afin d’expédier les lettres dont Passal m’avait chargé, l’une pour sa mère, autre pour un ami. J’en gardai cependant une, celle adressée à Durot.
Je rentrai exténué de Paris. Malgré ça, le même soir, soit mercredi à 19 heures, je quittai la villa et me rendis au bois de Verneuil. J’emportais avec moi un long tuyau de caoutchouc pour donner à boire à mon ami. Il avait un peu de quoi manger, ayant gardé dans la poche de son pantalon une demi-livre de chocolat.
J’arrivai à la tombe vers 20 heures. Rien n’avait été touché.
Me penchant vers le tuyau d’aération, j’appelai, doucement d’abord, puis de plus en plus fort
Clément ! Clément !! Clément !!! Aucune réponse. Je collai mon oreille à l’orifice du tube en espérant entendre au moins un souffle. Rien. Alors je frappai. Toujours rien.
J’étais affolé. Je pensai, un instant, qu’il n’était qu’évanoui, mais j’eus beau attendre, réitérer mes appels, mes cris, ce fut en vain. Si j’avais eu les outils que le matin, en m’en allant, j’avais jetés sur la route marquée de raies pour les faire découvrir, j’aurais essayé de délivrer mon compagnon.
La peur s’en mêla. Je m’enfuis comme un fou : je regagnai la villa où je me terrais sans oser en sortir.
On sait comment les lettres écrites par Passal à sa mère, à M. Durot et à M. Bachelet déclenchèrent l’action de la gendarmerie.
Boulogne termine son long récit en sanglotant.
Pauvre Clément, dit-il. C’était un si brave ami. Il avait tant confiance. Il m’a fait expédier trop tard les lettres. Et alors, on est venu trop tard. Ah pourquoi me suis-je prêté à cette atroce machination.
Lorsqu’Henri Boulogne, le fossoyeur du marquis de Champaubert, fut arrêté dans la villa des Pavots, à Villennes-sur-Seine, par la police mobile et faisant des aveux complets, il avait ajouté qu’il connaissait parfaitement l’endroit où son ami avait caché ses mémoires.
C’est pour retrouver ces documents qu’hier matin, à 9 h 30 Boulogne était extrait de sa cellule de la prison Saint-Pierre et prenait place dans l’auto de la première brigade mobile, au côté de M. Gabrielli, chef de ce service, qu’accompagnaient les inspecteurs Lauret et Reynier.
Le meurtrier involontaire fut conduit dans le bois de Verneuil, et après avoir fait vingt pas en partant du lieu où fut enterré Passal, il s’arrêta et indiqua aux policiers qu’à 15 centimètrès sous terre se trouvaient les documents recherchés. En effet, après quelques minutes de fouilles, les policiers mettaient au jour un paquet confectionné avec de vieux journaux et dans lequel, enveloppés dans du papier d’étain et du papier de soie, se trouvaient classés un nombre considérable d’articles de journaux ayant relaté les exploits du fameux escroc, quantité de pages dactylographiées que Boulogne dit être le double de la correspondance expédiée au Matin, deux lettres écrites sur papipr bleu, signées Mme d’Orgeval, et datées de Deauville. Dans ces lettres, adressées à Passal, il est question d’un contrat que celui-ci devait passer avec la signataire pour la publication de ses « mémoires ». Il ne semble pas douteux que ces missives ont été écrites par une amie du défunt.
Parmi tous ces documents se trouvait en outre une page sur laquelle étaient portés des titres ayant sans doute trait à la composition des mémoires dont le lancement était préparé avec tant de soin par Passal. Notons d’ailleurs que, d’après ce qu’on en sait maintenant, ces mémoires auraient été aussi faux que le titre de marquis de Champaubert dont Passal s’était habillé jadis.
On lit notamment « Cambriolage de la vermicellerie, 125.000 f. Vol du train bleu, 1.575.000 f. Pour abattre la Tour Eiffel. Le mystère de Londres, 2 millions. Amant d’une comtesse à 13 ans. Le rayon mortel invisible. La Joconde 1911. Mitrailleuse pour la Chine. Un inspecteur de la police judiciaire, 8.000 1 francs x, etc. Que signifie cette liste ? Suite de livres projetés par Passal ou titres des futurs chapitres d’un unique ouvrage ?
Ce qui est certain, en tout cas, c’est que cette énumération ne correspond nullement aux exploits réels du faux gentilhomme. Il est hors de doute, par exemple, que Passal n’a jamais, de près ou de loin, trempé dans l’affaire de la Joconde. Il faut mettre tout sur le compte de son imagination et supposer qu’il plaçait de grands espoirs dans ses talents de romancier.
Boulogne avait, en outre, fait savoir aux policiers qu’il avait caché dans un taillis, à proximité, la pioche lui ayant servi à creuser la tombe. Là seule découverte de cet outil démontra que l’inculpé avait dit vrai. On retrouva au même endroit une bouteille encore remplie de café au lait. Boulogne, on s’en souvient, devait ravitailler l’enterré à l’aide d’un tuyau de caoutchouc. Ayant constaté que Passal ne répondait pas à ses appels il avait abandonné dans le taillis la bouteille et son contenu.
Le tout a été porté dans le cabinet de M. Roussel, juge d’instruction, qui, après avoir exammé les pièces devant constituer les éléments des mémoires du pseudo-marquis, a mis le tout sous scellés.
Ajoutons qu’Henri Boulogne a choisi pour défenseur Me Zêvaes, avocat à la cour.
Dunkerque, 8 octobre. Téléph. Matin. On a pris possession à Dunkerque des objets qu’avait laissés dans sa chambre le docker Henri Boulogne. Boulogne habitait la même chambre qu’un autre interdit de séjour, Alexandre Trahan, qu’on va interroger pour savoir s’il ne lui avait pas fait quelque confidence.
À la suite de sa déposition, Boulogne est gardé à la disposition de M. Roussel, juge d’instruction, qui, aujourd’hui sans doute, l’inculpera d’homicide involontaire.
Le docteur Detis, médecin légiste près le parquet de Versailles, qui pratique l’autopsie du faux marquis de Champaubert, nous dit qu’un homme inhale 500 centimètres cubes d’air dont 250 centimètres cubes environ sont viciés lorsqu’il les a rejetés. En supposant qu’il ait appliqué la bouche à l’orifice du tuyau, Passal aurait inhalé de l’air corrompu qui ne s’évacuait pas. Les suffocations ont dû commencer dès que le cercueil fut recouvert de terre mais la mort n’est survenue vraisemblablement qu’après vingt-quatre heures de souffrance.
Hier soir, à 18 heures, un inspecteur de la police est venu à Saint-Aubin-Jouxte-Boulleng chercher Mme Bachelet, qui a fermé boutique et mis son enfant en garde. Mme Bachelet a été conduite à Rouen, d’où elle sera dirigée sur Paris pour être interrogée.
Nous avions, dès que fut connue cette affaire par trop fantastique, fait prévoir son issue. La police a travaillé avec tant d’adresse et de zèle qu’en moins de vingt-quatre heures elle a reconstitué tout le drame rocambolesque et arrêté le seul de ses deux auteurs qui puisse en répondre devant la justice, un récidiviste du vol, Henri Boulogne, le second n’étant autre que la victime, Clément Passal.
La séquestration, les Chevaliers de Thémis et leurs tortures, etc., tout cela ne s’est passé que dans l’imagination de Clément Passal malheureusement, le dernier épisode l’enterrement n’a été que trop réaliste. Aidé d’un complice, le marquis de Champaubert s’est fait enfouir sous la terre ayant trop présumé de ses qualités de fakir occasionnel ; il en est mort.
C’est la fin tragique de Clément Passal, le faux marquis de Champaubert ; l’enterré vivant du bois de Verneuil, est éclairci : le fameux escroc est mort victime d’une mystification, qu’il voulait sensationnelle, pour lancer avec toute la publicité possible ses « Mémoires » du Napoléon de l’escroquerie.
Le 9 octobre 1929, on reconstitue l’enterrement du « marquis » : M. Gabrielli, commissaire divisionnaire, chef de brigade mobile, accompagné de deux inspecteurs, quitte ses bureaux dans la matinée, se rendant à la prison de Versailles, où, à midi, il prend possession de Boulogne, le fossoyeur volontaire du pseudo-marquis de Champaubert, l’enterré vivant. L’après-midi, il procède à la reconstitution du drame de la forêt de Verneuil ainsi qu’à la recherche des documents qui auraient pu servir au faux gentilhomme pour écrire ses « mémoires ».
Une enquête a permis d’établie que Boulogne, le fossoyeur du faux marquis de Champaubert, avait quitté Dunkerque le 12 septembre 1929, après avoir, été touché, le 10 septembre, dans l’après-midi, par une dépêche avec avis de réception.
Il logeait à ce moment en hôtel, 29 rue du Sud, à l’angle de la rue Saint-Sébastien, occupant une chambre meublée à raison de 28 francs par semaine. Cet individu ne s’était point fait remarquer. C’était un locataire convenable qui disait travailler comme docker au port, quand il reçut le « petit bleu » qui provenait sans nul doute de Passal.
Boulogne, qui était quelquefois un peu gai, n’avait commis à Dunkerque ni excentricités, ni écarts de langage. Il avait dit à ses loueurs qu’il reviendrait bientôt. Il leur laissa même sa malle. Les hôteliers ont été très étonnés du rôle joué par leur locataire.
Henri Boulogne, le comparse du faux marquis de Champaubert, est né à Boulogne-sur-Mer, le 29 juin 1902. Son père, qui habite le hameau de Malborough, voisin de la commune de Wimille, est employé chez un marchand de charbon de la haute ville et il est bien connu de toutes les ménagères qui, chaque jour, guettent son appel.
Henri Boulogne exerça, par intermittence, le métier de docker, mais il se livrait surtout au vol et son casier judiciaire mentionne qu’il a suhi une condamnation. En 1924, à la suite d’un cambriolage, il a comparu devant le tribunal de sa ville natale, qui l’expédia faire un assez long séjour à la prison centrale de Loos-lez-Lille, où, on le sait, il fit la connaissance du « marquis » de Champaubert,
À l’expiration de sa peine, l’interdiction de séjour ayant été prononcée contre lui, Boulogne alla résider dans la banlieue parisienne.
C’est début novembre 1929 que comparaît Henri Boulogne devant le tribunal correctionnel.
Le 5 décembre 1929, au roman tragique du marquis de Champaubert, succède un épilogue digne des « tribunaux comiques ». C’est, en effet, en correctionnelle, que se répercutent les derniers échos de cette affaire qui coûta la vie à Passal ! Le marquis de Champaubert après avoir voulu mystifier ses contemporains, se joua à lui-même la dernière farce. Il mourut le 2 octobre dernier, dans le bois de la Justice, à Verneuil-Vernouillet, enfermé dans une caisse d’où il devait sortir glorieux, tenant en main des « mémoires » rédigés dans un style rocambolesque. Il ne s’évada pas de ce cercueil, d’où on le retira mort d’asphyxie après de longues heures de souffrances.
Devant le tribunal correctionnel de Versailles, présidé par M. Blavier, deux inculpés comparaissent : Henri Boulogne, repris de justice et docker, qui enterra le faux marquis ; Félix Bachelet, qui « coupa » dans l’histoire des vengeurs « Chevaliers de Thémis » et outragea les magistrats en les trompant inconsciemment.
Le visage de Boulogne, au front bas et à l’œil triste, explique son indigence d’esprit et son indiscutable simplicité. Il a connu « Passal-de Champaubert » à la prison de Loos. Il le retrouve à Verneuil et s’engage à le servir dans ce corps imaginaire des « Chevaliers de Thémis », dont il est le seul membre actif.
C’est lui, le pauvre Boulogne, qui enterre son camarade de Champaubert, après avoir construit le fameux cercueil en bois tapissier, bois très résistant. Il ne sait pas qu’il est indispensable de l’aérer, non pas avec une cheminée de fonte, mais avec plusieurs. Homicide par imprudence. C’est ce qu’on lui reproche aujourd’hui.
Quant à Bachelet, un honorable charcutier de Verneuil, il se présente fort élégamment. Prévenu libre, il est debout près de la barre des témoins et répond qu’il a eu peur ! Peur de quoi ! De se contredire ! Alors, il raconte le roman des « Chevaliers » et est poursuivi.
Au pied du tribunal, est couchée la longue caisse encore boueuse qui fut le cercueil du pseudo-marquis. Sa présence ne crée pas l’atmosphère tragique que l’on attend. On la regarde en souriant, cette grande coupable d’une plaisanterie qui a mal tourné.
Après que M. Raimbaud, substitut, eût retracé l’historique du drame, on appelle les premiers témoins. C’est d’abord le docteur Detis, qui pratiqua l’autopsie, puis M. Durot, qui loua à Champaubert la villa de Villeneuve-sur-Seine.
Le docteur Schoegrun, de l’hôpital de la Pitié, nous donne des précisions mathématiques sur l’oxyde de carbone rejeté par le corps humain et la résistance de chaque individu devant l’asphyxie : « Il n’était pas possible à Champaubert de vivre plus de 6 à 7 heures dans le cercueil où il fut enfermé ».
Mais voici le répertoire grand-guignolesque, sous les espèces de M. Albert Lévy, acteur-auteur-directeur, etc… il nous fait savoir qu’en tournant un film chez Pathé avant la guerre, il fut enterré vivant et qu’il s’en trouva très bien. Et il conclut : « Le marquis de Champaubert a mal mis sa pièce en scène… Il ne l’avait pas suffisamment répétée… Il fut sa dernière victime. » M. Albert Lévy est un bon acteur de « décomposition » !
- Chemama, étudiant et secrétaire du syndicat des prestidigitateurs, s’avance à la barre. C’est un jeune homme qui ne dissimule rien. Il jure de dire la vérité, « toute la vérité », avec une véhémence de music-hall. Rien dans les mains… Rien dans les poches : « Je n’ai jamais fait l’expérience de l’enterré vivant, mais je dis que les fakirs ne truquent pas. Ils se bouchent les narines et les oreilles et restent le moins possible sans respirer. Tout cela, Boulogne ne pouvait pas le savoir. Ce qui l’a trompé, ce sont les écrits de M. Heuzé, qui affirme que tout le monde peut « faire le fakir ».
Après quoi, M. Chemama s’escamote lui-même et disparaît.
- Raimbaud, substitut, aimable et fin, demande pour Boulogne l’application modérée de la loi et, pour Bachelet, l’amende traditionnelle.
Me Théodore Valensi lui réplique ; Me Alexandre Zévaès en fait autant, s’appuyant avec humour sur une jurisprudence chatnoiresque qui amuse la salle et ne déplait point au tribunal. L’un et l’autre demandent l’acquittement de Boulogne.
La défense de Bachelet est présentée par Me Réau.
Les juges se retirent.
Après une courte délibération, ils condamnent Boulogne, pour homicide involontaire et infraction à un arrêté d’interdiction de séjour, à trois mois de prison.
Cent francs d’amende sont infligés à Bachelet pour outrages à magistrats.
L’affaire de Champaubert est définitivement… enterrée.
Souvenons-nous quand même, alors qu’il comparraissait devant le tribunal correctionnel de Saint-Malo, Passal, ayant laissé pousser sa barbe, joue à merveille le « dingo ». À merveille, mais sans résultat, puisqu’il est condamné.
À la suspension de séance, Geo London le croise dans le couloir derrière le box et lui murmure : « Et les Mémoires ? Quand commençons-nous ? »
Il lève sur lui un œil terne ; puis, la paupière retombe et le marquis passe, lointain, indifférent, glacial.
Les circonstances de sa mort prouvent qu’il n’a pas renoncé à ses projets littéraires. Sans doute, songeait-il toujours à la vente de son livre en Amérique, en organisant une publicité aussi sensationnelle. Le lancement était à coup sûr ingénieux.
Excellent escroc, le marquis de Champaubert est peut-être un auteur de génie. Donnons-nous, en tout cas, l’illusion de le croire tant qu’on n’aura pas retrouvé son manuscrit.
C’eût été trop beau ! Encore que la fantastique affaire du marquis de Champaubert ne soit pas définitivement close — ou cela m’étonnerait fort — je crois être en droit d’en tirer déjà une conclusion – ou, si l’on préfère, un regret.
Je regrette, tout simplement, que les fameux « Chevaliers de Thémis » n’aient jamais existé que dans l’imagination de Clément Passal. Comme c’est dommage ! Voyez-vous ce qu’aurait pu être révolution de notre société, depuis dix ans seulement, si les Chevaliers de Thémis avaient réellement mis en pratique le programme que leur avait assigné le marquis de Champaubert ! Les mercantis au régime de l’eau, les spéculateurs sur le franc au régime des brodequins, les politiques en manque de subsides pour financer leur campagne électorale, les escrocs et les financiers véreux enterrés vivants, quelle aubaine pour les honnêtes gens ! Je passe naturellement les fraudeurs de beurre qui eussent fait connaissance avec le chanvre et les mouilleurs de lait avec les réverbères. Et j’arrive tout de suite à l’exemplaire leçon qu’en eussent reçue les autres, pour imaginer que, tout de même, à ce régime-là, nous aurions vu fondre pas mal de nos difficultés et disparaitre la plupart de nos misères.
Hors cela, il n’eût pas été mauvais de saluer ce petit renouveau d’idéal et de justice dans notre temps si terre-à-terre et si platement matérialiste. Que de simples hommes se fussent donné ce rôle si abandonné de redresseurs de torts, de procureurs comme dirait Macron lorsqu’il évoque les 66 millions de Français, cela nous aurait consolés de notre pauvre justice qui n’est plus qu’avocasserie.
Et pour tout, dire, c’eût été trop beau.
Si beau, même, que jusque dans la fiction imaginative de l’escroc-romancier un tel thème ne put conduire son auteur qu’à en mourir.
Jacques Barty
Le 18 janvier 1933, la caisse en bois, devenue le cercueil de Clément Passal, qui encombre les locaux du palais de Justice est finalement vendue aux enchères par le service des Domaines pour la somme de 5 francs, à peine le prix du bois.
On reparlera une dernière fois de l’affaire dans la presse à l’occasion d’une nouvelle condamnation d’Henri Boulogne en août 1941.
Le Petit Parisien, Jacques Roujon (1884-1971). Directeur de publication, 5 octobre 1929
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6077179/f2.item.r=cl%C3%A9ment%20passal.zoom
Le Petit Parisien, Jacques Roujon (1884-1971), Directeur de publication, du 6 octobre 1929
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k607718p/f1.item.r=%22cl%C3%A9ment%20passal%22.zoom#
L’Ouest-Éclair, 6 octobre 1929
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6238602/f1.item.r=cl%C3%A9ment%20passal.zoom#
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9029407x.r=passal?rk=21459;2
L’Ouest-Éclair, Emmanuel Desgrées du Lou, (1867-1933). Directeur de publication, 8 octobre 1924
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k647787p/f3.item.r=biganos.zoom#
L’Homme libre, Georges Clemenceau, (1841-1929), Rédacteur, 8 octobre 1929
La Liberté, Charles Muller, Directeur de publication, 9 octobre 1929
L’Ouest-Éclair, 31 octobre 1929
L’Œuvre, 5 décembre 1929
Cyrano : satirique hebdomadaire, rédacteur en chef Léo Marchès, 13 octobre 1929
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5595741k/f16.item.r=%22marquis%20de%20Champaubert%22passal
http://histoire.villennes.free.fr/ChargeRubrique.php?R=Extension78&P=Champaubert
Le Matin du 7 octobre 1929
Le Matin du 9 octobre 1929
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5766710/f2.item.r=passal%20wagons%20arm%C3%A9e%201916.zoom
http://histoire.villennes.free.fr/Pages/Extension26.htm
Compléments :
Le Populaire, 6 octobre 1929
Le Détective, 1929
https://criminocorpus.org/fr/bibliotheque/page/92293/#page
Basse pègre, René Masson, 1970
Excelsior, Pierre Lafitte, (1872-1938). Directeur de publication, 5 octobre 1929
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4608228g/f3.item.r=%22Henri%20de%20Vaudrey%22.zoom#
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9ment_Passal
Le Grand écho du Nord de la France du 6 octobre 1929
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4761655g/f2n1.texteBrut